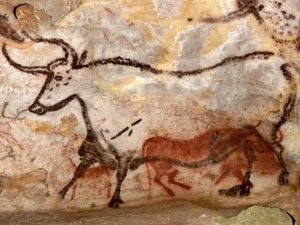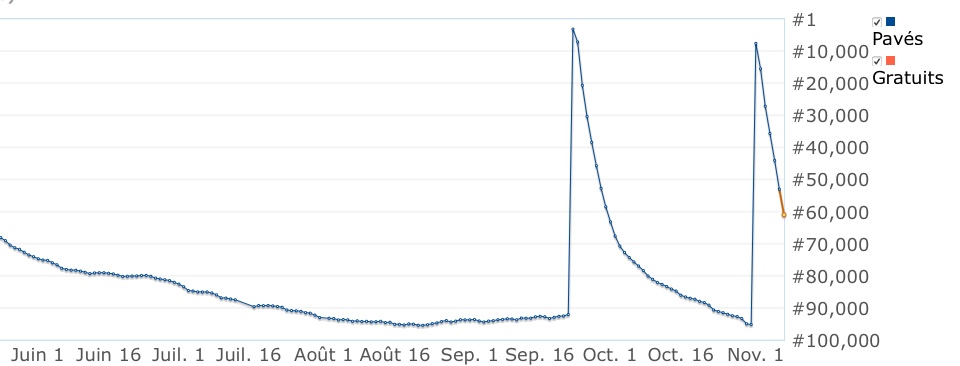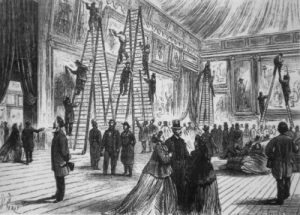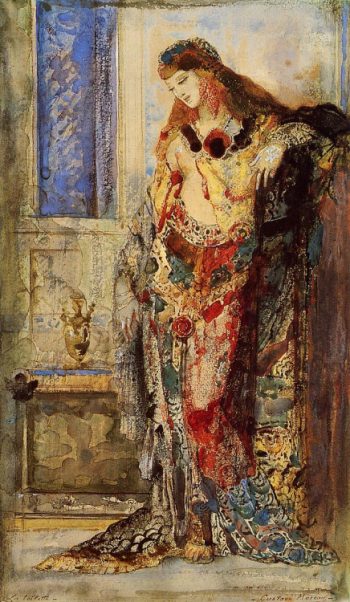Vendre, se vendre… Les auteurs indépendants font-ils le jeu du capitalisme ?
Par Nila Kazar
#économienumérique #autopromotion #surproduction #bibliodiversité #paupérisation #Amazon
Longtemps, alors que j’appartenais uniquement à l’Ancien Monde éditorial, je n’avais aucun moyen d’influencer les ventes de mes livres. Et en plus, je m’en fichais.
C’était le boulot de l’éditeur, pas le mien. C’était à lui de communiquer, de commercialiser. Ça m’arrangeait : je n’ai aucun talent pour tirer les sonnettes et proposer ma came. Même pour mes manuscrits, rappeler humblement à un éditeur que j’attends sa réponse me coûte un bras (voilà pourquoi je suis manchote). Demander, quémander, relancer, je déteste ça !
Et puis l’éditeur tradi a des moyens à sa disposition qui m’échappent totalement : des attachées de presse, un service commercial, un réseau de représentants en librairie, pour ne citer que ceux-là. Mon boulot à moi, c’est d’écrire. Et ce n’est déjà pas si simple.
disposition qui m’échappent totalement : des attachées de presse, un service commercial, un réseau de représentants en librairie, pour ne citer que ceux-là. Mon boulot à moi, c’est d’écrire. Et ce n’est déjà pas si simple.
Si bien que, lorsqu’une éditrice m’a refusé un manuscrit sous prétexte que mon précédent livre s’était « mal vendu » (quelle délicatesse, soit dit en passant), j’aurais été fondée à lui rétorquer que la commercialisation relevait de sa responsabilité, non de la mienne.
Mais les perdants ont toujours tort, n’est-ce pas ?
Alors, quand j’ai commencé à évoluer dans le Nouveau Monde éditorial, celui qui supprime tous les maillons intermédiaires entre l’auteur et ses acheteurs potentiels, sauf la boutique en ligne, j’ai été décontenancée : en plus de la fabrication numérique proprement dite, il me fallait apprendre toutes sortes de trucs pour communiquer moi-même autour de mon livre, essentiellement sur les réseaux sociaux (lire sur l’auto-promotion ma Lettre Kazare, un petit exercice de style à la Montesquieu), dans l’espoir que des lecteurs/blogueurs bienveillants – quoique totalement inconnus – déposeraient des commentaires positifs ou rédigeraient des chroniques élogieuses (un grand merci à ceux qui l’ont fait !).
On apprend assez vite à maîtriser ces outils, toute la question est de savoir si on se lasse le premier de chercher à vendre et à se vendre, ou si on lasse d’abord nos interlocuteurs. Car hululer en permanence et sur tous les tons que son livre est génial et mérite d’être acheté toutes affaires cessantes, voilà qui donne la migraine, sans parler du sentiment d’imposture qui guette toujours l’écrivain authentique.
Voici des conseils concrets :
En ce qui concerne la vente au format numérique, il existe toutes sortes d’excellents e-bouquins, dont ceux de Cyril Godefroy. On apprend à jouer avec les algorithmes et on assimile quelques rudiments d’e-commerce : trailer vidéo, enregistrement audio, feuilletage d’extrait gratuit, mise en place de rabais ou de promotion, publicité sur divers supports, etc. Il y a aussi l’excellent livre d’Elisabeth Sutton et Marie-Laure Cahier.
Pour ce qui est de la vente de livres « physiques » : vente à distance, dans les librairies ou dans les salons du livre, on aura intérêt à consulter les sites internet d’Alan Spade ou de Guy Morant (pardon si je ne cite pas tout le monde, je vous invite à consulter ma page Ressources qui recense d’autres sites utiles). De plus, toutes ces techniques sont abondamment décrites, relayées, commentées sur les groupes Facebook dédiés.
C’est merveilleux, l’entraide bénévole qu’on rencontre dans le Nouveau Monde éditorial. C’est formidable, de pouvoir apprendre sur le tas plusieurs métiers d’édition (mise en page, graphisme de la couverture, correction ortho-typographique…) et de s’améliorer à chaque livre. Je suis sincèrement reconnaissante envers ceux qui partagent gratuitement leur savoir-faire avec les éternels apprentis que nous sommes.
Mais vous me connaissez : il faut toujours que je renverse sur la table ma salière de poil-à-gratter 😉
Quand j’ai mieux connu cet univers, j’ai commencé à remarquer des contradictions flagrantes chez les auteurs indépendants. J’ai déjà écrit dans ce blog qu’ils appartiennent à des milieux socio-culturels beaucoup plus diversifiés que les auteurs traditionnels, et que je trouvais ça très bien. Mais cette caractéristique a aussi son revers.
Les indés ont souvent (pas tous !) un tempérament anarchiste et des idées de gauche affirmées. Ils détestent tout ce qui les classe, les juge. Ils se veulent… eh bien, indépendants, justement. De ce fait, il refusent les hiérarchies, taxent d’élitisme tout ce qui tend à opérer des distinctions qualitatives dans leur production (Elen Brig Koridwen en parle très bien), récusent toute critique comme illégitime, s’agacent de remarques justifiées sur leurs maladresses de fond ou de forme.
Mais en même temps – il est là, le paradoxe –, ils se soumettent au pire ennemi des libertaires qu’ils sont dans l’âme : ils collaborent avec empressement à l’hypercapitalisme débridé des plateformes commerciales, avec leur omnipotent classement des ventes (voir ce billet). En fait, ils plient l’échine devant le tout-puissant marché, et ils en redemandent…
Comme le dit un ami, « les indés ne veulent surtout pas savoir ce que vaut leur livre. S’il se vend bien, c’est qu’il est bon, point final. En fait, ils adoptent le point de vue de Kindle Direct Publishing ». Bref : on vote pour la gauche radicale, mais on ne veut être apprécié qu’à l’aune des charts du grand méchant Amazon tout pas beau qui exploite les pauvres travailleurs !
La compétition – valeur ô combien de droite, et définitivement contraire à toute pratique artistique ou créative – est omniprésente chez les auto-publiés. Chacun déplore le « mauvais commentaire d’un auteur forcément jaloux » qui fait perdre trente places dans le sacro-saint Top 100, chacun essaye de nouvelles formules pour relancer des ventes fléchissantes (y compris la manipulation malhonnête), et trop souvent, pratique la surproduction qui, pourtant, est le mal endémique de l’industrie du livre depuis plus de trente ans. On inonde le marché, comme dans l’édition tradi… mais beaucoup plus rapidement qu’elle, et à une échelle bien plus vaste !
Permettez-moi de citer les propos d’une indée dans un fil de discussion (orthographe respectée) : « Tu l’as publié en MARS ??? ah bah cherche pas plus loin ! Un livre rapporte en moyenne environ 3 a 4 mois ! Apres il est relancé par les nouveaux qui font de la pub aux anciens ! Pourquoi crois tu que je suis à mon 17eme romans en 3ans. Mes copines auteurs en romance c’est pareil on carbure a cause de la durée d’un livre ».
« La durée d’un livre »… Hum ! La Bible est un best-seller depuis trois mille cinq cents ans, et je prévois que ce n’est pas fini.
La surproduction d’e-bouquins vendus en ligne, qui noie les rares ouvrages de qualité dans un océan de niaiseries lucratives à peine écrites (voici ce qu’en pense Guy Morant), sans compter les arnaques délibérées des escrocs du web, est à mes yeux une catastrophe profondément affligeante. En quelques années seulement, le Nouveau Monde éditorial a rattrapé et dépassé l’Ancien sur ce point.
Mais ce n’est pas tout ! Poursuivons notre modeste analyse critique : au début, je voyais l’émergence d’une production indépendante comme une occasion unique de rééquilibrer les rapports de force auteurs/éditeurs, une avancée porteuse d’espoir y compris pour les éditeurs tradi eux-mêmes, qui avaient enfin l’opportunité de faire évoluer leurs pratiques et de s’ouvrir au vaste monde sous la pression d’une concurrence inattendue. D’une part, les tarifs très bas pratiqués par « l’indésphère numérique » mettaient la pression sur les prix élevés fixés à leurs e-bouquins par les éditeurs tradi, obsédés par le désir de préserver le secteur rentable du poche ; d’autre part, les critères germano-pratins régissant le choix des livres « méritant d’être publiés », désespérants d’étroitesse d’esprit, étaient enfin bousculés.
Oui, mais… Très vite, les auto-publiés qui parvenaient à tirer leur épingle du jeu et à vendre énormément sont devenus le vivier des éditeurs tradi grand public. Ce qui a octroyé à ces derniers deux avantages inestimables, dont ils rêvaient depuis toujours : 1. faire l’économie d’un service des manuscrits onéreux ; 2. réduire, voire anéantir la part de risque inhérente au métier d’éditeur.
Je ne jette nullement la pierre à ces auteurs chanceux, bien au contraire, je les félicite en toute sincérité. Mais cette opération de récupération me rend vraiment furieuse. Parce que, si les indés doivent in fine ne servir qu’à fournir aux éditeurs tradi une sélection de succès déjà testée et approuvée par les lecteurs, on peut craindre que la bibliodiversité soit encore plus malmenée qu’auparavant. Et c’est en outre un coup fatal porté au rééquilibrage des rapports de force auteurs/éditeurs.
D’ailleurs, soyons lucides, c’est déjà foutu : tout récemment, des éditeurs à l’image « littéraire », « exigante », ont recruté en vue de créer des collections grand public destinées à accueillir les romans feel-good et autres romances érotiques à deux balles. Mamma mia…
Oui, c’est foutu, les valeurs mercantiles ont encore triomphé. La révolution du numérique, qui a bouleversé les secteurs de la musique et du cinéma, a fait pschitt dans le secteur du livre. La récupération, ce gigantesque ramasse-miettes aux crocs d’acier, a tout broyé et absorbé. Et les œuvres audacieuses, la littérature pratiquée en tant qu’art sont encore plus réduites à la portion congrue qu’il y a quelques années. Car – quelle naïveté ! – je voyais aussi l’émergence du secteur indé comme une fenêtre qui s’ouvrait pour les titres subversifs, novateurs, non formatés par le marché (voir ce billet). Mais le soufflé est retombé, à peine monté…
Comme le constate amèrement Thierry Crouzet, qui a souhaité tout le contraire pour l’économie numérique (et en particulier a longtemps cru à la gratuité) : « Chaque fois que nous donnons un contenu, et je le fais à l’instant avec ce billet, nous alimentons le capitalisme cognitif, nous donnons aux plateformes plus de force, plus de pouvoir, une position de plus en plus prééminente au centre de la société. Donner, libérer, n’est peut-être pas le meilleur moyen de créer une société plus égalitaire, bien au contraire. Plus le réseau se développe, plus les inégalités grandissent. »
Moi aussi, je vous « donne » ce billet gratuitement. Et sachez-le, je vais continuer à écrire exactement comme avant : sans aucun souci de cible, de lectorat, d’édition, de rentabilité, de succès, de reconnaissance… Le monde peut bien changer, je continue à tracer ma route !
Mais quand même, il faut admettre qu’on n’a pas le cul sorti des ronces, mes amis. La paupérisation des écrivains ne fera que s’accentuer à l’avenir.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits,ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici. Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Tous écrivains ?
Par Nila Kazar
#EmilCioran #Platon #SamuelBeckett #BorisCyrulnik #AlbertCamus #ErnestoSabato
Longtemps je me suis demandé pourquoi la France était une nation d’aspirants-écrivains.
Dans les années 80, le philosophe Emil Cioran citait une remarque de sa concierge, qui sans doute ignorait tout de ses coupables activités : « Les Français ne veulent plus travailler, ils veulent tous écrire ».
Nous savons tous que l’écriture n’est pas un travail et ne requiert aucun effort, aucune compétence. Non ?
En tout cas, la concierge de Cioran le croyait. Sans doute trouvait-elle que les artistes bohêmes qui menaient une vie dissolue dans les mansardes de son immeuble parisien n’en fichaient pas une rame, ce tas de parasites ! D’ailleurs, Cioran lui-même occupait une humble suite de chambres de bonne. Quant à savoir s’il se la coulait douce, ses œuvres n’en donnent pas l’impression.
Pendant mes années d’apprentissage, une cadre d’entreprise m’a affirmé qu’à son avis, les écrivains ne devraient pas avoir le droit de vote, car ils ne contribuent pas à la société. Stupéfaite, je lui ai demandé si elle parlait sérieusement. C’était le cas.
Bon, Platon déjà voulait exclure les poètes de la Cité, mais on aurait pu espérer que les choses évolueraient en 25 siècles ! Il faut se faire une raison : pour beaucoup de gens, nous ne servons à rien, nous sommes des fainéants, des bons-à-rien, voire des vauriens.
Mais dans ce cas – quel paradoxe – comment expliquer que la France soit atteinte d’écrivite galopante ? Car c’est une maladie très française de se vouloir écrivain. De récentes enquêtes nous informent qu’un Français sur trois rêve de le devenir à l’occasion, ou bien cache un manuscrit dans ses tiroirs qu’il compte publier un jour. Il y a vingt ans, ce ratio était de un sur quatre, ce qui me semblait déjà énorme.
(Soit dit en passant, pourquoi pas sculpteur ou compositeur ? On entend rarement : « J’aurais tellement voulu être graveur ». Ne serait-ce pas parce qu’écrire paraît – à tort – à la portée de tout le monde ? Alors que maîtriser les techniques de la gravure, de l’estampe, du vernis mou… autre paire de manches !)
Un autre symptôme : aux XXe et XXIe siècles, de nombreux présidents de la République française, ministres, chefs de parti ont publié des livres, et pas seulement au sujet de leur programme politique ou de leur bilan. Comme si la culture était un gage de sérieux, de crédibilité. Comme si la publication leur assurait un complément de prestige, légitimait leur ambition…
Je me suis souvent interrogée là-dessus. Il y a sans doute une part de tradition culturelle, car la France a connu quatre siècles d’or consécutifs en littérature, alors que les autres nations n’en ont eu qu’un, et encore, pas toutes. (J’avoue ne pas savoir si d’autres pays sont affectés d’écrivite galopante. Si un lecteur de ce blog a des lumières, je serais intéressée de les connaître afin d’établir des comparaisons.)
Dans ce désir de devenir écrivain – ou du moins, d’être considéré comme tel –, qu’est-ce qui est en jeu ? Pour tenter de répondre, je vais recourir à mon expérience personnelle. Mes réflexions seront par conséquent limitées. Je rappelle au préalable, pour qu’il n’y ait pas de malentendu, que j’ai toujours placé l’écriture et la littérature AVANT tout le reste dans ma vie. Ce qui est un cas de figure assez extrême dans la palette des possibles, vous en conviendrez 😉
Autrefois, je croisais souvent des gens qui, quand ils apprenaient la nature de mon activité, s’exclamaient : « Quelle chance vous avez, j’aurais tellement voulu écrire ! »
Face à cela, j’étais prise d’un désir sardonique de riposter : « Ah bon ! Mais dites-moi, qu’est-ce qui vous en a empêché ? »

D’abord, l’idée qu’il puisse s’agir d’une chance m’étonnait par sa fausseté ; il s’agit plutôt d’une fatalité, à vrai dire. Comme disait Samuel Beckett quand on lui demandait pourquoi il écrivait : « Bon qu’à ça ». Ce n’est pas du tout une pirouette ! Au début de sa vie d’adulte, on fait souvent diverses tentatives de « normalisation » qui échouent l’une après l’autre, si bien qu’on finit par se résigner à son inaptitude à incarner de façon crédible un autre avatar que celui d’écrivain.
Ensuite, Boris Cyrulnik cite dans ses ouvrages des études scientifiques réalisées sur des échantillons d’écrivains. L’une conclut qu’il y a deux fois plus de troubles mentaux chez eux que dans la population générale ; l’autre, que 40% des écrivains ont gravement souffert dans leur enfance, contre 12% dans la population générale. Ainsi que je me plaisais à le dire longtemps avant de lire cet auteur : « Une enfance malheureuse est une condition nécessaire mais non suffisante pour faire un écrivain » 😉
Alors, de quelle « chance » parlaient ces braves gens (souvent des fonctionnaires de la culture ou des universitaires) ? Moi, je trouvais que le prix à payer était exorbitant en termes de marginalité et de précarité. Attention, je n’ai rien d’un auteur maudit, je ne me plains pas. Je dis juste : marginalité, du fait de l’indépendance totale que réclame cet art si on le prend au sérieux, et précarité, pour des raisons économiques évidentes.
Mais Albert Camus ne disait-il pas : « Ce qui fait la noblesse du métier d’écrivain, c’est la résistance à l’oppression et le consentement à la solitude » ?
Donc, à l’abri de leur statut social protecteur, ces gens-là m’enviaient. Mais qu’enviaient-ils exactement ? Eh bien, d’abord le fameux (et toujours mystérieux) prestige, qui à mon avis est une rémanence de l’image du Grantécrivain datant du XIXe siècle. Et ensuite – je l’ai compris plus tard – ils enviaient ma liberté. J’avais osé faire ce dont ils rêvaient ; je m’étais arrogé cette audace insensée.
Quand j’ai quitté l’université (où je réussissais sans problème), parce que j’avais compris que les études de lettres, telles qu’elles se pratiquaient alors (en bref : savoir analytique, mais aucune pratique créative), menaçaient de stériliser ma vocation d’écrivain, un vieux prof de latin m’a encouragée en ces termes : « Vous avez bien raison, sauvez-vous ! » Et je me suis sauvée – c’est-à-dire « enfuie », mais aussi, j’ai « sauvé ma vie ».
Cela suscite beaucoup de jalousie, le plus souvent inconsciente. Non pas le talent, mais le fait qu’un individu lambda fasse un pas de côté et affirme sans fléchir, sans se laisser décourager (et en général l’école, les institutions, la famille, les compagnons, l’organisation sociale font tout ce ce qu’il peuvent en ce sens) : « Quoi que vous disiez, je ferai ce pour quoi je suis fait ». S’accorder cette liberté suscite l’envie parce qu’elle est rarissime : l’immense majorité des gens accepte de rentrer plus ou moins dans le moule qu’on leur propose. De ce fait, leur frustration se manifeste quand ils sont confrontés au déviant qui leur prouve par l’exemple qu’on peut se choisir une autre vie que la leur.
L’indépendance d’esprit typique de l’écrivain se retrouve dans sa liberté de s’emparer de tel ou tel thème et de le traiter sous telle ou telle forme qui ne soient pas forcément dans le vent. Un écrivain se doit d’avoir « la nuque raide », ainsi que Yahvé le reproche aux Hébreux rebelles dans l’Ancien Testament. Il faut savoir résister aux suggestions amicales des éditeurs qui vous veulent du bien. Je n’ai pas toujours su le faire, et la nécessité de gagner trois sous grâce à une parution assurée l’a parfois emporté. Mais même alors, j’essayais de préserver mon originalité et de traiter le livre à ma façon.

Un écrivain, c’est aussi un type, un caractère, qui comprend la ténacité poussée jusqu’à l’absurde, l’esprit de défi, la capacité de résilience, le goût du combat. Il doit lutter et persister contre vents et marées, même si, comme dit Ernesto Sabato, « il est le seul zélateur de son église »…
*******
Le monde a changé depuis mes débuts. Ces temps-ci, je croise surtout des gens qui s’exclament : « Vous êtes écrivain ? Super, vous allez pouvoir écrire mon histoire ! »
Là, je dois avouer que les bras m’en tombent devant tant d’impolitesse. Une fois surmonté l’agacement, je suis assaillie d’interrogations. Ces gens confondent-ils écrivain et écrivain public ? Sont-ils persuadés que leur existence est exceptionnelle au point de mériter d’être racontée et publiée ? (La réponse est oui. Le narcissisme exacerbé est une plaie de l’époque.) Pourquoi ne manifestent-ils aucun intérêt pour mes productions ? (Je n’y échappe pas.) Au fait, est-ce qu’ils lisent, et quoi ? etc.
Mais ces réactions trop fréquentes nous éclairent peut-être sur un autre aspect de la question du jour : on attend d’un livre une reconnaissance, une compensation, voire une réparation. Je me souviens qu’à la soirée de lancement d’une résidence d’écrivain en province, une femme est venue à moi et m’a tendu un pli cacheté sans rien dire, avant de se fondre dans la foule. Quand je l’ai ouvert, j’y ai trouvé la copie d’un dossier judiciaire local totalement incompréhensible. Cette femme semblait croire que j’allais me faire le héraut de ses problèmes, dénoncer l’injustice qu’elle subissait, la rétablir dans ses droits, donner une publicité à son cas – bref : la réparer. J’étais peut-être son dernier recours.
Je ne l’ai jamais revue. Mais cet épisode m’a beaucoup fait réfléchir.
De même, il arrive que des inconnus me téléphonent (je figure dans des annuaires professionnels) et, sans même se présenter, commencent à me raconter leur vie. Je les écoute dix minutes (c’est toujours intéressant d’écouter des inconnus) avant de leur demander ce qui les amène. Oh, pas grand-chose ! Ils veulent juste que j’écrive leur histoire, leur trouve un éditeur et leur garantisse un succès planétaire. Je les décourage gentiment, leur expliquant que pour moi-même, je n’ai aucune garantie en ce domaine…
Mais quand on y pense, ces inconnus n’ont pas tort de considérer qu’une des tâches de l’écrivain est de se faire le porte-voix de ceux qui en sont privés : les victimes, les marginaux, les illettrés, les morts. Simplement, ils s’imaginent, par une déformation subjective tantôt irritante, tantôt attendrissante, que leur histoire personnelle intéressera le monde entier et leur attirera une sympathie universelle.
Une dernière considération : je lis ici ou là que s’accoler à soi-même le terme « auteur » ou « écrivain » peut être perçu comme de la « prétention ». Cela aussi m’étonne. Quand on s’est voué à l’écriture, qu’on en a vécu certaines années, que divers signes de légitimité ont été reçus, il n’y a aucune raison de ne pas se présenter comme tel.

Mais je crois aussi que, lorsqu’on est un authentique écrivain, on n’éprouve pas le besoin de l’assener à tout propos. Or les technologies numériques et les médias sociaux ont amplifié le phénomène d’autoproclamation. Quasiment dès l’invention de Wikipédia, des auteurs putatifs y pondaient des fiches autobiographiques longues comme le bras ! C’est humain, mais naïf et souvent déplacé.
Alors, écrire et publier des livres, est-ce une chance, une liberté, un moyen d’obtenir une reconnaissance, du prestige, une réparation ? Dans ce billet, je n’ai fait qu’explorer de façon très insuffisante les possibles motivations des innombrables Français qui aspirent à devenir écrivains. Il va de soi que l’être chaque jour de sa vie (car c’est une manière d’être au monde) est tout autre chose.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits,ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Pairs ou mentors ? Sur la pédagogie de l’écriture
Par Nila Kazar
#lecteur #blogueur #autoédition #écriture #mentorat #recommandation #critique #commentaire
Avertissement : tous les propos cités dans ce billet sont authentiques.
Longtemps j’ai été coupée de mes lecteurs. Presque aucune communication directe n’était possible entre eux et moi avant l’invention d’Internet, des librairies en ligne et des réseaux sociaux, excepté dans les salons du livre.
Dans le Nouveau monde éditorial, l’effacement des filtres entre l’auteur et ses lecteurs est un progrès que j’apprécie. La recommandation horizontale, de pair à pair, qui crée une disruption dans un modèle figé depuis trop longtemps, faussé par l’entre-soi et démonétisé (voir mon billet sur le pouvoir réel de prescription des médias tradis), me réjouit pleinement.
Les commentaires et les chroniques comptent beaucoup pour renforcer le crédit des livres autopubliés, dans la mesure où les auteurs indés sont privés de la médiation éditoriale. De plus, ces avis offrent un aperçu direct sur la réception des ouvrages, c’est-à-dire sur la façon personnelle qu’a chaque lecteur de les appréhender. Et c’est passionnant ! J’apprends énormément depuis mon « hybridation numérique ».
Mais une chose m’étonne : l’importance démesurée que certains indés attribuent aux commentaires. Ils en attendent souvent quelque chose de constructif, qui les aidera à progresser. C’est se tromper d’adresse ! Même les éditeurs tradis donnent peu de conseils vraiment utiles, et, depuis l’industrialisation du secteur, ils sont rares à le faire. L’une de mes éditrices ne m’a jamais dit un mot sur mes manuscrits. Soit elle acceptait, soit elle refusait, sans explication (ce qui pose la question de la compétence – autre débat). Or les auteurs ont besoin de remarques argumentées sur leur travail tout au long de leur carrière. Pour cela, il vaut mieux qu’ils recourent à des amis, si possible écrivains eux-mêmes, qui leur rendront l’inestimable service de les lire d’un œil critique et avisé.
Trop d’indés manifestent une foi aveugle dans l’évaluation de leurs pairs, tout en rejetant l’idée qu’il existerait des critères, des valeurs, des outils de distinction en soi. Du coup, l’idée prévaut que les avis positifs valident la qualité de l’ouvrage (bon, j’avoue que j’ai très envie d’y croire moi aussi !), tandis qu’ils s’affligent excessivement des avis négatifs (pour en savoir plus sur l’attitude que je préconise face à la critique, reportez-vous à ce billet).
Afin d’éclairer mon propos, je citerai une indée : « Je réalise que, parce que certaines personnes ont critiqué mon premier livre, le deuxième est complètement à l’opposé. Et, parce que les premières pages du deuxième a reçu quelques critiques, j’ai réécrit douze fois les premières pages du suivant pour que mon lecteur ne soit pas perdu. J’ai cru, sincèrement, honnêtement, que ces commentaires me permettraient d’avancer. J’ai envie, vraiment envie d’écrire des histoires que les gens aiment. Je réalise que mon obsession de perfection est en train de gâcher le plaisir que j’ai à écrire. Certaines personnes ne seront jamais contentes. Certaines personnes prendront toujours plaisir, planquées derrière leur ordi, à cracher sur le travail de plusieurs mois. »
Ainsi, cette jeune femme obéit aux directives de quelques lecteurs insatisfaits !
« J’ai cru, sincèrement, honnêtement, que ces commentaires me permettraient d’avancer » : au nom de quoi – et en vertu de quelles compétences – le lecteur devrait-il aider l’auteur à améliorer son écriture ? Il a acheté, lu, commenté son livre, que demander de plus ? Est-ce le rôle du chroniqueur ou du blogueur de pratiquer la pédagogie de l’écriture ? Sûrement pas. Ils donnent leur avis, partagent leurs impressions, mais n’ont pas du tout vocation à coacher l’auteur.
« Écrire des histoires que les gens aiment » : au pire, on peut interpréter cela comme le désir de produire des textes mercantiles ; au mieux, cela concerne ce qui est évoqué ensuite, « l’obsession de perfection », qui est louable sans réserve. Mais se perfectionner dans l’art difficile d’écrire n’a rien à voir avec plaire au plus grand nombre. En fait, ce serait plutôt l’inverse : plus on acquiert de maîtrise, plus on perd de lecteurs en chemin ! C’est pourquoi, en effet, « certaines personnes ne seront jamais contentes ».
Enfin est mentionné « le travail de plusieurs mois », une vraie rengaine chez les indés blessés, une plainte qu’il faut évacuer une fois pour toutes : le travail est indispensable (oui !), mais ne garantit aucune réussite (non !). Des auteurs talentueux ont travaillé des années pour aboutir à une production lamentable, ou excellente mais incomprise. C’est injuste, mais c’est ainsi. Nous échouons tous un jour ou l’autre. J’ai échoué. Vous échouerez. Point.
D’autres citations du même tonneau glanées sur les réseaux sociaux : « On peut ne pas aimer un livre, mais on n’a pas le droit de descendre un auteur gratuitement sans reconnaître le travail accompli ! » Ben si, on a le droit. Vous exigez le respect inconditionnel, même si le résultat est nul ou simplement médiocre ? Ça part d’une bonne intention, mais c’est inadéquat. Si vous ne voulez pas être jugé, ne publiez pas.
Ou encore : « Peu importent les imperfections, les fautes. Il faut respecter le travail de l’auteur ! » Sérieux, diriez-vous d’un menuisier qui vous livre une table de cuisine mal rabotée, dont les vis dépassent et dont les pieds sont de longueur inégale, que « peu importent les imperfections, il faut respecter son travail » ? Est-ce que vous le payeriez intégralement, vous résignant à avaler votre dîner de traviole toute votre vie, au risque d’une fausse route mortelle ? J’en doute.
Maîtriser son outil est la condition sine qua non de l’exercice d’un artisanat. Sans cela, que peut-on faire de valable ? Or la langue est l’outil de l’écrivain, comme la varlope ou la gouge sont les outils du menuisier. La maîtrise de la langue devrait être chez tous les aspirants auteurs un prérequis, un service minimum, la politesse due au lecteur – qui est aussi un acheteur !
Je vais donc vous livrer mon secret : ce qui fait vraiment progresser un auteur, c’est la lecture de bons livres* et la pratique régulière de l’écriture. Quoi, j’enfonce une porte ouverte ? Pourtant, certains indés ne semblent pas conscients que lecture et écriture sont les deux faces indissociables de la même activité, et qu’il faut avoir lu beaucoup de bons livres pour en un écrire un seul passable.
Il faut le répéter : la pédagogie de l’écriture, ce sont les grands écrivains qui nous la dispensent. Car ils sont nos mentors ; or on a besoin de mentors pour progresser, étant donné qu’on n’apprend que rarement de ses pairs. Tout bon artisan a été formé par son maître et a produit son « chef d’œuvre » avant d’exercer son métier. Le processus n’est pas horizontal, mais vertical…
Cornegidouille ! Quelle réac, cette Nila ! – Ciel, je suis démasquée… Tant pis, je m’en remettrai 😉 !
La pédagogie de l’écriture se trouve aussi dans l’accompagnement littéraire individuel et dans les ateliers collectifs d’écriture créative, autres types de mentorat. Je pratique les deux depuis 25 ans. Or un problème nouveau a surgi avec mes étudiants de licence ces dernières années (la fameuse génération Y) : ils rejettent l’idée d’une autorité assise sur la compétence et l’expérience professionnelle. Ils ignorent la notion d’expertise que, pourtant, ils ne songeraient pas à refuser en matière de gastronomie à, disons, un chef multi-étoilé au Michelin, tandis qu’ils la dénieraient sans hésiter au cuisinier d’un fastfood chinois. Et par conséquent, ils récusent ma légitimité à jauger leur génie naturel : « Comment pouvez-vous évaluer mes écrits ? C’est une question de goût ! Vous ne comprenez pas mon style, c’est tout ! »
Si leur goût était formé, cultivé, je pourrais entendre leurs objections… Si seulement ! Mais cette génération est convaincue qu’il n’existe aucun critère de distinction. La critique et ses critères de distinction, ils les rejettent en bloc, ne jugeant légitime que leur sacro-saint ressenti subjectif. Je suppose que ce n’est pas entièrement de leur faute, mais c’est très pénible pour leurs aînés de se retrouver confronté à cela. Leurs propos font écho à l’échange que j’ai eu avec une jeune indée :
« Elle : Dans ce domaine (la littérature), il est impossible d’être meilleur qu’un autre ! Il n’y a pas de mieux, il y a des genres différents, et c’est difficile de quantifier le talent.
Moi : Quantifier, non, mais qualifier, peut-être ? Dans tous les arts il y a des génies, des talents, des petits maîtres, des suiveurs, des truqueurs, des méconnus, voire des maudits… Dois-je comprendre qu’à vos yeux, Franz Kafka n’est pas meilleur que Guillaume Musso ?
Elle : Si vous posez la question à un fan de Franz Kafka (NDLR : certains indés ne font pas la différence entre lecteurs et fans) et à un fan de Guillaume Musso, vous obtiendrez deux réponses différentes. Chacun a son lectorat.
Moi : Donc, selon vous, tout est relatif, il n’y a pas de valeurs, de critères, de hiérarchie dans les œuvres. Tout se vaut, tout est une question de goût… Vous rendez-vous compte de la portée de cette opinion ? »
D’autres citations en vrac : « Il n’y a pas de bons ou de mauvais livres, il y a ceux qu’on aime et ceux qu’on n’aime pas. » « Ce qui compte, c’est le ressenti. » « Seul le public décide. » « Il n’y a pas de mauvais livres, il n’y a que de mauvais lecteurs. » (Médaille d’or de la démagogie.) « Je n’ai pas le temps de lire, j’écris. » « Je ne lis pas, j’aurais trop peur d’être influencé. » (Palme d’or de la c…ie.)
Je déteste le déclinisme, mais je constate que s’inspirer de l’exemple des aînés devient une injonction absurde et que notre société est en voie de déculturation. Non seulement la transmission du savoir est décriée, mais – comme je le lis ici ou là – elle représente une intolérable tentative d’oppression des « apprenants » de la part d’un être bardé de mépris de classe, bouffi de prétention, affecté d’un insupportable travers élitiste : le « sachant ».
Imaginons un instant que Papa Néandertal (le sachant) fasse une démonstration à Fiston Néandertal (l’apprenant) des techniques ancestrales pour chasser l’auroch. Et que Fiston (un rebelle) réplique à Papa : « Arrête de me gonfler avec ton savoir surplombant, ch’uis cap’ de l’faire tout seul ! » Auriez-vous parié sur ses chances de survie ?…
Olivier Bessard-Banquy s’alarme de cette évolution, lui dont les recherches portent « sur les tropismes grand public de l’édition littéraire, le développement du marketing dans les lettres, l’effondrement de la lecture savante, l’essor d’une industrie du divertissement au détriment des œuvres de l’esprit, le remplacement de la création par le traficotage des textes, et qui dénonce les travers de l’édition tradie, devenue une usine à textes négrifiés, standardisés ». Dans cet entretien, il affirme : « La qualité d’expression, la richesse de la langue ne sont plus un critère d’appréciation. Et puis globalement, collectivement, nous ne voulons plus des hiérarchies culturelles imposées d’en haut. Ce contexte a favorisé une explosion des littératures grand public qui fonctionnent sur la sempiternelle reproduction du même patron d’écriture, comme jadis les volumes Harlequin. »
Beaucoup d’autoédités sont affectés du syndrome Moi-aussi-je-m’appelle-Barbara-Cartland. Mais pourquoi seraient-ils épargnés par le contexte idéologique décrit plus haut ? D’autant qu’ils appartiennent à des milieux plus diversifiés sociologiquement que les auteurs tradis, pratiquent des métiers plus variés et vivent souvent dans des territoires éloignés des grandes métropoles. C’est l’une des caractéristiques que j’ai découvertes au cours de mon hybridation, et cela m’a ravie ! A contrario, l’édition tradie se cantonne à une sélection étriquée d’auteurs appartenant à des milieux plutôt favorisés et vivant à proximité de la capitale. Oui, j’ai applaudi à l’ouverture incroyable qu’apportait la dématérialisation des livres et de leur diffusion. Quelle bouffée d’air frais ! Quel potentiel de renouvellement ! Quelle énorme baffe pour les germanopratins consanguins !
Mais les innombrables daubes relâchées dans la nature par les indés ont refroidi mon enthousiasme. Elles sont la conséquence logique de l’abandon des mentors. Il ne s’agit pas uniquement du manque de maîtrise de la langue, des codes narratifs ou des règles ortho-typographiques ; il s’agit aussi du choix des thèmes et de leur traitement. Par candeur, par ignorance, par paresse, par appât du gain, certains indés redécouvrent sans cesse le fil à couper le beurre. Et leurs lecteurs, tout aussi naïfs et déculturés, ou parfois complaisants, de s’extasier devant tant d’originalité… Pourtant, je crois qu’on peut tout à fait écrire d’excellents livres destinés au grand public en étant un auteur plus averti, plus éclairé ! J’aurai sûrement l’occasion de vous en reparler.
* Dans un échange consécutif à ce billet, Martin Winckler me fait remarquer qu’il faut lire « toutes sortes de livres, bons ou mauvais, sérieux ou divertissants ». Il a mille fois raison, car c’est précisément ainsi qu’on se forme le goût, et c’est ce que j’ai fait pendant des années. De plus, dans les commentaires ci-dessous, l’idée de « bons livres » est souvent confondue avec celle de « classiques ». Ce n’est pas du tout ma conception, pour moi les bons livres sont de partout et de tout temps. D’autres l’interprètent comme « simultanément » : il faudrait lire pendant qu’on rédige ; et de dénoncer le risque d’être influencé malgré soi et de perdre son originalité – cela non plus n’était pas dans mon intention, je parlais en général. Mais ces malentendus permettent de nourrir un débat enrichissant.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Des chiffres et des lettres
Par Nila Kazar
#chiffresdeventes #classementdesventes #marathondécriture #segmentmarketing #Top100
Longtemps l’écriture de fiction littéraire m’a semblé incompatible avec toute notion de quantité, les « lettres » étant selon moi fâchées avec les « chiffres », pour faire référence à un ancien jeu télévisé à succès.

Pourtant, chez les auteurs indé, je suis frappée de constater que les chiffres jouent un rôle prépondérant. C’est logique, puisque certains d’entre eux essayent de vivre de leurs livres. D’ailleurs, le lâcher de chiffres en figures libres est un sport pratiqué par les auteurs tradi ; se vanter d’à-valoirs ou de tirages faramineux (et invérifiables) permet de déstabiliser ses rivaux à peu de frais en leur donnant des complexes.
Mais ici, ce qui m’étonne, c’est l’intervention du quantitatif dès la phase de rédaction.
Les marathons d’écriture du type NaNoWriMo (National Novel Writing Month – « the world needs your novel »), très populaires chez les indés, jouent peut-être un rôle dans cette tendance à transformer les gens de lettres en gens de chiffres. Je ne nie pas du tout que ces marathons, de même que les concours de nouvelles, puissent être un entraînement stimulant pour des auteurs qui, par exemple, disposent de peu de temps à consacrer à l’écriture. Je suis bien consciente qu’il s’agit de produire un premier jet, destiné à être retravaillé par la suite. Je ne méconnais pas l’aspect ludique de l’exercice. Mais je vois cette tendance à quantifier s’imposer partout, avec le comptage des mots écrits chaque jour.
Rappelez-vous que je viens de l’Ancien monde éditorial, et que je découvre les mœurs du Nouveau monde depuis seulement vingt mois. Forcément, je les compare avec ce que je connais depuis de longues années… Et je suis interloquée quand je lis sur Facebook des panneaux triomphants du type « Aujourd’hui j’ai enfoncé mes quotas » ou « 7644 mots, yeesss ! ». Même si je devine qu’il s’agit de rechercher une approbation, un encouragement à poursuivre ses efforts, et aussi de tenir ses futurs lecteurs en haleine devant le livre en voie de construction, ce qui ne me pose aucun problème (pas taper !). Cela m’étonne seulement.
D’abord parce que, si dans la journée j’ai écrit deux pages, voire une seule dont je sois assez satisfaite pour ne pas la détruire, je m’estime heureuse. Il est évident que cette page sera retouchée plusieurs fois par la suite, mais enfin, j’ai avancé dans mon travail. Et je n’éprouve jamais le besoin de compter les mots sauvés de la hache impitoyable de la réécriture.
En outre, le quantitatif me semble incompatible avec le qualitatif quand il s’agit d’écrire de la fiction. « Je n’ai pas eu le temps de faire court », s’excusait déjà Blaise Pascal… Pour moi, la beauté de la langue française réside dans sa clarté, sa concision, sa précision, son horreur de la répétition. Dire beaucoup en peu de mots, voilà l’idéal que j’ai adopté. Vous n’êtes pas obligés de me suivre sur ce terrain, d’autres esthétiques sont possibles et respectables. Mais moi, je me tromperais d’objectif si je recherchais la productivité.
Petit détail : en France, l’édition a l’habitude de calibrer les textes en signes-espaces, le décompte en mots est un usage américain, diffusé par les logiciels de traitement de texte. Ainsi, chez nous le traducteur est rémunéré au nombre final de signes et espaces dans la langue-cible, le français.
Un autre chiffre mis en avant est celui des commentaires obtenus sur les sites de vente en ligne. Chaque nouveau commentaire est relayé par l’auteur sur les réseaux sociaux en précisant son rang ordinal, même si c’est le centième, dans l’intention d’entretenir la flamme du lectorat, et d’ajouter du crédit (social proof) à la qualité ou à la popularité de son ouvrage. (Je prévois d’écrire un billet à part sur les commentaires, pour l’instant je m’en tiens à l’angle des chiffres.) Dans le même but, le nombre d’étoiles attribuées est systématiquement brandi.
Attention, je ne juge pas ces nouvelles pratiques. Ce serait idiot, puisque je les imite moi-même ! Quand on devient un auteur virtuel, qui tâche de se faire connaître uniquement par des voies dématérialisées, il n’y a guère d’autre façon de s’y prendre. Mon seul objectif dans ce billet est de m’arrêter pour y réfléchir avec vous, et de me demander si elles ne nous entraînent pas dans un effet « lessiveuse » qui finit par tourner à vide. Le danger est d’en devenir l’otage, d’être dopé aux chiffres, obsédé par la concurrence — au point de tomber dans le trafic de commentaires payants et/ou de complaisance, avéré dans certains cas.
Dans le registre de la quantification tous azimuts, n’oublions pas les chiffres de ventes fournis quasiment en temps réel. Il nous arrive à tous de les scruter compulsivement à certaines périodes-clés : lancement d’une nouveauté, baisse provisoire du prix, offre groupée, chronique de blog influent, etc. Cette transparence est apparue il y a peu, l’édition tradi ne fournissant de chiffres de ventes (pas toujours aussi sincères qu’ils le devraient !) que tardivement et de mauvaise grâce, pour éviter d’avoir à rendre des comptes et à verser des droits. Je la trouve libératrice, et c’est une véritable avancée pour l’autonomie et la professionnalisation des écrivains qui, dans l’édition tradi, sont trop souvent maintenus dans un état d’ignorance infantilisant.
J’avoue que le classement des ventes (charts), lui aussi fourni en temps réel, me rappelle un peu celui des élèves à l’école primaire d’antan — les étoiles pouvant tenir lieu de « bons points ». Entrer dans le Top 100 représente le Saint Graal pour beaucoup d’indés, et ils se désespèrent dès que leurs courbes se tassent, cherchant fébrilement le remède pour regagner quelques rangs. Certains n’hésitent pas, me souffle-t-on, à solliciter leurs amis pour l’achat de livres aussitôt remboursés par eux-mêmes en sous-main, l’une des manières de manipuler le classement. Voyons, les minous, ce procédé est indigne de vous… Par contre, demander à vos potes d’acquérir pour de vrai votre livre le même jour, en tir groupé, est tout à fait digne 😉 !
En augmentation constante également, le nombre de segments marketing de l’industrie du livre, avec ses micro-niches qui se déclinent à l’infini, par exemple dans le genre à la mode de la romance, ou dans celui de la Fantasy-SF. Au cours des années 2000, on pouvait observer l’amplification de ce phénomène d’hyper-segmentation dans le secteur florissant de la littérature de jeunesse, avec en quatrième de couverture des mentions du style « recommandé pour les lecteurs de 6 ans ½ à 8 ans ¾ » qui me laissaient perplexe. Aujourd’hui cette expansion s’accentue dans l’indésphère.
De plus, par un effet pervers, les auteurs y sont poussés à publier beaucoup et souvent, car les ventes sur leurs anciens titres repartent quand ils sortent une nouveauté. C’est le fameux effet boule-de-neige (compound). Bien sûr, l’impératif de rentabilité s’impose quand on tente l’aventure risquée de vivre de sa plume. Publier beaucoup, cela peut signifier vider ses tiroirs déjà pleins de textes de qualité ; mais cela peut aussi signifier écrire trop vite… et mal, faute de maturation suffisante de l’œuvre. C’est un véritable piège, celui de l’inflation de titres, dans lequel l’édition tradi se vautre depuis des lustres.
Non loin de la notion de quantité, déplaçons un moment notre réflexion sur celle de compétition, qui inclut aussi le désir de battre un record, ou de battre un rival. J’aimerais partager avec vous ma conviction que l’écriture littéraire, en tant qu’art, ne doit en aucun cas être prétexte à compétition, car celle-ci est antinomique avec toute idée de création. Je crois sincèrement que le secret, quand on se mêle d’écrire, c’est de ne pas se comparer à autrui. On creuse tranquillement son sillon, on encaisse de bonne grâce les coups du sort, on se relève et on continue. C’est tout et c’est déjà beaucoup !
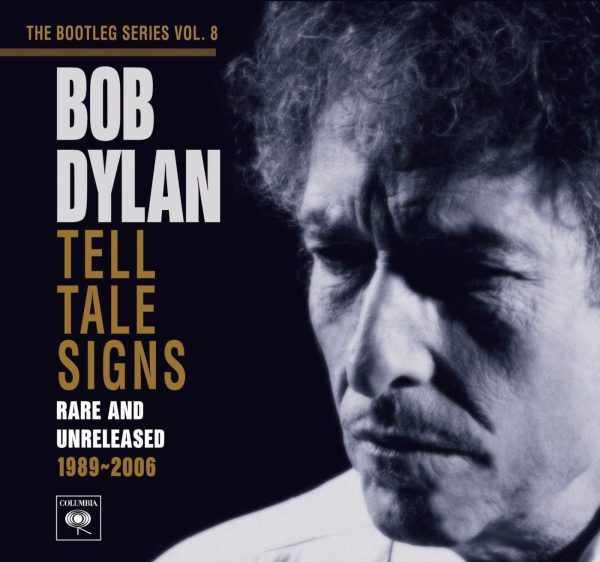 Dans une interview, le nobélisé Bob Dylan cite l’un de ses maîtres, un bluesman, au sujet de la bonne attitude à adopter dans le métier de musicien : « No fear, no envy, no meanness », lui dit celui-ci. « Pas de crainte, pas de jalousie, pas de mesquinerie… » À mon avis, ce conseil marche aussi pour les écrivains.
Dans une interview, le nobélisé Bob Dylan cite l’un de ses maîtres, un bluesman, au sujet de la bonne attitude à adopter dans le métier de musicien : « No fear, no envy, no meanness », lui dit celui-ci. « Pas de crainte, pas de jalousie, pas de mesquinerie… » À mon avis, ce conseil marche aussi pour les écrivains.
Alors, si on laissait un peu tomber les chiffres pour nous concentrer sur les lettres ?
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Clichés et stéréotypes
Par Nila Kazar
#autoédition #numérique #indé #romance #thriller #avantgarde
Longtemps j’ai cru que le Nouveau Monde éditorial, avec ses pratiques émergentes – hybridation auteur traditionnel/autoédité, dématérialisation des supports, communication sur les réseaux sociaux, relation directe auteur/lecteur –, ouvrirait la voie à une littérature nouvelle, audacieuse, non-formatée.
Un éditeur de mes amis, que j’initiais aux merveilles de ce Nouveau Monde (il y en a, mais ce n’est pas l’objet de ce billet), s’est déclaré « impressionné par mes résultats ». Il faut préciser que, bien qu’il ne soit pas un débutant (il a 45 ans), pour lui « le numérique reste une sorte de continent inexploré » ; ce qui est, je le crains, très répandu dans l’édition tradi. Lui-même n’est pas du tout présent sur les réseaux sociaux, c’est vous dire l’archaïsme du mec… Je le cite, parce qu’il sait aussi être drôle :
« Le numérique me fait penser aux templiers. Petits groupes, petites actions, et peu à peu tout cela prend de l’ampleur. Sauve qui peut du côté des grands pouvoirs, il va falloir exterminer. D’ici à ce que les chevaliers du numérique ne menacent de racheter Gallimard… De quoi produire une nouvelle d’anticipation qui pourrait être amusante ! »

Mais quand je reverrai cet ami, je serai sans doute obligée de lui dévoiler les côtés moins réjouissants de ce Nouveau Monde éditorial. J’ai suffisamment dénoncé les travers de l’Ancien Monde dans mes billets précédents pour m’accorder une totale liberté de critique de celui-ci, que je côtoie depuis 18 mois. Et tant pis pour ma popularité !
Rêvons un peu : on aurait pu imaginer que l’ « indésphère », comme on appelle maintenant les autoédités, serait le nouveau vivier de l’avant-garde, de la contre-culture, de la fiction alternative, de l’expérimentation. Qu’elle serait le refuge des écrits non-calibrés d’auteurs déviants. Un lieu d’exposition pour la partie immergée de l’énorme iceberg littéraire qu’évoque ici P. Jourde. Bref, une sorte de Salon des refusés foutraque et jouissif (« ce Salon est une illustration de l’émergence d’une modernité artistique, en opposition avec le goût officiel », selon Wikipédia), où il serait possible de déployer toute son audace, de même que les Impressionnistes ont retourné en leur faveur ce qui, au départ, était un mot de dérision de leurs adversaires, et l’ont érigé en nouveau courant pictural.
Par parenthèse, voir ses manuscrits refusés n’a rien de déshonorant. Vous pouvez à ce sujet consulter mon billet sur le refus d’éditer, qui se trouve au premier rang des visites de ce blog. Cela arrive aussi aux auteurs chevronnés, dans un contexte où l’édition est de plus en plus prudente dans ses choix, recherchant une rentabilité rapide, ciblant le mainstream (ou grand public) et crachant à une cadence industrielle des lavres (définition : le lavre est au livre ce que la musaque est à la musique) dotés de la durée de vie d’un protozoaire et, hélas, de la même capacité de réplication. Sauf que les protozoaires, au moins, dépolluent les milieux, alors que les lavres, eux… Bref ! Revenons à nos moutons.
Je ne parle pas ici des revues littéraires gratuites, qui assument en partie ce rôle de défricheur mais restent très confidentielles. Dans le secteur des écrits commercialisés en ligne, c’est le contraire de ce que j’imaginais qui est arrivé. Certes, quelques « indés » s’illustrent bravement dans le Nouveau Monde. Ainsi, Céline Barré ou Aloysius Chabossot renouvellent l’humour d’Alphonse Allais ; Frédéric Soulier reprend le style rabelaisien de Frédéric Dard en le mâtinant de Bukowski ; Chris Simon applique au livre le principe de la série audiovisuelle. Ces auteurs naviguent avec talent dans des niches auxquelles l’édition tradi ménage peu de place. Bien sûr, on trouve des perles dans tous les genres parmi les livres autoédités au format numérique. Mais pratiquement rien de vraiment subversif.
Merci de ne pas déclencher tout de suite l’hallali, patience, je vais vous fournir très vite davantage de raisons de le faire 😉 !
La majorité des indés ne fait souvent que reprendre les vieilles recettes éculées du succès ; que débagouler à satiété des sous-sous-produits du mainstream. Fascination pour les pseudonymes ou les noms de personnages à consonance américaine, titres banals qui ont traîné partout, ficelles simplistes, retournements téléphonés, exposition dès la première page de la philosophie que le récit va ensuite tenter d’illustrer, prêchi-prêcha omniprésent (le syndrome Paulo Coelho)… Il n’est question que de « destin, d’âme, de serment, de cœur, de malédiction, de passion » (« écrire est une passion », cette phrase me fait empoigner mon fusil à pompe sur-le-champ, de même que « lire est une évasion » – vous voilà prévenus). L’auteur s’y transforme en dealer d’émotions, came très prisée des indés et apparemment de leurs lecteurs, comme on le voit dans les quatrièmes de couverture et les commentaires.
Juste une petite question à ceux qui se vautrent dans ces stéréotypes : pourriez-vous me dire ce qu’est, ou a été, ou sera, votre destin à vous ?
Non ?
…
Ben voilà.
Cornegidouille, mes amis, la VIE (vous savez, la vie ?) est tellement plus vaste, complexe, inattendue, contradictoire, décevante, renversante que ça ! Or la tâche du roman ne serait-elle pas de nous proposer un reflet de la vie, passé au filtre de notre subjectivité, de notre expérience, de nos moyens artistiques ? (Désolée d’enfoncer une porte que je croyais ouverte, à tort apparemment.) Actionner à tout bout de champ l’interrupteur « émotion », c’est un peu comme quand le marteau du médecin teste vos réflexes. C’est déclencher un automatisme. Trop facile…
Mais ça marche ! C’est pourquoi les 80 premiers titres du Top 100 d’Amazon sont des romances (ou romans sentimentaux) : Harlequin über alles, and Mrs Feelgood takes all the rest. Bon, il y a bien quelques excellents polars qui cartonnent, soyons juste… Et la nature commerciale du diffuseur explique en grande partie cet état de fait. Mais notre devoir, auteurs indépendants, ne serait-il pas justement de tenter de repousser 1. nos propres limites créatrices, et 2. les limites de la fameuse plateforme commerciale par la même occasion ? La fiction est un territoire sans frontières, où chaque auteur a le droit, le pouvoir et la liberté d’explorer des formes inconnues, des thèmes inédits. Pourquoi ne pas user de ce privilège insensé ?
Je m’interroge. Parce que je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. J’ai gobé quelques-uns de ces sucres d’orge, j’ai bu de cette eau-de-rose insipide. Je m’ennuyais atrocement, la tablette me tombait des mains. Et je me suis demandé pourquoi tant de gens en consommaient.
Parce que, tout de même. Dans l’univers unidimensionnel des lavres, « un jour mon prince viendra, le passé finit toujours par nous rattraper, ce jour-là tout a basculé, tu tombes sept fois tu te relèves huit ». Les personnages y apprennent « que l’amour peut arriver par surprise ou mourir en une nuit ; que de grands amis peuvent devenir de parfaits inconnus, et qu’au contraire, un inconnu peut devenir un ami pour la vie ; que celui qui veut, peut et y arrive… » Aarrrggh !
J’ai besoin d’une tisane Sérénité, là.
Un soupçon de réponse à ma question a fini par s’esquisser : le succès de l’attendu, du convenu pourrait peut-être trouver sa source dans le plaisir qu’ont les enfants à entendre raconter chaque soir la même histoire conventionnelle, hypercodifiée, ne souffrant pas la moindre modification, dont le dénouement procure un sentiment d’accomplissement, de plénitude… Dans ce cas, l’acte de lire serait avant tout destiné à rassurer, à conforter les croyances, à consolider les repères. Mission que remplissent aussi les blockbusters au cinéma – appelons-les falms.
Faut-il croire que nombre d’adultes sont restés (en partie du moins) infantiles ? Serions-nous donc des mômes qui auraient besoin, avant de s’endormir, qu’on leur resserve encore et toujours la même lavasse, la même distraction mécanique, à mille lieues du miroir de la vie que devrait être la fiction littéraire ?
À part les romances, dans l’indésphère on trouve aussi beaucoup de thrillers qui rivalisent de noirceur et de perversité, dans une surenchère sanglante et gore : « une descente au plus noir de l’âme humaine », nous promet un avis de parution. Là, la méthode semble être non plus le marteau réflexe des émotions, mais plutôt le gourdin franc et massif du néandertalien : on cherche à vous estourbir sous le faix de l’horreur. Yep. Mais vous croyez vraiment qu’en débitant les pucelles vivantes en tranches plus fines que chez l’auteur d’à côté, la littérature y aura gagné quelque chose ?
Laissez-moi vous révéler un truc, mes minous jolis : le monde des humains est gris. Avec des ombres, des contrastes, des trouées de lumière – mais gris, en général. Et seules les infinies nuances de ce gris (sans jeu de mots avec Truc) valent la peine d’être décrites dans un livre. Ah, sûr, c’est vachement plus difficile que de recourir au premier cliché venu. Ça demande beaucoup plus de travail et de maturation. Mais après tout, « sortir de notre zone de confort », n’est-ce pas précisément ce que toutes les daubes de développement personnel nous recommandent ?
Les lavres sont-ils le fruit du choix inconscient d’auteurs qui écrivent dans la veine de ce qu’ils aiment lire eux-mêmes ? Sans doute, mais pas toujours. Puisque les vieilles recettes éculées garantissent un minimum de succès, puisque les lecteurs peu exigeants recherchent sans cesse les mêmes stimuli, détestant être déroutés, pourquoi prendre des risques ? Davaï, fourguons-leur encore une fois ce vieux chewing-gum mâché et remâché, enrobé dans le si rassurant prétexte de la lecture-évasion. Flattons la paresse et l’incuriosité du lectorat, et faisons-nous un peu de fric facile sur son dos… En somme, imitons tout ce que nous reprochons à l’édition tradi !
Là, je pense que le moment de l’hallali est arrivé.
OK. Ça va mieux ?
Chacun agit comme il veut ou peut. Je ne juge pas. Je donne simplement mon avis.
Moi, j’ai juste envie qu’un livre m’emmène là où je n’ai pas prévu d’aller, et pas dans des stéréotypes usés jusqu’à la corde. J’adore l’humour, et surtout l’ironie ; mais je veux être prise au sérieux en tant que lectrice. Pas qu’on me refile une came fadasse qui, même au tarif de 2,99€, ne les vaut pas.
Parce qu’elle m’empoisonne à petit feu, en loucedé.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Les Lettres Kazares
Par Nila Kazar
#promotion #autopromotion
Vous avez détesté les Lettres Persanes de Montesquieu ? Vous allez adorer les Lettres Kazares 😉 ! Elles commencent là où finit leur modèle. Après un long séjour en Occident, le héros, Usbek, est rappelé d’urgence en Perse à la suite de la révolte des femmes de son sérail et du suicide de sa favorite, Roxane. Mon héroïne, une esclave kazare, est alors affranchie par son maître et prend à son tour le chemin de l’Occident. Elle aime écrire et se passionne pour la littérature. Comme Usbek, elle va explorer « avec l’œil du Persan » – c’est-à-dire un regard faussement naïf, qui permet de critiquer sans blesser – les pratiques émergentes de l’édition : nouvelles technologies, dématérialisation des supports, rôle des réseaux sociaux. Ses conceptions traditionnelles en seront bouleversées. J’ai retrouvé ses lettres à Usbek, les voici.
Mon cher Usbek,
Ô toi, Seigneur admirable qui m’as délivrée du Sérail d’Ispahan où je mourais d’ennui avec mes compagnes, subissant le joug inflexible de tes eunuques ; toi qui, après la perte de l’Incomparable Roxane, le cœur plein d’affliction, as compris que la mansuétude valait mieux que la coercition, sache que me voici arrivée en cette contrée du Couchant que l’on appelle aussi Occident.
Moi, l’humble esclave venue de Kazarie, tu m’as affranchie et donné un serviteur, le fidèle Rustan, pour qu’il me protège dans les pérégrinations que j’ai entreprises sur l’autre versant des Mondes. Je veux avant toute chose te dire ma gratitude, ô Usbek. Je t’appartiens plus que jamais, puisqu’en me rendant ma liberté, tu m’as permis de te choisir librement pour amant.
Tu le sais, je suis venue en ce pays avec le désir de connaître tout ce qui tourne autour des livres imprimés et de leurs avatars que l’on nomme « ibuks ». Tantôt éblouie, tantôt affligée, je me trouve parfois si étrangère à ce Nouveau Monde que les mots se dérobent. Aussi, pardonne si j’aborde les sujets sans ordre établi, et passe pour plus sotte encore que lorsque j’étais enfant et vivais sur les rivages de la Mer que vous, Persans, appelez Mazandaran.
En vertu de tes conseils, j’avance masquée en terre chrétienne, mais non voilée, puisque cela me désignerait à l’attention de tous, contrariant la discrétion et la modestie dans lesquelles ma mère m’a élevée. Sous un nom d’emprunt, en habits nobles, je marche de surprise en étonnement, moi qui dans le Sérail n’avais qu’à me conformer à la routine commune, sans chercher à me distinguer aux yeux des savants et des lettrés.
Au Palais, point n’était besoin de faire sonner les cymbales pour accompagner les premiers pas d’un livre. Nous écrivions dans nos chambres et nous nous lisions entre nous. Une saine émulation nous incitait à inventer les contes les plus merveilleux, et cela suffisait à notre bonheur. Les copistes faisaient copie de nos meilleures histoires afin qu’elles passent de main en main. Ainsi la réputation de quelques-unes de tes femmes pouvait outrepasser les murs du Sérail, et même, parfois, l’écho de leur nom se répandre jusqu’à ta descendance.
Mais dans la société que je fréquente à présent – celle même que tu as décrite dans tes Lettres illustres –, si une dame ou un gentilhomme néglige de disperser aux quatre vents des éloges sur son propre ouvrage au moment où il sort des presses, personne ne s’en soucie et il sombre immédiatement dans les ténèbres de l’oubli, comme s’il n’avait jamais été écrit. N’est-ce pas abominable ?
Ici les hérauts et les gardes champêtres sont remplacés par d’invisibles messagers ailés qui ont pour nom « rézo-zoziaux », ou quelque chose d’approchant. Mon oreille est encore trop peu faite à la langue des Francs pour transcrire fidèlement des termes si étonnants. Rézo me rappelle le prénom Réza et cette ressemblance m’aide à retenir le reste, qui évoque le chant du rossignol dans les jardins suspendus d’Ispahan.
Grâce à ces messagers, l’auteur d’un livre annonce partout sa parution et s’efforce d’attirer le plus d’acheteurs possible. N’est-ce pas là un usage des plus ébahissants ? Mais l’on prétend que les publicistes et les gazetiers littéraires, dont c’était jadis la tâche de vanter les bons ouvrages, ont quasiment disparu de la terre, comme cette espèce d’oiseau appelée dodo qui vient de s’éteindre, à ce que rapportent les voyageurs. Et que les éditeurs, dont c’est pourtant le métier de vendre les livres, ne font plus d’efforts en ce sens, mis à part pour quelques rares élus. Ils lancent les nouveautés au hasard dans le marigot des librairies, les laissant se battre entre elles pour ne conserver que celles qui ne se seront point noyées. Quelle cruauté pour les infortunées !
possible. N’est-ce pas là un usage des plus ébahissants ? Mais l’on prétend que les publicistes et les gazetiers littéraires, dont c’était jadis la tâche de vanter les bons ouvrages, ont quasiment disparu de la terre, comme cette espèce d’oiseau appelée dodo qui vient de s’éteindre, à ce que rapportent les voyageurs. Et que les éditeurs, dont c’est pourtant le métier de vendre les livres, ne font plus d’efforts en ce sens, mis à part pour quelques rares élus. Ils lancent les nouveautés au hasard dans le marigot des librairies, les laissant se battre entre elles pour ne conserver que celles qui ne se seront point noyées. Quelle cruauté pour les infortunées !
Les écrivains n’ont par conséquent d’autre choix que de se lier personnellement à leurs lecteurs. Ce faisant, hélas, ils ressemblent à ces bateleurs de foire que j’ai vus devant la Grande Mosquée sur la place du Beau-Bourg, qui crachent le feu et marchent sur du verre pour attirer le chaland. « Approchez et regardez, gentes dames et beaux messieurs : ici mieux qu’en face ! Il est frais mon ibuk, il sent bon ! » N’est-ce pas étrange de faire soi-même l’éloge du fruit de veilles arides et d’efforts désintéressés ? Nombre d’auteurs raffinés répugnent à l’exercice, se plaignant d’être de piètres commerçants. Ils protestent que le Bazar n’est pas un lieu qu’ils désirent fréquenter, lui préférant de loin leur tour d’ivoire. Et je dois t’avouer, mon Bien-Aimé, que je les comprends. S’il me fallait vendre à la criée les poèmes que ta Grandeur m’a inspirés, je crois bien que je périrais de honte.
J’ai encore observé que, sur les rézo-zoziaux, les auteurs prient des inconnus de déclarer leur flamme à une page marquée de leur effigie. Comment peut-on mendier ainsi l’amour ? Cela ressemble à de l’idolâtrie et va à l’encontre de la pudeur. Comme je n’aime que toi, Usbek, je me garde bien de répondre aux invites de cette sorte et d’en lancer moi-même. D’ailleurs à quoi cela sert-il en vérité ? On m’a expliqué qu’une profusion d’amants désincarnés accroissait la réputation d’un écrivain, quand bien même aucun ou presque n’aurait lu ses livres. Cela dépasse l’entendement. Comment peut-on s’éprendre d’un auteur qu’on n’a pas lu ? Et ils sont si nombreux que plusieurs réincarnations n’y suffiraient pas.
Je sais que ma disparition est le sujet de toutes les conversations d’Ispahan. On ne peut comprendre que tu m’aies laissée la quitter pour aller dans des climats inconnus aux Persans. Mais ma mère est morte et plus rien ne me retient dans la Cité des Roses, sauf tes grâces et ta faveur, ô mon Seigneur. Je tâcherai de t’écrire souvent. Adieu. Aime-moi toujours.
Ta fidèle Kazare
À Paris, en l’an 2020
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Trois bons souvenirs de l’Ancien monde éditorial
Par Nila Kazar
Une fois n’est pas coutume, j’attaque ce billet autrement que par mon gimmick favori : « Longtemps je… ». Il se compose de deux parties : un petit bilan d’étape, au bout d’un an d’exploration du Nouveau Monde numérique ; et une partie qui m’a été inspirée par l’une de mes précieuses abonnées, Selma B., que je remercie. Elle a remarqué que l’industrie du livre telle que je la décrivais dans ce blog était impitoyable, et qu’elle ne regrettait pas de ne pas avoir frappé à sa porte. Quoique la critique d’un système à bout de souffle soit l’objet essentiel de mes articles, ainsi que l’indique le sous-titre « Y a-t-il une vie après l’édition ? », cela m’a donné envie de terminer l’An Un de ma réinvention personnelle par une sélection de quelques bons moments que j’ai vécus dans ce milieu. Attention, ces moments ne sont pas tous « cool » ou « sympas » ! Ils peuvent prendre la forme d’une jouissance maligne tout autant que d’un bonheur désintéressé. Vous êtes prévenu.e.s…
Pour commencer, la vie du blog :
En moins d’une année, Bazar Kazar a recueilli environ 13.000 lectures réparties sur 15 billets et s’est constitué une liste d’une grosse quarantaine d’abonné.e.s, ce qui est modeste mais pas ridicule. Je n’ai pas fait beaucoup d’efforts de promotion, à vrai dire. Parmi les abonné.e.s, je m’honore de compter d’excellents écrivains et des journalistes remarquables. Les billets les plus lus ont été « Le refus d’éditer » et « Faut-il coucher pour être publiée ? », on se demande bien pourquoi 😉 . Ce dernier billet a été repris sur la plateforme L’Obs-Le Plus, où il a touché 7.130 lecteurs supplémentaires.
Les nombreux commentaires du blog sont de grande qualité, enrichissant le débat et m’amenant à affiner ma réflexion, ce qui me comble de joie. En 2017 je prévois de faire évoluer les thèmes vers ma découverte du Nouveau Monde numérique, et j’anticipe des réactions moins consensuelles. Mais je suis une dure à cuire – c’est conseillé quand on s’expose !
Côté publications numériques, mon expérience reste récente puisqu’elle commence il y a 7 mois seulement. Il est un peu tôt pour tirer un bilan de ma démarche d’hybridation, mais pas pour me réjouir d’en cueillir les premiers fruits. Je veux dire M E R C I à ceux qui ont aimé mes nouvelles et l’ont exprimé en des mots qui m’ont émue. Grâce à votre curiosité et votre générosité, l’un de mes principaux objectifs en repartant de zéro avec un pseudonyme et des couvertures purement typo – toucher un nouveau lectorat – se rapproche. Vous l’ignoriez sans doute, mais vous êtes des pionnier.e.s !
Des chiffres ? 19 commentaires positifs et une superbe vidéo (à voir ici, merci à Dominique Lebel) sur Les Rivières fantômes, et 5 commentaires positifs sur Le Manuscrit et la mort (voici l’un d’eux, « La grande littérature n’est pas morte » dû à Catherine Choupin) qui vient de sortir, c’est plus que je n’osais en espérer. Les ventes ? Pour le premier, 150 exemplaires jusqu’à présent (je ne compte pas les emprunts, trop fastidieux !). Je suis consciente que c’est peu, mais d’un autre côté, dans la mesure où ce livre n’aurait jamais trouvé sa place chez Machin (= l’éditeur français type, qui rejette les nouvellistes dans un réflexe pavlovien), c’est un succès relatif. Et le genre de la nouvelle de litt’gén’ n’est pas ce qui se vend le mieux en numérique, c’est clair.

 Je compte sortir prochainement une version papier qui réunira les deux recueils, et je retravaille en ce moment la quatrième mouture d’un roman sur un sujet pas convenable qui risque de fâcher la moitié de son lectorat potentiel (je m’en réjouis d’avance !). Si vous deviez faire pleuvoir sur celui-ci des critiques cinglantes, cher.e.s lecteurs/trices, je vous dirais encore merci d’avoir pris le temps de me lire et de communiquer vos impressions aux autres. Cette absence de filtre entre l’auteur et ses lecteurs, voilà ce qu’il y a de plus nouveau pour moi dans ce Nouveau Monde. Et j’apprécie infiniment ! Vous me redonnez foi en moi-même. Grâce à vous, je me sens confortée dans mon inspiration.
Je compte sortir prochainement une version papier qui réunira les deux recueils, et je retravaille en ce moment la quatrième mouture d’un roman sur un sujet pas convenable qui risque de fâcher la moitié de son lectorat potentiel (je m’en réjouis d’avance !). Si vous deviez faire pleuvoir sur celui-ci des critiques cinglantes, cher.e.s lecteurs/trices, je vous dirais encore merci d’avoir pris le temps de me lire et de communiquer vos impressions aux autres. Cette absence de filtre entre l’auteur et ses lecteurs, voilà ce qu’il y a de plus nouveau pour moi dans ce Nouveau Monde. Et j’apprécie infiniment ! Vous me redonnez foi en moi-même. Grâce à vous, je me sens confortée dans mon inspiration.
C’est aussi le début d’une démonstration que j’espère poursuivre en votre compagnie : ce n’est pas forcément parce qu’on est nul qu’on se tourne vers l’auto-publication (scoop !), mais – entre autres raisons – parce que certains canaux sont bouchés dans un milieu sclérosé, obsédé par la rentabilité, et « fort satisfait de lui-même » (je cite un ami éditeur). Ainsi c’est vous, cher.e.s inconnu.e.s d’hier, qui me fournissez la preuve concrète de l’aveuglement germanopratin. Si un jour je devais m’en servir auprès de Machin, je ne manquerais pas de vous tenir au courant de ses réactions ! (Je rappelle à ceux/celles qui me découvrent que j’évolue depuis longtemps dans l’édition tradi, pour leur éviter la méprise d’une internaute qui m’a suggéré « d’arrêter de délirer sur les maisons d’édition » 😉 )
À présent, quelques souvenirs plaisants de l’Ancien Monde éditorial :
Curieusement, le succès précoce de la principale entreprise de ma vie – écrire et publier de la fiction littéraire – n’a pas été un grand moment de bonheur. Peut-être parce qu’arrivé trop vite, sans que j’aie eu le temps de le désirer longtemps ni de lutter beaucoup pour l’obtenir, je n’ai pas su attribuer sa juste valeur à ce petit miracle de facilité, qui ne s’est pas renouvelé par la suite, en vertu de sa nature volatile de miracle. Je l’ai trouvé tout naturel, en fait. (Oui, je confirme, on est con à 20 ans…) Si l’on ajoute que mon entourage familial n’a marqué aucun enthousiasme, mais plutôt de l’ennui à l’idée que se réalise aussi vite mon rêve d’enfant de devenir écrivain, on comprendra que j’aie été incapable de prendre la mesure de la chance qui m’était échue.
C’est pourquoi les moments que je vais évoquer se situent plus tard dans un parcours qui, au fur et à mesure, se teintait d’une conscience accrue des dures réalités de la condition d’écrivain et de la place marginale que ce dernier occupe dans l’industrie du livre. Je dis bien « marginale »…
- L’orgasme bref de l’insolence et l’orgasme long de la revanche :
J’ai un grand défaut : j’ouvre trop ma gueule. C’est déjà mal vu chez un homme, mais chez une femme, c’est tout simplement exclu. Oh, je suis rarement grossière ! Mais je dis ce que je pense quand je le juge nécessaire… ou quand je perds le contrôle de la situation. Illustration.
Scène Un : Je suis encore très jeune, et j’ai rendez-vous avec le nouveau PDG du Seuil, Claude Cherki, au sujet de mon dernier manuscrit. Je suis sous contrat avec la maison, mais je n’y ai plus d’interlocuteur désigné et cela m’inquiète. Qui me lira ? Cherki me reçoit avec une demi-heure de retard. Quand j’entre dans son bureau, il est assis sur un canapé, en train de lire le Monde des Livres (ce doit être un jeudi par conséquent). « Vous permettez ? » dit-il. Ai-je le choix ? J’acquiesce. Il lit encore pendant un quart d’heure. Enfin il va s’asseoir derrière son bureau encombré de paperasses en désordre. Son prédécesseur était un modèle d’ordre et de rectitude, toujours à l’heure. Je fais une remarque humoristique au sujet de l’état du bureau, puis j’aborde le sujet de l’entretien. Nous sommes interrompus trois fois par des gens à qui le PDG accorde au moins cinq minutes chacun. Je perds le fil de mon discours et à l’arrière-plan je sens que la messe est dite : il veut me virer. C’est là que je deviens ouvertement insolente et me moque des dernières parutions romanesques de la maison, disant à quel point je ne m’y reconnais plus. Orgasme devant sa mine déconcertée. C’est très bref et je le payerai très longtemps. Quand l’entretien s’achève, rien n’a été abordé à fond et d’ailleurs rien ne sera jamais décidé. Cherki laissera pourrir la situation pendant des mois, sans me donner de réponse. Jusqu’à ce que je m’en aille paître sous d’autres cieux.
Scène Deux : Dix ans plus tard, le même Cherki me rachète comme auteur sous pseudonyme et me signe un autre contrat en tant que dirdecol (= directrice de collection). Je n’ai jamais levé le petit doigt pour obtenir cela, évidemment. On a sa fierté. Cette fois, l’orgasme dure plus longtemps : il porte le doux nom de revanche.
- Le plaisir rare de voir son talent reconnu par quelqu’un qu’on admire :
Je remets une traduction à un grand monsieur de chez Gallimard, l’éditeur Jean-Bertrand Pontalis, co-auteur du célèbre manuel de référence sur la psychanalyse familièrement désigné sous le nom de Laplanche et Pontalis. Il me dit : « Ah ! si je pouvais n’avoir affaire qu’à des gens comme vous, ce serait merveilleux. Vous tenez vos engagements et il n’y a rien à reprendre dans votre travail. Merci ! » Je ne vous fais pas un dessin, je suis rouge comme une pivoine et je balbutie bêtement : « De rien. » Ce plaisir-là est profond et crée une sorte de foyer lumineux dans la mémoire, vers lequel on peut revenir quand la déprime vous accable…
- Le bonheur inattendu de découvrir qu’une transmission a eu lieu :
Donc, me voici dirdecol. Je reçois un auteur à qui j’ai communiqué auparavant mes remarques en vue de retravailler son manuscrit. Il me dit qu’il est d’accord avec la moitié seulement de ce que je suggère. Je suis assez satisfaite du ratio. Ensuite il ajoute que mes remarques l’ont beaucoup agacé, car il avait l’impression d’être arrivé au bout de ses efforts quand il m’a remis le manuscrit. C’est normal, je ressentirais la même chose à sa place. Et il conclut en disant que son agacement n’a pas duré, car mes conseils et mon niveau d’exigence lui rappellent ceux de son premier dirdecol. « Qui était-ce ? » demandé-je. Et l’auteur de citer le nom de… celui qui fut aussi mon premier dirdecol.
Quelle merveilleuse surprise : une transmission a eu lieu à mon insu ! Je ne sais pas pourquoi ce genre de bonheur résonne si intensément en moi, mais ça me fait toujours cet effet. Le lien et le sens, c’est ma came… En tout cas, l’auteur est aussi ravi que moi de la rencontre. Du coup, il tiendra compte d’un plus grand pourcentage de mes remarques. Tout le monde y gagne !
Un coup de chapeau en passant à la mémoire de cet éditeur qui a donné sa première chance au bébé-écrivain que j’étais, et qui m’a transmis un savoir-faire et une culture hérités du passé. C’était aussi un poète. Je préfère rester discrète sur son nom, ne m’en veuillez pas ! Je pense à lui encore aujourd’hui.
Voilà, j’en ai fini pour 2016. Je vous souhaite à tous une excellente année nouvelle ! Prenez bien soin de vous.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Les agents littéraires
Par Nila Kazar
#agentlittéraire #agencelittéraire
Longtemps, trop longtemps j’ai rêvé d’avoir un agent littéraire. Et vous aussi, je suis certaine que vous en rêvez, avouez !
Ah, le personnage d’agent artistique du merveilleux film de Woody Allen « Broadway Danny Rose », comme on l’aime ! Cet être exceptionnellement clairvoyant qui croit en vous avant tout le monde, qui vous soutient dans les affres de la création, lit votre manuscrit dans les trois jours, vous aide à le retravailler ; qui vous dorlote et vous encourage, que vous pouvez appeler au milieu de la nuit quand vous avez une crise d’angoisse et qui accourt illico à votre chevet ; qui vous console de vos échecs et fête avec vous vos victoires, comme on voudrait lui être présenté… Et bien sûr, quand ça commencerait à marcher pour vous, cette perle rare, vous la laisseriez choir sans l’ombre d’un remords pour passer dans les bras d’un agent plus influent !

C’est si difficile de savoir ce que vaut notre manuscrit, de savoir comment le positionner et à qui l’adresser, de savoir négocier un contrat et réclamer de meilleures conditions… Ce n’est pas notre métier, tout simplement ! Comment être objectif quand il s’agit de soi ? Impossible, nous avons absolument besoin d’un intermédiaire.
Eh bien, si vous êtes né.e en France, oubliez. À moins que vous ne soyez déjà un auteur confirmé et gros vendeur, vous n’avez qu’une chance infime d’intéresser un agent littéraire.
Bizarre, dites-vous, l’agent littéraire n’est-il pas justement destiné à soutenir et promouvoir le débutant talentueux ?
Pur fantasme ! Voilà encore un exemple de notre fameuse exception culturelle : alors que nos confrères/sœurs européens, célèbres ou pas, ont tous un agent (y compris dans les pays latins, au cas où serait soulevée cette objection classique), en France seuls les auteurs qui n’en ont pas besoin y ont droit. Ô pays de Descartes et de Pascal, où est la raison là-dedans ?
Distinguons d’abord le domaine de la littérature étrangère, où les agents littéraires sont omniprésents. Spécialisés dans une aire culturelle et/ou linguistique, ils défendent les auteurs étrangers auprès des éditeurs français. Personne ne songerait à se passer de ces têtes chercheuses, de ces indispensables poissons-pilotes.
Mais, à l’exception de quelques individus très reconnus dans le milieu, qui ont produit de grands succès, fait ce qu’on appelle des « coups d’édition », et monnayent leurs services auprès des éditeurs en tant qu’apporteurs de projets (citons Raphaël Sorin, qui a lancé Houellebecq), pourquoi les agents dans le domaine de la litt’ franç’ contemp’ n’arrivent-ils pas à s’imposer chez nous ?
La première raison pourrait paraître purement matérielle : les agents littéraires prélèvent 10 à 15% des droits d’auteur, et du coup ils font monter les à-valoirs. De plus ils veillent au grain, par exemple en s’assurant que le livre soit bien mis en place sur les points de vente, ou que les versions dérivées soient réalisées en temps et en heure.
Mais la deuxième raison me semble la plus décisive : en introduisant un intermédiaire entre l’éditeur et l’auteur, l’agent littéraire menace de troubler la relation de dépendance qui fait de l’auteur un obligé de l’éditeur, relation qui l’infantilise et le détourne d’une professionalisation pourtant souhaitable (alors que l’agent littéraire, lui/elle, est un.e pro par définition). Pour le dire brutalement, les éditeurs français désirent garder une relation directe avec leurs auteurs pour les empêcher de sortir de leur sujétion.
Je ne vois pas de mauvaise intention dans ce comportement le plus souvent inconscient, juste une mauvaise habitude, celle du paternalisme, qui est en l’occurrence le mot-clé. Il s’agit d’une culture néfaste, d’une spécificité nationale très ancrée dont il faudrait s’affranchir d’urgence. Des écrivains connus m’ont confié qu’ils n’avaient jamais osé demander qu’on leur communique leurs relevés de vente, et qu’ils craignaient d’être punis s’ils le faisaient, privés de publication future. Autant dire que le chemin sera long pour sortir de l’emprise et rééquilibrer les rapports de force… C’est pourquoi il faut absolument développer nos compétences, ainsi que je le préconise dans mon billet L’écrivain, artiste ou professionnel ?.
Les éditeurs tradis entretiennent avec leurs poulains/pouliches une relation affective qui peut s’avérer réconfortante, mais fera hésiter ces dernier.e.s à refuser telle ou telle proposition qui les lèse objectivement. Dans ces rapports délicats, l’écrivain doit apprendre à garder la juste distance, ni trop intime ni trop glaciale ; mais cela peut prendre des années ! Tout se règle au restaurant, entre la poire et le fromage, et beaucoup de small talk inutile se déverse avant d’effleurer comme en passant la seule question qui vaille. Ce style d’approche m’a toujours déplu, et je me suis vue traiter d’Américaine dans ma façon d’aborder directement les questions à l’ordre du jour – moi qui connais si mal l’Amérique…
À ce propos, notre fantasme d’agent littéraire idéal nous vient surtout des États-Unis. En effet les auteurs d’Outre-Atlantique ne peuvent pas transmettre directement un manuscrit à un éditeur, ils sont obligés de passer par un agent littéraire. Dans son blog, Alan Spade, auteur bilingue, rappelle que certains d’entre eux qualifient d’abusifs, voire de servitude volontaire leurs rapports passés avec les éditeurs. Seulement voilà : Alan n’hésite pas à affirmer que les agents littéraires américains se sont rangés du côté des éditeurs, dont ils dépendent financièrement davantage que des auteurs qu’ils ont en portefeuille. Sur ce constat et son aggravation récente, je vous conseille vivement de lire son article.
Au fond, les agents littéraires français ont une attitude très similaire à celle des éditeurs : ils n’acceptent de s’occuper que de ce qui sera rentable à coup sûr, et ne se donnent pas la peine de répondre aux propositions spontanées qui ne les intéressent pas. « Peu nombreux dans l’Hexagone, ils n’ont pas besoin d’investir pour chercher la perle rare », fait remarquer un commentateur de ce blog. Ils n’introduisent donc pas beaucoup de biblio-diversité dans l’écosystème du livre. Par exemple, Suzanna Lea a représenté Marc Lévy dès ses débuts, et en a fait qui vous savez. Le risque qu’elle a pris n’était pas exorbitant, ou alors… 😉
Vous trouverez ici une étude exhaustive sur les agents littéraires en France et à l’étranger, avec tous les détails pratiques ; mais laissez-moi évoquer quelques agences que je connais un peu.
La plus ancienne en France est l’agence littéraire Hoffman, qui a été créée en 1934 par deux exilés. Elle représente les droits de grands auteurs du XXe et XXIe siècles, américains (Henry Miller, John Steinbeck, George R. R. Martin…), russes (Ivan Bounine…), anglais (John Le Carré, Jonathan Coe…) ou français (Joseph Kessel…). Elle est peu active aujourd’hui, se contentant de gérer son énorme patrimoine. Pour chaque projet d’adaptation scénique ou cinématographique, la machine à pognon se déclenche. D’après son gérant actuel : « C’est surtout une banque, ça n’a plus grand-chose à voir avec la littérature. »
L’incontournable Andrew Wylie, l’agent américain le plus puissant au monde, surnommé The Jackal (si vous vous demandez pourquoi, regardez sa photo ci-dessous !), raconte avoir débauché Philip Roth en se préparant seulement quelques heures. Il a juste examiné l’état des ventes de ses traductions et rééditions ; ensuite, lors d’un bref rendez-vous, il lui a tenu le discours suivant : « Je ne vous promets rien de mirifique, simplement de veiller à ce que tous vos livres publiés soient disponibles en permanence partout et sous toutes les formes. » Comme il peut arriver que des ruptures de stock du Complot contre l’Amérique interviennent, disons, en Corée du Nord, cet argument très simple, mais surtout l’exécution implacable de ce programme, sont à même de rallier n’importe quel auteur célébrissime…

Une histoire arrivée à une amie à moi illustre bien les raisons de son surnom de Chacal : Wylie lui a acheté les droits d’un essai pour la langue anglaise, mais ne les a jamais revendus à quiconque. Elle s’est rendu compte un an plus tard qu’il détenait les droits d’un autre ouvrage sur un sujet similaire, et que son véritable objectif, en déboursant quelques dollars pour son livre, était de bloquer pendant la durée nécessaire toute concurrence à l’autre livre qu’il soutenait en secret. Cool, isn’t it ?
Autrement dit, quand vous croyez avoir décroché le gros lot, attendez-vous à ce qu’il vous explose en pleine figure !
Une autre agent littéraire que j’ai rencontrée plusieurs fois avant qu’elle ne perce, c’est Anna Jarota. Formée chez Andrew Nurnberg à Londres (voir cet article, qui parle aussi du métier d’agent littéraire à travers le monde), elle s’est établie en France où elle a galéré un certain temps. Puis elle a croisé par hasard à un dîner une certaine Valérie Trierweiler, et a eu la bonne idée de lui laisser sa carte. Cette dernière l’a ressortie quand elle achevait Merci pour ce moment. Vous connaissez la suite… Un vrai conte de fées pour Anna, qui a embauché à tour de bras dans son agence ! (Ça me fait penser que je n’ai plus fait imprimer de cartes de visite depuis un sacré bout de temps…)
François Samuelson, autre agent très établi, a développé une branche littéraire dans Intertalents qui, au départ, représentait surtout des comédiens et des scénaristes. Il détient sous contrat un bon paquet de stars, dont vous trouverez des échantillons dans ce portrait. Ne perdez pas votre temps à lui proposer quoi que ce soit, il prendra contact avec vous lui-même dès que vous serez au sommet du podium…
J’ai très bien connu Pierre Astier à ses débuts, bien avant qu’il ne songe à lancer un jour son agence littéraire Astier-Pécher. Il m’a confirmé qu’il n’acceptait de représenter que des auteurs français de polars ou de thrillers (genres à la mode) disposant déjà d’un lectorat, et que par conséquent, quel que soit mon immense talent (non, ça, il ne l’a pas dit), mes nouvelles, je pouvais me les… (non, ça, il ne l’a pas dit non plus). Par ailleurs, il s’est simplifié considérablement l’existence en ne répondant qu’aux messages qui représentent un intérêt pour lui, et jamais à ceux qui représentent un intérêt pour ses interlocuteurs. Cela, je l’ai compris à l’usage, et notre vieille amitié en a souffert un brin… D’autant que je lui avais rendu quelques menus services lorsqu’il traversait une mauvaise passe. (Allô, Pierre, tu es là ?)
En 2016, les principaux agents littéraires français se sont rassemblés dans un syndicat nommé Alliance-ALF, dont les missions sont décrites ici. Il est trop tôt pour dire si cela changera quelque chose pour nous, les auteurs… À suivre !
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
La critique et moi
Par Nila Kazar
#critiquelittéraire #blog #blogueur #commentaire #lecteur #recommandation #prescriptiondachat
Longtemps j’ai cru que la critique littéraire ne serait jamais détrônée de sa place dans les Lettres françaises. Je me trompais.
Je vous ai déjà expliqué ici que l’influence des médias traditionnels sur les ventes d’un livre tendait vers zéro, progressivement remplacée par la recommandation horizontale. Celle-ci s’incarne dans les commentaires des lecteurs et les articles des blogueurs, mais surtout dans les calculs des robots et des algorithmes. Pas très glamour, avouons-le… De ce fait, ce sont les livres grand public qui marchent le mieux, renforçant encore la tendance lourde qui plombe le secteur depuis son industrialisation. Les ouvrages exigeants et la biblio-diversité sont sacrifiés au profit de titres clonés en série, qui sont à la littérature ce que MacDo est à la gastronomie.
On dit souvent qu’il en faut pour tous les goûts, mais quand le goût est à ce point formaté par l’offre, il s’appauvrit, et la liberté de choix n’est plus qu’un vain mot. Ça me rappelle la blague juive : « Mon fils, tu as 15 ans, il est temps pour toi de choisir un métier. Tailleur pour hommes, tailleur pour dames ou tailleur pour enfants ? »
Dans l’Ancien Monde éditorial, il y avait de grandes plumes critiques qui disposaient de tout l’espace nécessaire pour s’exprimer dans la presse écrite. Elles exerçaient une véritable influence sur les ventes et sur l’aura des auteurs. Même en cas de descente en flammes, on disait : « Du moment qu’on en parle, peu importe comment, c’est une bonne chose. » Et c’était vrai ! J’ai moi-même rencontré un lecteur qui avait acheté un de mes livres après avoir lu une vilaine critique. Il s’était dit que c’était trop vachard pour être entièrement justifié, et ça lui avait donné la curiosité d’aller y voir par lui-même. On est devenus amis !
Certains de ces célèbres critiques (par exemple, Angelo Rinaldi) étaient connus pour pratiquer l’éreintement avec un art consommé. En les lisant, on se demandait parfois si le plus important pour eux n’était pas de faire étalage de leur style étincelant et de leurs formules assassines, aux dépens des livres dont ils rendaient compte. Mais quel plaisir de les lire ! Car ils étaient eux-mêmes d’excellents écrivains, des érudits qui connaissaient leur affaire… Plaisir doublé par la satisfaction mesquine qu’on éprouve quand la cible est un confrère/sœur. (Oh, c’est pas joli joli, le cœur d’un auteur ! Mais ça vaut toujours mieux que le cœur d’un tueur de masse ou d’un politicien véreux.)
Bien sûr, lesdites grandes plumes critiques pouvaient être à la solde de leurs propres éditeurs, et/ou membres de grands prix littéraires, bref, des cumulards-pantouflards dont l’objectivité n’était pas vraiment garantie. La pratique du retour d’ascenseur était très répandue – copinage, complaisance, calculs intéressés et autres frétillants croupions de caniche. Untel fréquente-t-il les bonnes personnes ? Hante-t-il les bons salons ? Unetelle couche-t-elle avec Machin ? Ce sont des questions d’esthétique fondamentales !
Et cela n’a guère changé. Que de bouses d’un vide abyssal sont portées aux nues par des plumiteux mercenaires ! Que de fausses valeurs s’effondrent au bout de dix pages lues ! Je ne vais pas m’étendre là-dessus, Balzac caricaturait déjà ce travers et on peut constater tous les jours qu’il se porte bien (le travers, pas Balzac). Voyez ce billet de Jean-Marc Proust sur la rentrée littéraire 2016…
Ainsi, j’ai perdu toute confiance dans l’objectivité du Monde des livres sous le règne de Josyane Savigneau. Je ne lisais plus que les passages en italiques dans les articles (c’est-à-dire les citations originales du livre), ce qui me permettait a minima de juger sur pièces. Voilà entre autres ce qui a décrédibilisé la critique. Mais pas que.
N’oublions pas que la critique était autrefois une branche de la littérature, un genre en soi. On publiait même des recueils de critiques ! De nos jours, elle a quasiment disparu pour se cantonner dans le champ académique, ou dans quelques revues peu diffusées. Sa mise au régime sur ses supports traditionnels (journaux, magazines) signifie qu’au-delà du résumé incontournable, il ne reste au critique qu’un espace restreint pour donner son avis – trop peu pour formuler une opinion étayée.
Au fait, les critiques lisent-ils vraiment les livres dont ils parlent ? Une enquête a montré que la majorité des citations en italiques étaient tirée des vingt premiers pour cent des ouvrages critiqués… Hum, ça la fout mal ! On en conclut qu’à l’heure de l’industrie du livre, la pratique de la critique se résume à sélectionner un titre au milieu de la masse écrasante des parutions en écartant les autres. Et comme elle n’est plus prescriptrice d’achat, la seule influence qui lui reste, c’est de cultiver l’image de l’auteur.
D’où sa décadence. Houlà, tout de suite les grands mots ! Ben oui. Quand j’ai relu les critiques parues dans Libération dans les années 1980, mises en ligne par un ancien journaliste, je me suis dit que ce n’était pas juste de la bougonnerie de ma part de dire ça. Elles m’ont paru géniales !
Je vous épargne le couplet réac sur le déclin des études de lettres, bien qu’il y ait une corrélation évidente. Disons simplement que l’art de critiquer implique des connaissances vastes et précises, ainsi qu’une grande maîtrise de la langue écrite. On ne peut critiquer sérieusement un ouvrage qu’en le replaçant dans son contexte culturel et historique, dans sa filiation littéraire, dans ses rapports avec ses contemporains. En résumé, il faut avoir lu X et Y (et s’en souvenir) pour prétendre comprendre et analyser Z. L’ambition de l’auteur est-elle de se rapprocher de Philip Roth ou de Bernard Werber ? Le résultat ne sera pas le même. Critiquer, c’est d’abord connaître, ensuite faire des comparaisons et opérer des distinctions, toujours argumentées.
Sans une critique indépendante, authentique, approfondie, les lecteurs se retrouvent privés de repères et de critères pour guider leurs choix et se faire une idée juste d’un ouvrage. De plus, une critique de qualité a le pouvoir d’aider les auteurs à réfléchir sur leur propre création. (Pour être franche, pas plus de 5% des critiques sur mes bouquins m’ont été utiles. Mais ce n’est pas si mal !) À ces deux catégories lésées (lecteurs et auteurs), on peut en ajouter une troisième : les attachées de presse qui luttent pendant des semaines pour décrocher un article. Quand il paraît enfin, elles se cognent la tête contre les murs…
Mais que faire ? Il semble que la critique soit désormais condamnée à se réfugier dans les blogs. Et s’il y en a de formidables, n’est pas Pierre Jourde qui veut ! L’influence de certains blogueurs est disproportionnée par rapport à leur maigre bagage culturel et leur formulation paresseuse. Beaucoup se contentent d’étaler leurs goûts de façon binaire, du type j’aime/j’aime pas, sans références, sans arguments. Ils évoquent à tout bout de champ leurs « coups de cœur », formule à laquelle je suis devenue allergique à force de la voir traîner partout (je préfère avoir un coup dans le nez).
Ah ! et l’obsession infantile du spoiler, elle me fait doucement rigoler. Vous savez quoi (scoop) ? Si le livre est bon, même en connaissant d’avance la chute, il vaut la peine d’être lu jusqu’au bout, voire (re-scoop) relu. (Attention, spoiler : Emma Bovary se suicide à la fin !)

Et que dire des commentaires de lecteurs sur les librairies en ligne ? L’ère numérique permet à chacun de s’exprimer librement. C’est fantastique et j’en profite aussi ! Mais, à cause de ce que Frédéric Martel nomme la désintermédiation (voir ici), on est noyé. Sur le web, tout est mis sur le même plan, tout coexiste. Or la recommandation horizontale, faite par les pairs, est-elle aussi fiable que la recommandation verticale, faite par les experts ? Je persiste à penser qu’un bon critique se forge au fil des ans et des lectures ; il ne surgit pas tout fait, tel le génie de la lampe d’Aladin.
Peut-être la recommandation par les lecteurs joue-t-elle un rôle différent de celui de la critique classique, un rôle plus émotionnel, doté d’un réel pouvoir d’entraînement sur l’acheteur, qui passerait par le mimétisme ? Ce sujet mériterait d’être creusé. Mais je reviens à mes rapports avec la critique.
Voici ce que j’en pense : le critique a tous les droits dès lors qu’il parle de votre livre, y compris d’être un trouduc de mauvaise foi. Comment réagir dans ce dernier cas de figure ? Mon conseil :
→ Il n’a même pas lu le livre en entier ? Tant pis, gardez le silence.
→ Il n’a rien compris à vos intentions ? Tant pis, gardez le silence.
→ Il se défoule gratuitement sur vous ? Tant pis, gardez le silence.
Le silence est plus fort que tout, à la longue. La seule attitude de maturité est la courtoisie indéfectible, tenir ses nerfs et passer à autre chose. Continuez à tracer votre sillon dans votre coin, et laissez les critiques vivre leur vie de critiques dans un monde parallèle au vôtre.
Un bon exercice, tiens : remerciez-le d’avoir parlé de votre bouquin. Vous prendrez automatiquement le dessus. La meilleure vengeance, c’est l’élégance. Il sera bien embêté s’il vous croise un jour IRL. Vous jouirez de cet instant, vous n’avez pas idée ! La vie est pleine de surprises et de retournements. C’est vrai aussi pour les écrivains…
Je supporte très bien les critiques négatives sur mes écrits, je trouve toujours qu’elles sont justifiées, étant pour moi-même une critique intransigeante. Du coup, devant un papier élogieux, ou mieux, devant une compréhension profonde, je me retrouve démunie. Non, il ne peut pas s’agir de mon travail, il doit y avoir une erreur quelque part…
Un jour, mon premier éditeur m’a conseillé de combattre ma vanité par mon orgueil. Dans l’arrogance de ma jeunesse folle, je l’ai toisé avec commisération : j’étais convaincue d’être déjà, par nature, beaucoup plus orgueilleuse que vaniteuse. Quelle vanité de ma part 😉 ! Une définition ? L’orgueil aide à tenir bon face aux attaques (et à l’indifférence, qui est quand même le cas le plus fréquent, ne l’oublions pas). La vanité, elle, aide à faire carrière. Ce n’est pas mauvais en soi d’avoir les deux, si on les distingue clairement l’un de l’autre.
L’une de mes toutes premières critiques était épouvantable. Le gars résumait le début et poursuivait ainsi : « …et blablabla. NK n’est qu’une khâgneuse qui s’imagine écrire. » Grroumpff, ce n’est pas à Mazarine Pingeot (vous savez, la fille de) qu’il aurait osé balancer ce truc ! Moi qui sortais de nulle part, il m’avait arrangée proprement. Ça m’a fait l’effet d’une piqûre de taon : très douloureux, mais pas longtemps. Au fond, j’avais l’impression que ce type parlait de quelqu’un d’autre. Et c’était vrai, en un sens. Tant d’années après, je suis toujours là. J’avance. Je publie. Plus incroyable encore, il y a des gens qui apprécient mes livres… Lui, le malotru, il est tombé aux oubliettes.
On ne le répètera jamais assez : en littérature, l’important c’est de durer. Je dirais même plus : EN LITTÉRATURE, L’IMPORTANT C’EST DE DURER.
Sur le web, c’est en 2010 que j’ai eu droit à ma première critique dématérialisée. Sur le moment, elle m’a juste fait lever un sourcil une seconde. La lectrice disait en gros que mon livre ne lui avait pas plu, mais que c’était peut-être dû au fait qu’elle était dans un mauvais jour. L’argument était faible, non ? De toute façon, les articles parus sur des supports papier étaient élogieux – et c’était ça qui comptait à mes yeux.
Oui-da, mais pendant les deux mois qui ont suivi, quand on tapait le titre de mon bouquin sur un moteur de recherche, ce qui ressortait tout en haut de la SERP (Search Engine Result Page), c’était… hé oui, vous avez deviné : la chronique en question, car elle figurait sur un site très bien référencé. Les autres (bonnes) critiques s’affichaient loin derrière la liste des librairies où le livre était disponible, vers la 3e ou 4e page de la SERP. Un véritable choc ! Je ne pouvais plus dire : « Du moment qu’on en parle, peu importe comment… »
J’avais découvert les conséquences concrètes de la recommandation horizontale sur le web. Je la trouvais plus arbitraire que les descentes en flammes d’antan (je n’étais pas objective, j’étais trop étonnée et ennuyée). L’étiquette restait collée plus longtemps, les lecteurs impatients s’en tiendraient à cela, ma réputation d’auteur était entachée, et d’ailleurs, qui était cette little bitch ignare qui se permettait de… vertuchou ! Il a fallu attendre qu’une autre lectrice sur le même site adjuge 5 étoiles au livre pour renverser la vapeur.
Mais finalement, ce moment traumatique s’est révélé utile, puisque c’est lui qui a lancé le processus de réflexion qui m’amène aujourd’hui à être présente et active sur le web. Qui s’en plaindrait ? Sûrement pas vous, chers amis du Bazar Kazar !
Le Plus de Bazar Kazar : Par pur masochisme, je vous livre cette chronique sur mon petit dernier. Et puis celle-là, histoire de comparer. N’est-ce pas une bonne illustration de ce que certains lecteurs ne sont pas équipés pour recevoir certains livres ?
N.B. : Il va de soi, quand j’use du genre masculin (ex. le critique, le lecteur), qu’il équivaut à un neutre dans mon esprit.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Le plagiat
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#plagiat #plagiaire #droitmoral #droitdauteur #propriétéintellectuelle
Longtemps j’ai cru que tout le monde partageait ma conviction qu’un écrit ne peut être attribué qu’à un seul auteur. Mais j’ai dû me rendre à l’évidence : ce principe ne fait pas l’unanimité.
Même s’il reste honteux, même si on cherche toujours à le dissimuler, le plagiat est une pratique courante. Et l’était déjà bien avant l’invention d’internet. « Artistes, poètes, écrivains, si vous copiez toujours, on ne vous copiera jamais ! », s’écriait Bernardin de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, faisant avec humour du plagiat un critère de reconnaissance. Être plagié = la gloire ! Ouaip, on peut le voir comme ça, du moins tant qu’on ne cherche pas à gagner sa vie en écrivant…
Comme de remarquables articles ont été publiés sur ce sujet, au lieu de chercher à être originale, je vais les compiler et les résumer – en citant les auteurs et en renvoyant aux sources, ça va de soi !
Tout d’abord, rappelons que les idées ne sont pas protégeables. Un exemple tiré des Cahiers du cinéma (1998) : Radu Mihaileanu a revendiqué la paternité de l’idée centrale de La vie est belle, le grand succès de Roberto Benigni. Il n’a pas fait de procès, même s’il est prouvé qu’il avait envoyé son scénario à Benigni deux ans avant la réalisation du film, lequel Benigni avait décliné l’offre. De la part de Mihaileanu, c’était de l’élégance, mais aussi du réalisme… Car un procès aurait été risqué, et le financement de son film, Train de vie, encore plus aléatoire !
 Cela peut paraître injuste – nan, putain, c’est affreusement injuste ! –, mais c’est ainsi. Ce qui est protégeable, sous certaines conditions, ce sont les textes. Mais il faut savoir que le dépôt de manuscrit (par ex. à la SGDL) ne constitue qu’une preuve d’antériorité.
Cela peut paraître injuste – nan, putain, c’est affreusement injuste ! –, mais c’est ainsi. Ce qui est protégeable, sous certaines conditions, ce sont les textes. Mais il faut savoir que le dépôt de manuscrit (par ex. à la SGDL) ne constitue qu’une preuve d’antériorité.
Pour parler du plagiat, on est obligé de rappeler la définition des droits « moraux » (différents des droits « patrimoniaux », où il s’agit essentiellement de gros sous). L’histoire du droit d’auteur est très bien décrite dans sa page Wikipédia. Retenons que : « En Europe, les premières demandes célèbres de protection contre la contrefaçon émanent des philosophes des Lumières eux-mêmes, à commencer par Diderot dans la Lettre sur le commerce des livres (1763). »
La contrefaçon, qu’est-ce donc ?
Dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Et plus loin : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. »
La contrefaçon, commente l’avocat-écrivain Emmanuel Pierrat ici, « c’est donc l’utilisation illicite, qui peut prendre des formes très diverses, d’une œuvre protégée par la propriété littéraire et artistique. Aux yeux des juridictions, elle repose sur la conjugaison de deux éléments indispensables : un élément matériel et un élément moral. L’élément matériel, c’est l’acte en lui-même. La contrefaçon peut porter sur n’importe quel élément protégé par le droit d’auteur : titre, texte, composition typographique, illustrations, couverture, etc. ».
Quant au droit moral, il est ainsi défini dans le CPI : l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité (d’auteur) et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Cela implique que : 1. les héritiers de l’auteur pourront l’exercer même si l’œuvre est tombée dans le domaine public, 2. l’auteur lui-même ne peut en aucun cas renoncer à l’exercer, 3. tant que l’œuvre existera, le droit moral s’exercera, même face à des créanciers qui, par exemple, ne pourront pas exiger la diffusion d’une œuvre pour recouvrer les sommes dues.
Eh oui ! rien que ça. Autrement dit, même vous, l’auteur, du moins tant que la loi restera telle, vous n’avez pas le droit renoncer à vos droits moraux. Je suis sûre que vous n’en étiez pas conscients, avouez !
J’en viens au plagiat tel qu’il se pratique dans le monde merveilleux des Lettres françaises. Et pour cela, je vais citer largement l’excellente typologie des plagiaires que présente Laurent Lemire dans cet article très complet sur la question, nourri de nombreux exemples :
> Le pompeur tout-terrain : Lui ne s’embarrasse pas de sa conscience. Il copie au plus juste, change quelques virgules, un mot, un verbe. Pourquoi infléchir une bonne pensée que l’on n’a pas eue ?
> Le grand écrivain en mal d’inspiration : Celui-là, il lui faut un livre dans le trimestre qui vient. Son éditeur le presse. Ses lecteurs l’attendent. Lui n’a pas l’ombre d’une idée. Alors il cherche. Dans les librairies, dans les bibliothèques. Parfois même son éditeur peut le conseiller. L’ouvrage repéré, il ne lui reste plus qu’à opérer un subtil démarquage.
> Le plagiaire par mégarde : Il oublie qu’il a trop lu. Il se souvient tellement des livres adorés qu’il est capable d’en retranscrire, presque mot pour mot, des passages entiers. Sauf que ce distrait oublie les guillemets. Mais pas sa signature.
> Le plagiaire via son nègre : C’est le cas – ils sont plus nombreux qu’on le croit – de ceux qui n’écrivent pas leurs livres (cf. mon précédent billet). Faisant confiance à leurs « collaborateurs », de leurs ouvrages ils ne lisent quelquefois que le contrat en s’assurant du montant des à-valoir.
> Le plagiaire de sujet : De l’histoire des autres il fait son miel. Pour lui l’originalité d’un sujet réside d’abord dans le style.
> Le plagiaire de thèses : Il considère que le savoir appartient à tout le monde. Les œuvres d’érudition, destinées à un public restreint, sont donc susceptibles d’être réutilisées à l’envi pour servir son imagination.
> Le plagiaire polyglotte : C’est le plagiaire furtif, le plus difficilement détectable. Tout dépend des langues mises à contribution. Lui va directement puiser dans le corpus international. C’est un expert et il sait qu’il a plus de chances de se faire repérer en s’appropriant un best-seller anglo-saxon qu’un roman moldo-valaque sur une famille gagaouze (merci Laurent pour ce beau moment d’hilarité).
J’ajoute le cas particulier de ce qu’on appelle plagiat psychique, dont Marie Ndiaye et Camille Laurens ont accusé Marie Darrieussecq. On peut se référer au livre-réponse de cette dernière, Rapport de police. Accusations de plagiat et autres modes de surveillance de la fiction. Cette polémique est tout à fait instructive et respectable, rien à voir avec les marécages du plagiat ordinaire.
Autre référence, le livre Du plagiat de Hélène Maurel-Indart (PUF, 2007), et surtout le site http://leplagiat.net/ qu’elle a créé et entretient toujours. Vous y trouverez aussi les arguments utilisés dans les procès. Comme dit L. Lemire, elle « nous confirme dans l’idée qu’il n’y a pas un type, mais des types de plagiaires. Certains vont même jusqu’à se copier entre eux. La littérature circule alors en circuit fermé. Il suffit de jeter un œil sur la liste des meilleures ventes chaque année pour saisir les sujets ou les styles récurrents. »
L’usage répandu d’internet a beaucoup facilité l’exercice du plagiat, évidemment. Je ne vais pas développer ce thème, mais s’il vous intéresse, voici un cas récent de plagiat numérique où la victime s’est retrouvée… condamnée.
Voyons plutôt l’aspect judiciaire de la question. Il est très difficile de démontrer un plagiat quand il est habile. Il faut vraiment que des phrases entières soient reproduites telles quelles ou à peine remaniées. Les juges ont besoin de preuves convaincantes qui, dans un tel domaine, ne sont pas évidentes à fournir. Du coup, on préfère s’arranger entre avocats, comme on le voit dans cet autre excellent article de Béatrice Gurrey, qui s’interroge : « La France, paradis des plagieurs ? » en comparant nos coutumes avec celle des Allemands ou des Américains : « De ce continent obscur, qu’il est souvent difficile de délimiter, n’émergent que quelques cas médiatiques. La plupart des affaires se règlent discrètement autour d’une table, car les éditeurs préfèrent la transaction au procès, souvent long et coûteux. Il faut alors faire entrer dans la calculette des éléments aussi précis que le tirage du livre, aussi flou qu’un dégât d’image, ou aussi impossible à chiffrer que le droit au respect d’un auteur. Que valent 23 lignes plagiées dans un ouvrage de 200 pages vendu 19€ ? Arithmétique absurde, mais qui donne une idée de la difficulté à résoudre ces questions. »
Et qu’est-ce que j’en pense, moi, de tout ça ? Bon, puisque vous insistez, j’avoue : je suis très attachée au respect des droits moraux. Ça vous étonne ? Le mot propriété dans la formule « propriété intellectuelle et morale » peut déplaire aux esprits altruistes, et je le comprends. Proudhon n’a-t-il pas affirmé : « La propriété, c’est le vol ? » (en fait, la phrase d’origine est beaucoup plus complexe). Mais moi, je prétends que « le plagiat, c’est le vol. »
Oh, la vilaine ! Tout appartient à tout le monde et réciproquement ! Égoïste, va !
Je vous entends, amis geeks qui vouez un culte à la gratuité, au partage, au collaboratif. Je vous entends, et même, je suis souvent d’accord avec vous (la preuve : c’est quoi, ce blog ?). Le concept des communs, bien décrit dans cet article, je l’approuve à fond pour tout ce qui touche à la pédagogie, à la diffusion des connaissances ; et je l’admets même pour les œuvres de l’esprit dont l’auteur autorise expressément (en contradiction avec la définition d’un droit inaliénable) la reproduction, la paraphrase, le samplage, et pourquoi pas le grenaillage, la flottation, l’escapoulage, sans parler du ressuage… Euh, je m’égare 😉 .
Mais là, amis geeks, il s’agit de tout autre chose : il s’agit de création ; il s’agit d’un auteur qui tente de vivre de sa plume, d’être reconnu par ses pairs et par ses lecteurs. Or la victime de plagiat subit à la fois un dommage matériel et un dommage spirituel.
Dans un monde où la vie matérielle d’un artiste ne dépend plus du bon vouloir d’un roi, de la générosité d’un noble ou d’un mécène, ou encore de rentes familiales, et sachant que les aides publiques (subventions, bourses, résidences, etc.) ne concernent que très peu d’auteurs ; dans une société qui vous renvoie sans cesse à l’idée que vous valez ce que vous gagnez, l’idée qu’un écrivain authentique devrait vivre au moins en partie de ses ouvrages est-elle si inacceptable ? Or le plagiat, sans aucun doute, porte atteinte aux revenus d’un auteur.
Mais plus profondément, l’effort d’imaginer un univers, des personnages, d’accoucher d’une histoire en lui donnant une forme artistique originale, d’y consacrer des années de sa vie, suppose un investissement incommensurable. On donne tout à un livre, pas seulement du temps et du travail. « Le style, c’est la manière personnelle de rejoindre l’universel, c’est quelque chose qui vient de l’histoire la plus profonde de l’être, dit le psychanalyste Michel Schneider. C’est pour cela qu’il est si douloureux d’être plagié, surtout quand on débute. »
Un exemple personnel : une amie écrivain italienne, encore peu connue, avait envoyé son manuscrit à une consœur célèbre. Celle-ci lui a piqué les lignes générales de son histoire et d’innombrables détails particuliers pour un livre qu’elle a publié avant mon amie. Les dégâts sur sa vie personnelle et sociale, sa santé psychique, sa carrière, son inspiration, ont été immenses. Au bas mot, deux ans de fichus.
Les plagiaires (rappelez-vous les noms cités dans les articles) sont en grande majorité des personnes plus établies que leurs victimes, des barons ayant statut et pignon sur rue : journalistes trop occupés à passer de plateau télé en émission radio pour écrire, universitaires trop occupés à passer de colloque en direction de thèse pour écrire, éditeurs refusant le manuscrit d’un débutant mais le refilant à un auteur-vedette de son écurie… En fin de compte, le plagiat est souvent un abus de position dominante qu’on peut caractériser, d’après M. Schneider, d’acte de prédation.
Un autre aspect du French plagiarism, peut-être le plus choquant, c’est la connivence générale du milieu et l’impunité des coupables. M. Schneider, encore : « Les élites sont là pour prendre et recevoir et non pour donner et créer en y mettant de la peine. Leur statut économique et social, fait de multiples obligations et apparitions, les contraint quasiment à ne pas faire le travail elles-mêmes. Le passage à l’acte répété donne un sentiment de toute-puissance. Il y a une sorte d’addiction, il faut des doses de plus en plus fortes, de plus en plus spectaculaires de ce vol qu’est quand même le plagiat. » Ou E. Pierrat : « C’est l’esprit de caste qui fait que l’on ne s’excuse jamais. »
Quelques exemples d’impunité, voire de récompense : Calixthe Beyala, plagiaire multi-récidiviste (trois condamnations), à qui l’Académie Française n’a pas retiré son Grand Prix du roman. Patrice Delbourg, pris deux fois la main dans le sac, condamné pour une forme rare de plagiat – la poésie –, qui a conservé son Prix Apollinaire. Ou Joseph Macé-Scarron, qui conservera son Prix de la Coupole… Tout cela, je le répète, après condamnation !
Eh oui, le plagiat, somme toute, c’est payant.
Cerise sur le gâteau, le plagiaire attrapé adore écrire un nouveau livre pour justifier ses actes et les ériger en théorie, sur le thème : « Mais voyons, les écrivains se sont toujours plagiés entre eux ! » Bref, le plagiat considéré comme l’un des beaux-arts. L. Lemire (sans approuver) admet que : « Certes, tout le monde copie tout le monde depuis la nuit des temps, et la littérature n’est qu’un éternel recommencement. » Je me souviens du livre de Jean-Luc Hennig écrit dans ce but, Apologie du plagiat. Et de P. Delbourg se livrant à un « bref éloge de l’écrivain en éponge » : « Face à l’urgence, la paresse, la fatigue, la rentabilité à tout crin, le corps plie, les neurones se mettent aux abonnés absents et, forcément, on se dope, on rapine la substantifique moelle du collègue. La tentation est trop forte. »
Le pauvre, on va le plaindre, il est fatigué et a succombé à la tentation… Y a vraiment des baffes qui se perdent ! Sachez que si vous êtes choqué par cette effronterie, c’est que vous n’êtes pas cool.
 Pour conclure ce copieux billet sur une note souriante, je vous livre un tweet récent de Joyce Carol Oates (19/07/2016) : « Years ago a student plagiarized something I had written for an assignment in a course I was teaching not having noticed the author’s name. » Soit : « Il y a des années un étudiant a plagié quelque chose que j’avais écrit pour un devoir dans un de mes cours sans avoir remarqué le nom de l’auteur. » Piquant, non ?
Pour conclure ce copieux billet sur une note souriante, je vous livre un tweet récent de Joyce Carol Oates (19/07/2016) : « Years ago a student plagiarized something I had written for an assignment in a course I was teaching not having noticed the author’s name. » Soit : « Il y a des années un étudiant a plagié quelque chose que j’avais écrit pour un devoir dans un de mes cours sans avoir remarqué le nom de l’auteur. » Piquant, non ?
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Réécrire, coécrire, écrire pour
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#réécriture #rewriting #nègre #ghostwriter #plagiat #atelierdécriture
Longtemps j’ai été le Janus à deux têtes, à la fois artiste et professionnelle, que je décris ici. Puis de nouvelles têtes me sont poussées, celles des auteurs que je co- ou ré-écrivais.
Si bien qu’aujourd’hui, je ressemble un peu à ça.
<= En plus joli, bien sûr.
« Prête-moi ta plume, mon ami Pierrot », dit la chanson. C’est fou, le nombre d’auteurs qui ont besoin d’un ami Pierrot ! Certains affirment, telle Armelle Brusq, réalisatrice du documentaire Les nègres, l’écriture en douce (2011), que « près d’un tiers des livres publiés en France ont une paternité peu claire ».
Comment vérifier ce chiffre ? Tout cela reste très discret, évidemment. Quoique de moins en moins, comme en témoignent divers livres où des ghostwriters font leur coming-out (par ex. Bruno Tessarech dans Art nègre, Dan Franck dans Roman nègre, etc.). À force de traîner mes guêtres dans le milieu des lettres, j’ai entendu beaucoup de choses. Et pour ma part, je peux au moins affirmer que, bien que je n’aie jamais été ré-écrite moi-même, j’ai pas mal ré-écrit les autres, en étant ou pas créditée au générique.
Il y a de gros besoins dans ce domaine, c’est certain. J’ai obtenu mes premières commandes très jeune, comme je l’ai raconté là. Aucune formation, peu d’expérience. Ça paraît incroyable, je sais. Peut-être que savoir écrire d’instinct vous permet aussi de savoir ré-écrire d’instinct ? Un truc qui s’appellerait le talent, quoi ? Je n’en sais rien, je ne veux pas m’avancer sur ce terrain. Ce que je crois, c’est que les compétences artisanales que nécessite la ré-écriture vont de pair avec la création artistique. Tout simplement parce que écrire de la bonne littérature implique aussi un grand savoir-faire.
Preuve en est que sans cela, la pédagogie de l’écriture serait impossible, puisque seul le savoir-faire peut faire l’objet d’une transmission. Je mène des ateliers et des cours de créa’litt’ depuis 25 ans, et je sais que la pédagogie de l’écriture n’est pas un vain mot. On n’enseigne pas le talent, encore qu’on puisse l’aider à se révéler dans le contexte d’un atelier, grâce à la confiance acquise au contact des autres et à l’exemple tellement inspirant du Maître ; mais on peut améliorer beaucoup d’aspects en pratiquant l’écriture accompagnée. Même si de nombreux auteurs établis se refusent à l’admettre et préfèrent miser sur la grâce qui descend des cieux (flapflapflap) pour se poser sur leur front d’élu (plonk), faisant jaillir d’eux des chefs d’œuvre aussi époustouflants que la scissiparité chez les paramécies [qui ne sont là que pour l’allitération, hop, les voilà reparties].
Bref. « Max Gallo, François Furet, Érik Orsenna… Tous sont passés par la case nègre littéraire. Octave Mirbeau et Lovecraft prêtaient également leur plume pour arrondir leurs fins de mois », poursuit Armelle Brusq. Côté statut et finances, les usages ont évolué depuis Maquet, Colette et consorts. Autrefois les nègres d’édition ne voyaient jamais leur nom mentionné dans le livre, aujourd’hui il l’est souvent, dans la formule consacrée « en collaboration avec ». Autrefois ils touchaient un forfait pour solde de tout compte, ce qui, en cas de best-seller inattendu, était injuste et frustrant ; aujourd’hui ils peuvent négocier un pourcentage quand un succès est en vue. J’obtiens jusqu’à 5% dans certains cas.
Je connais une demi-douzaine d’écrivains qui font ce genre de jobs mercenaires pour financer leurs propres œuvres. Tous sont très talentueux et produisent une littérature exigeante. Dans le monde merveilleux qui est le nôtre, s’ils publiaient uniquement sous leur propre nom, au mieux il végéteraient comme mid-listers, au pire ils accumuleraient les inédits, finiraient par arrêter d’écrire et crèveraient à petit feu. Alors qu’en tant que nègres, ils sont bien payés… Difficile de résister à l’appel déchirant des factures, n’est-ce pas ? Voilà comment on se laisse happer par la spirale infernale. J’ai un ami nègre qui n’écrit quasiment plus pour lui-même, alors qu’il a eu un grand prix littéraire.
On ne peut nier qu’il existe un problème éthique dans cette exploitation éhontée du talent par… quoi, au fait ? Eh bien, par des marques. Car les auteurs qui signent des livres écrits par d’autres sont davantage des marques que des écrivains. Et leurs ouvrages, davantage des produits que des livres. Certaines œuvres complètes sont rédigées par un unique soutier de l’édition, pour que le style soit homogène (c’est plus crédible). On peut aussi admirer des bibliographies qui tutoient la centaine de titres, attribuées à des célébrités médiatiques bien trop occupées à faire parler d’elles pour écrire, quand bien même elles en seraient capables (ça arrive).
Mais la plupart du temps, les nègres travaillent avec des gens qui sont tout à fait incapables d’écrire : stars du sport ou de la téléréalité, etc. Si bien que l’industrie et le marché du livre sont les moteurs d’une vaste entreprise de tromperie sur la marchandise. (J’évite de trop développer ce point avec mes étudiantes en édition, je me suis rendu compte que cela les dégoûtait. Elles sont jeunes et ont besoin de croire à la noblesse du métier…) Étrange monde que celui où les gens de talent le consument au service des gens de réputation, non ?
Interrogé sur ce qui a pu l’amener à devenir nègre, un ami m’a confié ceci : « Quand j’étais enfant, il y avait une bibliothèque vitrée chez mes grands-parents, fermée à clé. Dedans, les livres reliés en cuir me semblaient des trésors magnifiques. Je ne voyais que les dos, j’étais trop petit pour déchiffrer les titres dorés de la dernière rangée, mais j’étais fasciné. Interdiction d’y toucher, malgré mes supplications. J’en mourais d’envie, c’était une obsession. Et je me souviens d’avoir pensé : bon, puisque je n’ai pas le droit de les lire, je les écrirai moi-même. J’écrirai pour connaître ces livres-là, et puis tous les autres… Plus tard, j’ai commencé à me dire : je pourrais peut-être écrire aussi les miens propres ? C’est ce que je fais aujourd’hui, sans avoir changé d’intention : je les écris pour les connaître. »
Je trouve ça très beau, pas vous ?
Plus beau que les paramécies, en tout cas.
Pour découvrir d’autres témoignages sur le métier et les motivations des nègres d’édition, je vous recommande vivement la revue Le Tigre, qui a recueilli des interviews passionnantes, et assez terrifiantes.
Quant à moi, je ne suis pas un nègre d’édition à 100%, puisque je me suis toujours refusée à écrire en lieu et place de X. Pas du tout pour des raisons morales, mais parce que je ne voulais pas dépasser un certain seuil d’investissement, afin de préserver ma propre écriture. Ce qui s’est avéré être à l’usage un sacré jeu d’équilibriste… Pour moi, la ré-écriture s’apparente à de l’ébénisterie, alors que la co-écriture s’apparente à de la charpenterie suivie de menuiserie.
À ce stade, vous allez tenter de m’arracher des noms. Je vous connais, mes canailles ! « Pour qui tu écris ? Allez, raconte ! » Mais je ne peux pas vous le dire, secret professionnel ! Je risquerais de perdre mes commanditaires. Pour vous consoler, voilà des anecdotes authentiques :
> Invité pour parler de son livre à la télé, l’auteur affolé appelle son nègre au dernier moment pour se faire briefer sur son contenu, car il n’a pas jugé utile de le lire…
> Une auteure, fabriquée de toutes pièces et sur mesure par un « grand » éditeur en prévision d’un événement littéraire à venir, se persuade tellement d’écrire elle-même qu’elle fait tout un cinoche avec ses fans lors des séances de dédicaces…
Deux mésaventures récentes m’ont inspiré les vignettes qui suivent (où je me vouvoie, car je mérite tout mon respect). C’est LE PLUS DE BAZAR KAZAR !
« Vous ré-écrivez le témoignage d’un jeune homme. Pour cela vous utilisez tout votre savoir-faire. À vos yeux cet artisanat est noble, bien que vous le distinguiez sans ambiguïté de l’art que vous pratiquez aussi. En tant qu’artisan vous ne devenez pas quelqu’un d’autre. Les mêmes principes prévalent, la même exigence.
Et voilà que vous découvrez par hasard, tout près de finir l’ouvrage, que l’auteur présumé, qui a insisté pour voir son nom seul figurer sur l’ouvrage à venir, est un plagiaire. Vous vous en doutiez depuis quelque temps, d’ailleurs. C’est précisément votre connaissance intime de la langue écrite qui vous a permis de repérer ce grain différent, ce passage trop maîtrisé, qui détonent dans un texte mal ficelé.
Or ces passages qui détonent, ces plagiats, vous les avez déjà ré-écrits, lissés, peaufinés, dans le but d’unifier la voix de l’auteur. Un énorme travail a été effectué, qui fait de vous la complice involontaire de l’entreprise de tricherie. Par conscience professionnelle, vous avez effacé les traces des méfaits d’un autre…
Plus tard, lors d’un échange de mails à ce sujet : « Vous vous êtes engagée par contrat à ce que votre version ne s’écarte pas trop de la mienne », vous rappelle le petit effronté. Sidérée par son impudence, vous n’avez pas l’esprit de répliquer du tac-au-tac : « D’accord, mais veuillez préciser du texte de qui il convient de ne pas s’écarter ?! »
En fait, il y a de nombreuses corrélations entre plagiat et négriage, comme en témoigne cet excellent article. Deuxième vignette :
« Vous achevez la ré-écriture d’un récit dont l’auteur est une actrice, mince, grande et blonde à souhait. Problème : elle est convaincue d’être aussi écrivain. Les mois passant, elle n’a toujours pas admis que vous soyez chargée de remettre en forme ses propos. Elle veut à tout prix ré-écrire ce que vous avez ré-écrit. C’est une situation compliquée à résoudre. De plus, elle veut intégrer au livre tous ses poèmes de CM1. Impossible de l’en faire démordre, et comment lui dire que ses rimes sont atrocement cucul-la-praline ?
Elle vit dans un fantasme, on ne peut lutter contre cela. Surtout que l’éditeur flatte ce fantasme, vous coinçant dans une injonction contradictoire : ré-écrire absolument tout, mais sans qu’elle s’en aperçoive. Cela risquerait de dégonfler son ego, et il veut s’épargner les ennuis. Elle est si capricieuse, il a peur qu’elle rompe le contrat au dernier moment…
Entre autres perles du manuscrit original, vous avez coupé celle-ci : « Je crois que mon esprit mathématique d’ingénieur trouve en la poésie le parfait allié de mon esprit artistique et bohème de comédienne, d’écrivaine et de rêveuse. » Voilà comment elle se voit ! Et celle-là : « Je choisis de me concentrer sur ma carrière de comédienne dans mes années de jeunesse, songeant que je pourrai toujours écrire et être publiée quand je serai vieille et moche. » Mot pour mot, promis-juré…
Pour une belle rencontre humaine, combien de chieuses et de truqueurs de ce genre ?
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Patronyme ou pseudonyme?
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#pseudonyme #pseudo #nomdeplume #hétéronyme #personnage #nomdepersonnage #généalogielittéraire
Longtemps j’ai cru que j’étais une entité unique aux contours clairement définis. Jusqu’au jour où, à la suite de circonstances imprévues, j’ai endossé un pseudonyme.
J’étais sur le point de publier un petit polar à clés qui, à travers des personnages aisément reconnaissables, ciblait des personnes réelles et décrivait un milieu précis. Deux des spécialistes que j’avais interviewés pour me documenter m’ont conseillé de me protéger d’appels et de courriers menaçants en prenant un pseudo. Après mûre réflexion, j’ai suivi leur conseil.
Pour choisir le nom, j’ai pensé aux Kazars, dont mon paternel prétendait être un descendant (si ça vous intéresse, Arthur Kœstler évoque l’histoire de l’empire kazar dans La Treizième tribu). Ainsi, en changeant de nom, je restais tout de même la fille de mon père. Au moment de publier un livre pour la première fois, des années plus tôt, j’avais hésité assez longtemps entre garder mon patronyme ou prendre un nom de plume. Soit entre rester la fille de mon père ou me forger une nouvelle identité.
Pour le prénom Nila, eh bien, croyez-le ou non, je l’ai inventé ! Je voulais juste suggérer que Kazar ne l’était pas : « Nie la Kazare », c’était le jeu de mots faiblard qui sous-tendait ce choix. Deux ans plus tard, je découvrais absolument par hasard (mais comme on sait, il n’y a pas de kazard) que ce prénom féminin existait en hindi, et signifiait bleu… Souvent l’écrivain croit inventer, alors qu’il ne fait que retrouver.
Voilà, vous savez pourquoi les mois suivants, j’ai hanté les salons du livre avec des lunettes noires, en me retournant à chaque bruit suspect. Je me la jouais trop ! Ce qui m’a le plus étonnée, c’est la facilité avec laquelle j’ai chaussé les baskets de cette inconnue. La première fois qu’on a laissé un message à l’attention de Nila Kazar, je me suis aussitôt présentée. Sans l’ombre d’une hésitation.
Une retombée vraiment jouissive de ce choix, c’est que mon premier éditeur, qui m’avait virée pour cause de non-rentabilité, m’a rachetée sous mon pseudo dix ans plus tard. Il m’a même fait deux contrats : l’un en tant qu’auteur, et l’autre en tant que dirdecol’. Quelle ironie, vous ne trouvez pas ? Comme quoi, nul n’est à l’abri d’une erreur d’appréciation 😉 ! Cela prouve qu’il est essentiel pour un écrivain de durer, de persévérer jusqu’à ce que le vent tourne.
Aujourd’hui, réactiver mon pseudo répond à d’autres objectifs : je cherche à me réinventer, à conquérir un nouveau lectorat. De plus, je crois que je serai aidée dans cette démarche par la distanciation que le pseudo introduit. J’ai remarqué que j’étais beaucoup plus efficace pour défendre le travail de mes camarades que le mien. Par conséquent, je devrais mieux défendre cette Kazar qui est moi sans l’être tout en l’étant… euh, vous me suivez, j’espère ?
Élargissons la focale. Au cas où vous seriez trop jeunes pour le savoir, les pseudos et les avatars n’ont pas été inventés par les jeux en ligne ou les réseaux sociaux ! Rappelez-vous vos cours de français au collège : Molière était le nom de plume de Poquelin ; Voltaire, celui d’Arouet ; George Sand, celui d’Aurore Dupin, etc.
Et l’immense William Faulkner s’appelait en fait Falkner, sans U. Laissez-moi vous conter cette histoire fascinante : son arrière-grand-père le Colonel William Clark Falkner, personnage haut en couleur, combattant au Mexique et à la Guerre de Sécession, entrepreneur dans les chemins de fer, accusé de meurtre et disculpé deux fois, lancé dans la politique pour finir assassiné publiquement un jour d’élection, a donné son nom à un village du Mississippi, Falkner.
 Intéressant, quand on songe que William Faulkner est enterré à l’épicentre du comté imaginaire qui fournit le cadre de ses principaux romans… L’un donne son nom à une localité, l’autre invente un comté (plus grand, donc), qui devient assez réel pour y planter sa tombe !
Intéressant, quand on songe que William Faulkner est enterré à l’épicentre du comté imaginaire qui fournit le cadre de ses principaux romans… L’un donne son nom à une localité, l’autre invente un comté (plus grand, donc), qui devient assez réel pour y planter sa tombe !
Encore plus excitant, quand on découvre que le Vieux Colonel était lui-même auteur. Entre autres, d’un polar vendu à 160 000 exemplaires (succès rarissime à l’époque), intitulé The White Rose of Memphis, alors qu’une célèbre nouvelle de son arrière-petit-fils s’appelle A Rose for Emily, et met en scène un personnage de colonel, le dénommé Sartoris, largement inspiré de la figure de son aïeul…
On suppose que le futur Prix Nobel de littérature (il est bon de rappeler que, quatre ans avant d’être couronné par l’Académie suédoise, WF déclarait que personne ne s’intéressait à ses écrits et qu’il avait échoué…) s’est senti autorisé à devenir écrivain grâce à l’exemple du Vieux Colonel. Il s’est d’abord identifié à lui en rêvant d’un destin héroïque à la guerre. Ensuite en rivalisant avec lui en tant qu’auteur (Prix Nobel versus best-seller). Je crois qu’insérer la lettre U dans son nom lui a permis de se distancier de son modèle, de devenir pleinement lui-même, de circonscrire le périmètre de sa création personnelle.
Cet exemple montre bien que les allers-retours entre nom réel, nom de plume, personnage, et même titre d’ouvrage sont incessants chez les écrivains. C’est ça, la littérature : un jeu permanent de saute-frontière réalité/fiction, du flou, du mixte, de la transgression, de l’impur…
Le nom est fondamental pour un écrivain. Tous les noms.
À commencer par son propre nom. C’est la pierre de fondation de l’œuvre, ce qui l’ancre à une certaine place dans la généalogie littéraire. S’agissant d’un grand écrivain, son patronyme pourra même devenir un objet distinct de lui/elle. Ne dit-on pas : « En ce moment je lis du Colette », « Cet été j’ai dévoré tout Tchekhov » ?
Ensuite, le nom des personnages. Nommer, c’est créer, dans bon nombre de cosmogonies. En fiction, nommer c’est aussi permettre au personnage de s’incarner. Ainsi, quand un romancier a du mal avec un personnage, changer son nom peut résoudre le problème. Le premier nom venu est souvent le meilleur, pas la peine de se casser la tête. C’est magique !
« À moi seul bien des personnages… », disait Shakespeare. Cet entraînement des écrivains à se projeter dans des identités multiples favorise sans doute leur tentation d’user de pseudonymes. Beaucoup d’écrivains ont un fantasme d’auto-engendrement (« enfant de soi-même et de ses lectures », ai-je écrit ici), d’auto-légitimation (« Mon nom imprimé sur une couverture me confirme que j’existe bel et bien, prouve au monde entier que j’en ai le droit… »). C’est là que le pseudonyme qu’ils/elles se choisissent leur permet de renaître sous une autre peau, plus proche de leurs aspirations, plus conforme à leur image-de-soi rêvée.
Au cours de l’histoire, beaucoup de motivations d’écrire sous pseudo ont surgi. Je ne prétends pas les recenser toutes, mais en voici quelques-unes dans l’ordre où elles me viennent à l’esprit :
> pour critiquer le pouvoir, dénoncer les abus, braver la censure, se moquer des religions, croyances, idéologies de tout poil ;
> pour gagner sa vie, dans un contexte où la liberté d’expression est réprimée (c’était monnaie courante dans les pays communistes, mais aux États-Unis, à l’époque du maccarthysme, un scénariste de génie a été lui aussi obligé de travailler sous pseudo, Dalton Trumbo) ;
> pour prendre la parole au nom des victimes, des opprimés, des morts, des illettrés – l’une des missions parfois assignée à l’écrivain est de se faire le porte-voix des sans-voix ;
> pour échapper à son milieu d’origine, vu que chez nous ça ne se fait pas d’être saltimbanque, Môssieu (un exemple récent : Pour en finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis) ;
> pour échapper à son sexe/genre, vu que ces dames sont incapables d’écrire quoi que ce soit de valable, Môssieu ;
> pour donner un nouveau souffle à sa carrière, rebattre les cartes (voir le cas d’école Romain Gary/Émile Ajar) ;
> pour tâter d’un autre genre littéraire (Joyce Carol Oates publie aussi des polars signés Rosamond Smith ou Lauren Kelly – cette femme me stupéfie !) ;
> pour effectuer des travaux mercenaires tels que nègre d’édition, en réservant à l’art son véritable nom ;
> parce que « nombreux sont ceux qui vivent en nous », comme le fait remarquer Fernando Pessoa (environ 75 hétéronymes au compteur) ;
> sans compter ceux qui, à l’instar de B. Traven, ont tout simplement adoré jouer avec les identités. Les écrivains sont facétieux, c’est connu.
L’écriture est aussi une histoire de filiation réelle ou symbolique ; on se choisit une famille en littérature. Si bien que des personnages de fiction peuvent fournir des pseudonymes gorgés de sens. Ainsi, l’un de mes auteurs contemporains préférés, Marc Zaffran alias Martin Winckler, a emprunté son nom de plume à un personnage de Georges Perec (il n’en fait pas mystère), Gaspard Winckler. Mais il a conservé un prénom proche de l’original par sa première syllabe.
Dans un roman à la fois tendre et terrible, Abraham et fils (éditions P.O.L), le personnage du père s’appelle Farkas. L’auteur confie avoir choisi ce nom pour sa sonorité – on peut remarquer qu’il n’y a que des A dedans, c’est également le cas de MArc ZAffrAn –, sans en connaître l’origine. Il se trouve que, par kazard, je connaissais ce mot hongrois qui signifie « loup ». J’ai eu le plaisir d’en informer MW !
 De mon côté, j’ai découvert très jeune que mon patronyme correspondait au nom d’un narrateur récurrent de Philip Roth, l’une de mes idoles en littérature. M’identifier à ce personnage de fiction m’a aidée à m’auto-légitimer en tant qu’écrivain. Du coup, quand un Roth vieillissant s’est mis à tuer ses narrateurs dans ses romans, j’ai fait le dos rond. Heureusement qu’il a décidé de mettre fin à sa carrière avant de commettre l’irréparable ! Mon double fantasmatique est désormais immortel. Au moins ça…
De mon côté, j’ai découvert très jeune que mon patronyme correspondait au nom d’un narrateur récurrent de Philip Roth, l’une de mes idoles en littérature. M’identifier à ce personnage de fiction m’a aidée à m’auto-légitimer en tant qu’écrivain. Du coup, quand un Roth vieillissant s’est mis à tuer ses narrateurs dans ses romans, j’ai fait le dos rond. Heureusement qu’il a décidé de mettre fin à sa carrière avant de commettre l’irréparable ! Mon double fantasmatique est désormais immortel. Au moins ça…
Assez de choses sérieuses ! Voici une anecdote labellisée Anti-Pinocchio. Un jour, auteur déjà confirmé, l’idée m’est venue d’envoyer un manuscrit à de nouveaux éditeurs en usant d’un pseudonyme. Après tout, n’avais-je pas été repérée par mon premier éditeur, alors que j’étais totalement anonyme, grâce à un envoi postal ? Je voulais refaire le test. Ayant reçu une circulaire de refus de Grasset, je suis allée sur place pour récupérer l’exemplaire. La fille à l’accueil m’a demandé ladite circulaire, je ne l’avais pas sur moi. Une pièce d’identité alors ? Oui, mais j’ai dit non, car naturellement elle était à mon nom, que je ne voulais à aucun prix révéler, mal à l’aise de faire ce test pas très malin. J’ai argumenté, tempêté, supplié en vain. « Je ne suis habilitée à rendre les manuscrits qu’à leurs auteurs », répétait la fille. Je mourais d’envie de lui corner aux oreilles : « Mais c’est MOI l’auteur, espèce d’idiote ! » Pas moyen. Je m’étais piégée toute seule.
Au fait, le test s’est soldé par un échec sur toute la ligne. Personne n’a voulu de mon manuscrit. Mais si vous croyez que cette déconvenue m’a rendue plus sage, vous vous fourrez le doigt dans l’œil.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
L’écrivain: artiste ou professionnel?
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#contrat-type #édition #dépôtdemanuscrit #à-valoir #pourcentage #droitsdauteur #redditiondescomptes #relevédeventes
Longtemps j’ai eu du mal à admettre que, pour exister en tant qu’écrivain, je devais être deux personnes à la fois : une artiste et une professionnelle.
Dans ma cosmogonie intime, au commencement était l’artiste, surgi du néant, enfant de soi-même et de ses lectures. Le professionnel s’est construit ensuite, se détachant progressivement de l’artiste pour lui permettre de s’affirmer sans complexe et d’être efficace en dehors de son bureau.
Le mot d’ordre pourrait être : Écrivain, deux en un !
 En principe, l’avatar artiste écrit tout seul dans son coin sans tenir compte d’aucun facteur extérieur à son œuvre. Pas compliqué ! (Difficile et risqué, oui, mais pas compliqué…)
En principe, l’avatar artiste écrit tout seul dans son coin sans tenir compte d’aucun facteur extérieur à son œuvre. Pas compliqué ! (Difficile et risqué, oui, mais pas compliqué…)
Alors que l’avatar professionnel va à la rencontre de l’éditeur, du libraire, du graphiste, de l’attaché de presse. Il analyse son contrat, négocie clauses et pourcentages, se tient au courant des usages et de la législation du métier, lit la presse spécialisée ; s’il s’auto-édite, il s’initie au livre numérique, à la fabrication papier, à la promotion en ligne ; enfin il défend son ouvrage dans les médias, hante les salons et festivals, répond aux questions de son lectorat. Bref, s’efforce d’acquérir et de maîtriser de très nombreuses compétences.
Comment concilier deux aspects aussi opposés dans une seule personnalité ? Je n’ai pas de recette. Disons qu’au début, je devais forcer un peu ma nature. Au fil des années, je me suis améliorée, nécessité faisant loi puisque je prétendais vivre de mon clavier. À présent je connais bien l’environnement éditorial, et je n’ai pas fini d’apprendre.
Car si je ne me prends pas au sérieux, qui le fera ?
Un jour, un éditeur m’a proposé un contrat. Je l’ai lu dans son bureau, crayon en main. Au bout de dix minutes, il s’est étonné : « Tu le lis en entier ? – Évidemment, ce papier m’engage autant que toi. – Tu es le premier auteur que je rencontre qui lise à fond son contrat. – Pas possible ! – Si. D’habitude ils regardent le tirage, la date de parution, le pourcentage et l’à-valoir. Et encore, pas toujours… » Or cet éditeur s’occupait de 250 auteurs. C’était moi la plus étonnée des deux !
Pour développer votre avatar pro, voici quelques conseils de base :
On peut se procurer gratuitement des contrats-types auprès de la SGDL (Société des Gens de Lettres) ou de la Mél (Maison des écrivains et de la littérature), dont vous trouverez les coordonnées sur ma page Ressources, section « Sites institutionnels ». On peut aussi consulter des spécialistes sur rendez-vous. Pourquoi se priver de cette aide précieuse ? Une fois qu’on a le document sous les yeux, il faut le lire et poser des questions jusqu’à être sûr d’avoir à peu près tout compris. Pas plus dur que les stats-et-probas au bac…
Commencez donc par déposer votre manuscrit à la SGDL. Cet enregistrement pourra servir de preuve d’antériorité en cas de litige pour plagiat. Le service de protection des œuvres existe maintenant en mode électronique, il s’appelle Cléo+. C’est une précaution utile.
Dans un deuxième temps, osez négocier votre à-valoir et votre pourcentage sur les droits d’auteur. L’à-valoir est souvent la seule chose que vous toucherez, et il n’est pas remboursable, même si vous ne l’amortissez pas par vos ventes. Si on vous propose 1500 euros brut, demandez-en 2000. Faites monter les enchères, même symboliquement, c’est bon pour l’estime de soi. Et ne transigez pas sur vos 10% pour un roman ! Un contrat mentionnant 0% de droits d’auteur est illégal, l’Harmattan par exemple a été condamné pour l’avoir pratiqué (comme la chose a été jugée, j’ai le droit de le mentionner).
Plus tard vous apprendrez à faire supprimer les articles déloyaux, par exemple celui qui concerne les provisions sur retours (le diable gît dans les détails), et vous refuserez de signer la clause de préférence ou droit de suite, un piège qui vous coince pour longtemps, car vous devrez cumuler deux refus de suite avant de vous libérer de cet éditeur pour aller butiner chez un autre. De même, vous ne signerez l’avenant concernant les droits d’adaptation audiovisuelle que quand une proposition concrète se présentera, pas avant.
Enfin vous exigerez qu’on vous communique vos relevés de vente annuels (« Chaque année tes comptes réclameras », tel est le onzième commandement). La reddition des comptes d’édition est un point noir depuis toujours. Transparence et honnêteté sont rarement là où les rapports sont déséquilibrés ; or l’éditeur est à la fois juge et partie en la matière. J’ai forgé à ce propos un petit dicton : « Petit éditeur, grand escroc. Grand éditeur, petit escroc. » Désolée pour les valeureuses exceptions, mais c’est assez fidèle à la réalité… En effet, un grand éditeur n’a pas besoin de vous escroquer autant qu’un petit, car il a les reins plus solides et de la trésorerie devant lui. Mais il essayera toujours de retarder le moment de passer à la caisse. Le réflexe est bien ancré dans le milieu.
Dans l’industrie du livre, aucune instance tierce ne perçoit les droits pour les redistribuer aux auteurs ou ayants-droit, contrairement à ce que font la SACD pour le théâtre et la SACEM pour la musique (notez que ces vénérables sociétés d’auteurs prennent leur temps pour vous verser votre dû). Mais c’est en train de changer. Aboutissement de quatre ans de négociations entre les représentants des éditeurs et des auteurs, l’ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle relatives au contrat d’édition est entrée en vigueur le 1er décembre 2014 – voir ici la synthèse éclairante d’Emmanuel Pierrat.
J’ai fait deux procès à des éditeurs indélicats, et j’ai gagné les deux en première instance. Le premier avait ressorti sans me le dire un roman vieux de dix ans comme si c’était une nouveauté. Cet oligophrène avait pensé à changer la couverture, mais pas la date de l’achevé d’imprimer. Il ne m’avait jamais rémunérée et j’avais laissé courir, mais il n’aurait pas dû remettre ça. La seconde avait diffusé une traduction qui prenait la poussière depuis longtemps sur ses étagères sans m’en avertir, et surtout, sans que j’aie corrigé les épreuves d’imprimerie. Elle avait introduit plein de fautes et d’incohérences de son cru, mais c’est moi qui signais ce désastre – adieu ma réputation de traductrice !
Des auteurs chevronnés m’ont avoué n’avoir jamais demandé de comptes à leurs éditeurs. Ils avaient peur d’être rejetés s’ils transgressaient les règles non écrites du paternalisme ambiant. Peur aussi d’être blacklistés, disaient-ils. Si l’on reste toute sa vie un môme craignant la fessée, on ne risque pas de se professionnaliser ! Le fond de l’affaire, c’est qu’ils pouvaient se le permettre, ayant un métier salarié. Moi, je n’ai pas le choix. Si je veux régler mes factures, récupérer les sous qu’on me doit est une obligation.
Car si je ne me prends pas au sérieux, qui le fera ? (bis)
Je n’ai pas été blacklistée après mes procès, je suis juste restée une midlister, cette espèce menacée d’auteurs qui vendent autour de 500 exemplaires et dont l’édition actuelle rêve de se débarrasser.
Un jour, deux éditeurs se sont vantés devant moi de n’avoir jamais versé un centime de droits à quiconque. Ces gens-là vivent plutôt bien (résidence secondaire et tutti quanti) en exploitant des individus économiquement faibles, les auteurs précaires. Je précise qu’il s’agit d’éditeurs ayant pignon sur rue et bonne réputation ; l’un œuvre dans la poésie, l’autre dans l’essai académique (je ne les cite pas, car eux n’ont jamais été condamnés). Choquant, non ?
J’ai reçu récemment un relevé de comptes d’éditeur. Voici comment il se présentait : « À cette date, vos droits d’auteur se clôturent par un solde débiteur égal à € XXX,XX, à amortir par de prochains droits. Signé : le service Comptabilité auteurs. »
Quand on lit ça, on se sent tout de suite vaguement coupable, infériorisé, pauvre type. On est perçu comme un débiteur même quand on a vendu des exemplaires. Débiteur-né en quelque sorte – comme si on avait fait une mauvaise manière à l’éditeur en travaillant pour lui ! Dans ce cas précis, il s’agissait d’une traduction d’une langue rare. Ce courrier aurait pu être ainsi rédigé : « Nous avons le plaisir de vous informer que, 22 ans après sa parution, le titre de cet auteur confidentiel s’est vendu en moyenne à 50 exemplaires par an entre 2011 et 2014. Nos plus sincères félicitations ! » Car c’est en fait un record de vente exceptionnel dans sa catégorie.
Quelqu’un pourrait-il s’atteler à reformuler ce satané courrier de façon plus avenante, au nom de toute la profession ? Ça lui prendrait un quart d’heure et ça améliorerait considérablement les relations auteurs-traducteurs/éditeurs.
Allez, dans un prochain billet je vous raconterai comment, en plus d’être deux en une, je suis devenue quelqu’un d’autre, voire plusieurs autres.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Faut-il coucher pour être publiée?
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#sexisme #misogynie #harcèlement #féminisme
Longtemps j’ai hésité avant d’intituler ainsi ce billet. J’ai pensé à l’édulcorer en « Y a-t-il du sexisme dans l’édition ? » Ou : « Être une femme écrivain, est-ce un handicap ? »
Bien qu’à mon avis la réponse à ces deux questions soit positive, je savais que le cœur de ma réflexion était exactement défini par le titre retenu – avec un E à publiéE, puisque je ne parle ici que de ce que je connais d’expérience, le point de vue féminin.
Autant le dire tout de suite : je n’ai jamais couché pour être publiée. Si bien que je ne saurai jamais comment aurait tourné ma carrière si je l’avais fait avec les éditeurs qui me l’ont proposé. Aurais-je dû renoncer à rédiger ce billet, faute de pouvoir le structurer en :
– point 1 : les fois où j’ai dit non,
– point 2 : les fois où j’ai dit oui,
– point 3 : la parole est à la défense ?
Je ne peux honnêtement traiter que le point 1. De plus je réalise, piteuse, que je n’ai jamais eu l’idée ou l’audace d’interroger mes consœurs : « Et toi, est-ce que ce genre de chose t’est arrivé ? Raconte-moi ! », ce qui m’aurait fourni un point 4. En soi, c’est un signe d’autocensure. Être une femme, hélas, ne m’évite pas d’être modelée par les préjugés de la société où j’évolue.
En fait, je n’ai jamais rien lu ni entendu sur ce sujet. Jamais, nulle part ! J’en ai déduit que, si je voulais en discuter, je devais amorcer le débat moi-même. Et donc, y aller carrément.
[Je vous entends d’ici : « Pfff, cette Nila est vraiment prête à tous les racolages pour faire monter ses statistiques de visites ! » Bon, j’avoue que l’idée de lancer un site du genre PubliLeaks®, qui révèlerait les dessous malodorants de l’édition française, m’amuserait cinq minutes. Mais je préfère partager mon vécu dans ce blog, avec une petite touche satirique…]
Reportons-nous au mythique âge d’or de mes débuts dans l’édition. J’ai alors publié deux romans. Le dirdecol’ qui m’a « découverte » est un vieux monsieur. Appelons-le M. Julien (tous les noms ont été changés). M. Julien m’invite souvent à déjeuner aux frais de la princesse (ça me change des betteraves, voir ici). Il va bientôt prendre sa retraite et prépare sa succession. Il me présente à M. Aristide, jeune loup aux dents longues, habile et influent, pour le remplacer auprès de moi. Je rencontre ce dernier deux ou trois fois en tête-à-tête. Il me fait des avances, m’envoie des télégrammes passionnés (rappelez-vous, je n’ai pas le téléphone) qui m’embarrassent beaucoup.
C’est alors que M. Julien m’informe qu’une femme, Mme Gervaise, souhaite également s’occuper de moi. Elle est partie de rien, un poste de secrétaire, et lutte pour devenir éditrice à part entière. Je déjeune avec elle (attention, être un jeune auteur sur qui mise un éditeur établi peut faire prendre du poids). Il y a à l’époque très peu de femmes dans l’édition, sa volonté et son dynamisme m’impressionnent. Je la choisis, soulagée à l’idée de ne plus avoir à éconduire M. Aristide. Fin de l’Acte Un.
Quelle idiote je suis ! Immédiatement, M. Aristide cesse de me saluer dans les couloirs de la maison. Il ne m’adressera plus jamais la parole au cours des années qui suivent, lorsque je le croiserai dans les cocktails et autres lieux de reproduction littéraire. Pas seulement lui : sa cour aussi – et elle est nombreuse. Des gens qui m’invitaient à déjeuner (hum…) sans raison particulière, cessent non seulement de le faire, mais aussi de me saluer. Serais-je devenue transparente ? Cela ne va pas durer, voyons ! Naïve et provinciale, je suis incapable d’interpréter ces faits et d’anticiper leurs conséquences à terme. J’entame la rédaction de mon prochain roman sans m’en préoccuper davantage.
Mme Gervaise tombe gravement malade dans l’année qui suit (trop de pression pour cette pionnière ?). Elle ne s’occupe plus du tout de moi. Je suis récupérée de justesse par M. Julien, qui a gardé un pied dans la maison, mais a forcément perdu beaucoup de son influence. Il parvient à contourner M. Aristide au comité de lecture, et mon troisième livre paraît dans l’indifférence générale. Les attachées de presse qui me fêtaient pour les deux premiers m’ignorent totalement. Aucun article, ventes dérisoires. Or je suis encore liée à cet éditeur par la clause du droit de préférence ou droit de suite pour deux autres livres (clause à ne jamais signer, mais elle tend à disparaître des contrats). Fin de l’Acte Deux.
M’en fout, M. Julien m’invite toujours à déjeuner ! Et il me fait de plus en plus de confidences. Il a une épouse légitime, de sa génération, et une maîtresse officielle, qui pourrait être sa petite-fille. Il l’a lancée dans le journalisme où elle fait carrière grâce à ses relations (les petites amies de journalistes, d’auteurs ou d’éditeurs poussées par ces derniers sont légion, mais là n’est pas la question). M. Aristide en a eu un enfant, adopté par son épouse (vous suivez ? y aura une interro à la fin), à qui il n’a jamais caché sa liaison. Mais patatras ! voilà que sa maîtresse le quitte (pour une femme, d’ailleurs, mais là n’est pas non plus la question). M. Julien est effondré, son cœur saigne, son orgueil masculin est blessé.
Mais je suis là, moi ! À sa portée, et point trop repoussante. Deux mois plus tard, M. Julien me déclare sa flamme dans une lettre ma foi fort bien tournée. Je fais le calcul : il a 47 ans de plus que moi. Une paille…
J’éconduis gentiment M. Julien, avec qui je parviens à rester en contact amical jusqu’à sa mort. Pendant ce temps, M. Aristide poursuit son ascension fulgurante et devient un baron des lettres, un faiseur de Prix. Il y aura toujours beaucoup plus de femmes que d’hommes dans son « écurie » (pourquoi ne dit-on pas « plus de pouliches que d’étalons » ? voilà un champ sémantique bien bancal).
Et moi ? Je suis définitivement grillée dans la maison. Obligée d’attendre deux refus de suite pour me libérer de la fameuse clause de préférence. Balzac, au secours, les épiciers sont de retour ! Je mettrai des années pour retrouver un éditeur. Fin de l’Acte Trois.
Je citerai encore un cas parmi d’autres. Il s’agit cette fois de mes travaux mercenaires, mes jobs alimentaires. Un homme, lui aussi âgé, me reçoit chez lui pour discuter d’une collaboration d’écriture. Je suis ravie d’obtenir cette commande car mes finances sont au plus bas, ce projet destiné à durer plusieurs mois tombe à pic. Alors que nous venons juste de nous mettre d’accord sur tout, modalités et tarifs, il pose sans transition la main sur ma cuisse. Je lui restitue sa paluche en expliquant poliment que je ne suis pas disponible. Il semble comprendre. Nous nous séparons bons amis.
Que tu crois ! La commande, je n’en verrai jamais la couleur.
À quoi bon développer ? Les anecdotes du même tonneau se suivent et se ressemblent au fil des années, affligeantes de conformisme. Selon mon expérience, les hommes français éconduits vous punissent toujours. J’ai établi une moyenne de dix ans de pénitence avant qu’ils daignent passer l’éponge. Plus de publications. Plus de commandes. Plus de revenus. Carrière en dents de scie.
Les premiers temps, j’interprétais cela comme des incidents de parcours, une sorte de série noire. Mais un beau jour j’ai tout remis en perspective, et j’ai admis qu’il s’agissait en fait d’une énorme injustice, qui affectait considérablement mon destin de femme et d’écrivain. Et voilà comment je suis devenue féministe !
Je rappelle aux jeunes lectrices qu’à l’époque, la notion même de harcèlement était encore dans les limbes. La pénalisation de tels abus restait à des années-lumière. Le fait d’utiliser sa position dominante pour obtenir des faveurs sexuelles était considéré non seulement comme normal, mais valorisant. Ces messieurs se vantaient entre eux de leurs « conquêtes ».
Mon tort est de n’avoir jamais parlé à quiconque de ces mésaventures. Elles faisaient partie du décor. Ainsi, je n’ai jamais révélé à M. Julien les raisons véritables de mon refus de M. Aristide. Ce silence complice en dit long…
Je suis convaincue que la question n’est pas réglée aujourd’hui, même si la législation a évolué. Le problème est avant tout culturel et éducatif. Le sexisme, le machisme, la misogynie sont très ancrés dans nos mœurs, y compris dans des secteurs qu’on imagine volontiers à l’abri de ces vilains penchants : le monde intellectuel et artistique, lettres, édition, journalisme, théâtre, musique, université (je me souviens d’un prof de fac s’exclamant : « Tu te rends compte, elle veut faire sa thèse sur une femme, et contemporaine, en plus ! » – or ce prof était… une prof), sans même mentionner le monde politique, bien connu pour cela.
Peut-être que, dans ces milieux qui affichent souvent des idées « progressistes », les hommes croient sincèrement avoir surmonté le problème ? Cela expliquerait que le déni y soit plus puissant qu’ailleurs. Quand finalement, j’ai rapporté quelques-unes de ces histoires à de sympathiques confrères, ils ont réagi ainsi : « Si ce n’était pas toi qui me le racontais, je ne le croirais pas. » Eh oui, messieurs, c’est tout le problème : vous n’y croyez pas parce que vous ne le pratiquez pas. C’est déjà ça, mais bon sang, réveillez-vous, et indignez-vous pour nous !
Pas plus tard que la semaine dernière, une jeune éditrice qui aurait dû succéder à un éditeur parti à la retraite, m’a raconté son entretien avec le directeur. Il lui a balancé carrément qu’il ne voulait pas d’une femme à ce poste-là, et qu’il allait nommer un homme extérieur à la boîte. Ce qu’il a fait, tout en augmentant le salaire de la jeune femme en guise de compensation… (Sur l’inégalité hommes/femmes dans les secteurs culturels, reportez-vous à ce rapport récent.)
Élargissons la focale : en France, le manque de statut est un handicap dans un système encore marqué par l’Ancien Régime, où prévaut la reproduction des élites. Si l’on est isolée, sans appui, ni « fille de » ni « femme de », n’ayant pas fait la grande école qu’il faut, alors on est une proie facile. C’était mon cas, et malheureusement, je n’avais personne dans mon entourage pour m’éclairer et me conseiller.
Par la suite, j’ai en partie résolu le problème en m’adressant de préférence à des éditrices. Elles sont de plus en plus nombreuses dans le métier et, depuis quelques années, elles parviennent enfin au sommet de la hiérarchie, comme on le voit dans cet article. En outre, il y a actuellement toute une génération de « filles de » qui succèdent à leurs papas, nous informe Livres-Hebdo d’aujourd’hui. Mes étudiants en édition sont désormais des étudiantEs, sauf exception (nous pratiquons même la discrimination positive envers les garçons, les recrutant à un niveau moindre que les filles !).
Mais ne nous réjouissons pas trop vite : on sait que les professions se féminisent lorsqu’elles sont abandonnées par les hommes, qui n’y trouvent plus suffisamment de prestige, de pouvoir, de salaires élevés. C’est le cas par exemple de la traduction ou de l’enseignement, secteurs presque entièrement féminisés.
Depuis des années, j’aborde au moins une fois les questions de sexisme avec mes étudiantes, les exhortant à changer les mentalités une fois qu’elles seront aux commandes. Nous allons bientôt savoir si ce sera le cas… Je les mets en garde contre l’idée implicite que le travail artistique d’une femme peut attendre, qu’il a moins de valeur que celui d’un homme. Je leur explique que certains sujets de livres sont perçus comme non-féminins. Elles doivent en prendre conscience pour éviter de censurer ou d’écarter des manuscrits émanant de femmes. Il n’y a pas que la vie du corps, les sentiments, l’amour, les parents vieillissants, les enfants difficiles, et autres sujets socialement acceptables, qui leur soient réservés. Il y a aussi la politique, les luttes sociales, la guerre, la finance, la science, que sais-je encore…
 Comme disait Virginia Woolf : « Il est néfaste pour qui écrit de penser à son sexe. Il est néfaste d’être purement homme ou femme ; il faut être féminin-masculin ou masculin-féminin. »
Comme disait Virginia Woolf : « Il est néfaste pour qui écrit de penser à son sexe. Il est néfaste d’être purement homme ou femme ; il faut être féminin-masculin ou masculin-féminin. »
Mon plus grand défaut est d’être née avec la certitude que j’étais l’égale des hommes. Franchement, je ne sais pas d’où me vient cette bizarrerie ! Ainsi je n’ai aucun regret d’avoir dit non aux éditeurs, malgré les conséquences imprévues. Aucune fierté non plus : c’est comme ça, voilà tout. On ne se refait pas.
Je sais, je n’ai pas répondu à la question posée dans le titre. Parce que c’est à vous, mes chères consœurs, d’y répondre à votre manière…
Mais il était temps de parler de ces choses-là, vous ne croyez pas ?
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Les représentants en librairie
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#représentant #librairie #diffuseur #diffusion #livres #visibilité #pointdevente #programmeéditorial
Longtemps j’ai méconnu le rôle-clé des représentants en librairie, qu’on appelle aussi diffuseurs, terme également appliqué en bout de chaîne aux libraires.
Mon premier contact avec eux a eu lieu au petit matin. J’ai été réveillée par une lettre que la concierge glissait sous la porte de ma micro-chambre de bonne. L’idée d’avoir le téléphone à domicile étant encore à mille lieues de devenir simplement envisageable, on ne me joignait jamais que par courrier. L’événement était si rare que je me suis immédiatement levée pour décacheter la lettre. Mon éditeur me convoquait deux heures plus tard pour présenter mon premier roman. À qui ? Aucune précision.
J’ai sauté dans mes pantoufles et j’ai poussé à fond le radiateur à huile. J’ai posé dessus le carton de lait du petit déjeuner, qui avait gelé pendant la nuit et s’était transformé en paillettes bien pratiques en termes d’économie d’espace. Nul besoin de frigo, l’hiver suffisait.
En arrivant chez l’éditeur, dans la salle de réunion souterraine, tout essoufflée d’avoir couru, je tremblais comme une feuille. D’abord parce que je ne savais pas quoi dire. Je croyais qu’il me suffisait d’écrire, et que tout le reste appartenait aux professionnels. Je n’avais aucun recul sur mon roman, je n’avais pas préparé de discours pour le « défendre », selon le terme en usage (en l’écrivant, je me vois toujours enfiler une cotte de mailles et coiffer un heaume, empoigner une lance et affronter en tournoi mes rivaux, tchak, poïng).
Ensuite parce que je ne savais pas du tout qui étaient et ce que faisaient les messieurs (uniquement des hommes à l’époque) d’âge mûr et fort impressionnants pour le bébé-écrivain que j’étais, assemblés dans un silence recueilli autour de la grande table ovale. Malgré la présence rassurante de mon éditeur qui n’avait pas eu le temps de me briefer avant, je crevais de trouille. Surtout que l’un d’eux, que j’avais identifié comme le chef de meute, avait enclenché un petit magnéto-cassette pour capter mes balbutiements hachés par le trac…
Trop timide, je n’ai pas osé demander, une fois l’épreuve terminée, à quoi servait cette réunion. Longtemps après, j’apprendrai qu’on appelle familièrement ces messieurs les « représ’ » (représentants). Ils sont les VRP du livre, les arrière-petits-cousins de ces vendeurs de bibles ou d’encyclopédies à domicile dont les films américains nous présentent parfois l’ingrate mission. Leur rôle d’intermédiaires est essentiel dans la commercialisation du livre.
Pourquoi ?
Quelle que soit la qualité du livre, quelle que soit sa couverture médiatique, s’il n’est pas visible sur les points de vente, ce sera à coup sûr un échec commercial.
Reprenons l’exemple de mon dernier bouquin, ce document d’intérêt général déjà évoqué dans ce blog : 475 exemplaires ont été mis en place à sa parution – diffusion très maigrichonne sur la France entière. Pas de miracle : seuls 315 exemplaires ont été vendus la première année, hors ventes en ligne et avant « réassort’ » (réassortiment), malgré une couverture médiatique honorable (voir ici).
Qu’est-ce qui explique concrètement ce score médiocre ?
- L’acheteur potentiel m’entend parler à la radio, il est intéressé par le sujet, il mémorise le titre. Naturellement, il va l’oublier très vite. Mettons qu’il passe dans sa librairie habituelle dans les jours qui suivent et qu’il n’y trouve pas mon ouvrage: la vente est définitivement perdue.
- L’acheteur potentiel n’a jamais entendu parler de mon livre, mais il est intéressé par le sujet. Il passe dans sa librairie habituelle pour une toute autre raison, et là, il ne tombe pas par hasard sur mon ouvrage au milieu des autres : la vente est définitivement perdue.
La visibilité et la longévité (souvent grâce au bouche-à-oreille) sont les clés du succès. Dans l’Ancien monde, mon troisième roman est resté deux ans en vitrine dans une librairie située Place de l’Odéon, à Paris. J’ai vu littéralement se faner les couleurs de la  couverture au fil des saisons. (Vous n’avez pas connu cet Ancien monde, où les linéaires de yaourts dans les supermarchés mesuraient tout au plus un mètre cinquante ? Quel dommage…) Ça laissait à un titre et un auteur tout le temps nécessaire pour s’installer dans le paysage littéraire.
couverture au fil des saisons. (Vous n’avez pas connu cet Ancien monde, où les linéaires de yaourts dans les supermarchés mesuraient tout au plus un mètre cinquante ? Quel dommage…) Ça laissait à un titre et un auteur tout le temps nécessaire pour s’installer dans le paysage littéraire.
Attention, je ne suis pas du tout en train d’imputer mes échecs commerciaux aux seuls représentants. Là encore, il s’agit de décrire un système défaillant, à bout de souffle, et surtout, de dénoncer une offre pléthorique structurelle (67.000 nouveautés par an en France) dont les représ sont les premières victimes.
Au fait, en quoi consiste leur travail ?
Il complète le système de l’office décrit ici. Les représ se déplacent à la rencontre de chaque responsable de point de vente pour lui présenter le programme éditorial des deux ou trois mois à venir, et tenter de le convaincre de passer des commandes fermes – ce qu’on appelle les « notés ». Pour chaque titre ils disposent d’une minute environ, restant souvent debout, et rarement dans un coin retiré. Leur situation n’a rien de confortable et leurs nuits passées dans des hôtels perdus, loin de leurs proches, n’ont rien de glorieux. Pour mieux le comprendre, lisez ce témoignage de l’un d’entre eux.
Les représ sont classés par niveaux et par secteurs (régions ou départements). En gros, la segmentation des points de vente distingue un premier niveau constitué par les grandes librairies et grandes surfaces culturelles, qui sont visitées plus fréquemment et obtiennent des remises plus élevées (les trois-quarts du chiffre d’affaires des diffuseurs). Un deuxième niveau regroupe les points de vente de proximité, les supermarchés et les magasins populaires. Enfin les petits détaillants et les points de vente occasionnels (par exemple les salons du livre) forment le troisième niveau ; ils s’approvisionnent directement auprès de grossistes ou des plateformes régionales des distributeurs, et n’ont donc pas affaire aux représ.
Tous les deux mois, et environ quatre mois avant parution, les représ sont convoqués à une réunion diffuseurs où le planning de nouveautés du groupe (plusieurs maisons) leur est présenté par les éditeurs, les dirdecols, et parfois les auteurs eux-mêmes (c’est ce qui m’est arrivé ce fameux matin frisquet où j’ai été réveillée par une lettre).
Pendant deux jours ils sont logés, nourris, et gavés de programmes inflationnistes (Fred le libraire décrit tout cela avec beaucoup de verve dans son blog). On leur remet un dossier concocté par le service communication ou par les éditeurs. Chaque nouveau titre est décrit dans une « fiche repré’ » ou « argu’ diffuseur » (argumentaire), contenant des métadonnées telles que le prix public, la date de mise en vente, l’ISBN, plus le visuel de couverture en couleur, un synopsis et les arguments à mettre en avant.
Puisque j’ai fait mon coming-out récemment, vous savez que j’ai été un temps dirdecol. J’ai constaté qu’une question revenait de plus en plus souvent dans les réunions des représ : « Dans quel rayon faut-il le mettre ? » Ce qui confirme que les catégories de genres sont de plus en plus nombreuses et étroites. Voyons, dans quel rayon mettriez-vous Jules Verne (l’auteur français le plus vendu au monde, encore de nos jours), messieurs et (depuis dix-quinze ans) mesdames ? Jeunesse ? Vulgarisation scientifique ? Aventures ? Voyage ? Anticipation ? Fantastique ?
Tout à fait comme pour les yaourts. Nature ? Aux fruits ? Allégés en matière grasse ? Avec ou sans édulcorants ? Additionnés en… Aaaarrgh !
J’ai aussi remarqué empiriquement que mieux valait passer devant les représ le premier jour avant le déjeuner, que le second jour après le déjeuner, pour des raisons évidentes. Les pauvres sont épuisés, saturés d’informations, et vous ne pouvez espérer capter leur attention qu’un très court instant.
 Ah, douce Tania, t’en souvient-il, ma mie ? (L’adorable Tania était notre chargée de communication.) Nous nous creusions la tête pour imaginer quelque chose qui sortirait du lot notre camelote, qui arracherait les représ à leur torpeur post-prandiale, qui leur prouverait à quel point nos livres étaient différents, meilleurs, tellement plus dignes d’être « défendus » (ouille) que les autres. Nous avions envisagé de nous costumer, de nous grimer, de monter sur la table et de danser un french cancan endiablé… Sans jamais passer à l’acte, bien sûr. Ah, Taniouchka, je ne dirai pas que c’était le bon temps, mais au moins, on rigolait bien dans les intervalles où on ne bossait pas comme des malades.
Ah, douce Tania, t’en souvient-il, ma mie ? (L’adorable Tania était notre chargée de communication.) Nous nous creusions la tête pour imaginer quelque chose qui sortirait du lot notre camelote, qui arracherait les représ à leur torpeur post-prandiale, qui leur prouverait à quel point nos livres étaient différents, meilleurs, tellement plus dignes d’être « défendus » (ouille) que les autres. Nous avions envisagé de nous costumer, de nous grimer, de monter sur la table et de danser un french cancan endiablé… Sans jamais passer à l’acte, bien sûr. Ah, Taniouchka, je ne dirai pas que c’était le bon temps, mais au moins, on rigolait bien dans les intervalles où on ne bossait pas comme des malades.
Si l’auteur est convié à cette cérémonie, la règle d’or pour réussir l’épreuve se résume à ceci : « Pitchez votre livre en trois minutes chrono. » Vous avez drôlement intérêt à vous préparer, à répéter comme pour passer une scène de théâtre. Longueur du résumé, deux lignes maximum. Nombre de points forts, pas plus de trois. Ordre d’apparition : le plus important en premier. Pour conclure : une pirouette, un clin d’œil, un jeu de mots. Faites-les rire, ou du moins, arrachez-leur un sourire ! Ils en conserveront peut-être une vague impression de chaleur, qui aura des chances de se raviver lorsque, devant le libraire, votre fiche tombera à nouveau sous leurs yeux.
Et surtout, ne dépassez jamais le temps qui vous est imparti : les représ vous en seront reconnaissants.
Tiens, je vais terminer ce billet comme je l’ai commencé, par une histoire vraie. Celle-ci a lieu un quart de siècle plus tard, et c’est désormais un écrivain blasé qui s’exprime :
Hier, en fin d’après-midi, je devais présenter mon nouveau livre aux diffuseurs. Il faisait très froid dans le hall sans âme de l’hôtel. Et malédiction ! le bar était fermé. Aucun espoir de se réchauffer. Je faisais antichambre incognito (un domaine où j’excelle, l’incognito) en compagnie de quelques dirdecols et autres commerciaux, plus trois personnalités : Pénal, pape du polar, Surin, éminence grise, et un type très sympathique, qui s’avéra avoir dirigé la section espagnole d’un grand périodique.
J’écoutais sans y prendre part les propos qu’échangeaient ces gens bien informés. On s’attaqua d’abord au supplément littéraire du quotidien de référence, qui en prit pour son grade. On le compara à son homologue new-yorkais, à l’avantage duquel ? devinez. On s’étonna que des gens continuent à lire ce torchon, fort peu nombreux à la vérité. Mais que voulez-vous, les auteurs, eux, appréciaient toujours d’y obtenir une critique, pour leur image de marque.
Je commentai mezzo-voce : « Ce qui est bizarre avec le prestige, c’est qu’il perdure au-delà de toute raison. Un peu comme la lumière fossile d’un astre mort. » Les barons des lettres me jetèrent un coup d’œil pour la première fois. « Bien dit ! fit l’un. – Le sens de la formule ! approuva l’autre. – Vous devriez écrire », suggéra le troisième. J’opinai modestement : « Je vais y penser », murmurai-je.
La conversation dévia sur les stars féminines du cinéma d’antan. Surin détestait Marlène Dietrich, Pénal l’idolâtrait. Greta Garbo fut jugée unanimement masculine. « Et Ava Gardner ? » intervins-je. À nouveau, je tombai juste : Gardner était sublime, désirable pour l’éternité. Nous nous sentions soudain très proches les uns des autres.
Je ne sais comment, l’Espagnol en vint à mentionner ses tatouages. Il révéla qu’il en avait sur tout le corps (ce n’était pas un géant). « Un pour chaque livre », fit-il, mystérieux, en ouvrant un bouton de col afin de nous montrer un échantillon. « Mais ça ferait un merveilleux sujet de roman, m’exclamai-je. Un chapitre par tatouage, imaginez l’histoire fantastique que ça pourrait donner ! » Lui me tutoyait déjà, à l’espagnole. Nous nous aimions tendrement.
C’est alors qu’il fut appelé dans la salle où l’on officiait. Il fournit sa prestation de trois minutes et ressortit. « Alors, vous leur avez parlé de vos tatouages ? » demandai-je, enjôleuse. Il secoua la tête. Nous échangeâmes encore quelques mots. J’appris qu’il était le père d’un chanteur connu de tous, sauf de moi.
Entre-temps, Pénal et Surin s’étaient fait la malle sans nous saluer. L’Espagnol s’éclipsa à son tour. Je continuai à poireauter, seule dans le hall glacial.
Bientôt ce serait mon tour. Je n’avais plus peur, mais c’était beaucoup moins excitant qu’autrefois.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Le refus d’éditer
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#refusdéditer #lettrederefus #éditeurs
Longtemps j’ai été épargnée par les refus d’éditer. Alors que la plupart des auteurs essuient d’innombrables échecs à leurs débuts, j’ai été très chanceuse.
Heureusement j’ai été rattrapée par la réalité.
Je dis « heureusement » parce que je trouve que c’est mieux ainsi. N’ayant pas eu l’occasion de m’endurcir à mes débuts, j’évoluais dans un monde enviable, sans doute, mais pétri d’illusions. Or en toutes circonstances, il est préférable pour un écrivain de se confronter au monde tel qu’il est. Et mieux vaut s’endurcir quand on est jeune qu’à mi-parcours…
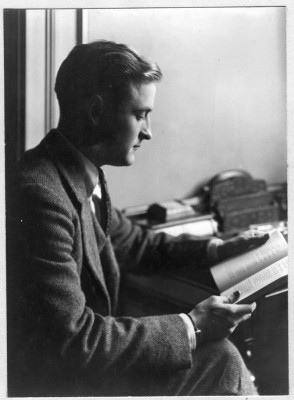 Quand le grand Francis Scott Fitzgerald est tombé amoureux pour la dernière fois de sa vie, il a dit à sa chérie que, vingt ans plus tôt, il avait connu la gloire en tant qu’écrivain.
Quand le grand Francis Scott Fitzgerald est tombé amoureux pour la dernière fois de sa vie, il a dit à sa chérie que, vingt ans plus tôt, il avait connu la gloire en tant qu’écrivain.
Elle ne l’a pas cru.
Il l’a alors emmenée dans une librairie pour lui prouver qu’il ne mentait pas. Le libraire n’avait aucun de ses livres en rayon.
Imaginez la tête de la fiancée. Imaginez surtout l’état d’esprit du pauvre Fitzgerald…
Lui qui avait connu le succès très jeune, il est mort totalement oublié, à 44 ans. Il est mort sans se douter qu’un jour, quelqu’un se souviendrait de lui, adorerait ses nouvelles, et lui rendrait hommage.
Se rappeler cette histoire aide à panser les blessures d’amour-propre, à les relativiser, non ?
Je voudrais aborder ce thème du refus sous l’angle peu exploité de la psychologie.
Que se passe-t-il en nous quand nos écrits sont refusés ? Bien souvent, nous nous sentons niés dans notre moi le plus profond, le plus authentique. « On me rejette. On me dédaigne. Je suis incompris(e). »
En fait, ce sont des sentiments infantiles… Oh, rassurez-vous, je les éprouve toujours ! Mais j’essaye de les neutraliser, de me déconditionner en me répétant ceci : c’est mon travail qui est refusé, pas moi en tant que personne.
S’identifier à ce que l’on crée est naturel, mais en fin de compte, absurde. Il y a d’un côté Nila, la personne. Il y a de l’autre ce qu’elle écrit. Et quand elle sort de chez elle à la rencontre d’un éditeur, elle n’est plus Nila l’artiste, mais Kazar la professionnelle. Ou du moins, elle devrait.
Vous verrez qu’en s’entraînant à faire cette distinction, on souffre moins.
Si l’on sait que les raisons d’un refus sont très souvent triviales et contingentes, qu’elles tiennent à des questions de hasard, d’humeur, d’incompétence, de surmenage, de copinage, de coucherie, de rivalité, de chapelles, d’erreur d’aiguillage, de classement erroné, de changement de personnel ou de ligne éditoriale, de calculs intéressés, de mauvaise digestion, de grosse fatigue, de pure maladresse ; si l’on se rappelle de plus que l’éditeur est – comme vous – une personne libre de ses choix, et que votre livre est en compétition avec beaucoup d’autres, l’amertume s’efface.
(Au fait, il en va de même pour les raisons d’une acceptation, elle sont souvent contingentes, ce qui est plus gênant à admettre, n’est-ce pas ? 😉 )
 Les éditeurs commettent tout le temps des erreurs d’appréciation, c’est inhérent à leur profession… et à leur statut d’être humain ! S’il y avait une recette infaillible, cela se saurait. Je ne suis pas convaincue, comme la plupart d’entre eux l’affirment en toute bonne foi, qu’un bon texte finira forcément par trouver sa place. Pierre Jourde ne le croit pas non plus. Il affirme que le corpus publié n’est que la surface émergée de l’iceberg littéraire, et prétend détenir lui-même le record du plus grand nombre de manuscrits refusés en France, pendant vingt-trois ans !
Les éditeurs commettent tout le temps des erreurs d’appréciation, c’est inhérent à leur profession… et à leur statut d’être humain ! S’il y avait une recette infaillible, cela se saurait. Je ne suis pas convaincue, comme la plupart d’entre eux l’affirment en toute bonne foi, qu’un bon texte finira forcément par trouver sa place. Pierre Jourde ne le croit pas non plus. Il affirme que le corpus publié n’est que la surface émergée de l’iceberg littéraire, et prétend détenir lui-même le record du plus grand nombre de manuscrits refusés en France, pendant vingt-trois ans !
Le plus difficile à affronter pour un auteur en mal de reconnaissance – et le cas le plus fréquent –, c’est l’indifférence. Les éditeurs sont nombreux à ne pas réagir du tout à votre stimulus pourtant si aimable. Ils font la sourde oreille et sont aux abonnés absents, même quand on les connaît personnellement depuis longtemps. Cela m’est arrivé plus d’une fois. Vous croyez qu’on vous ignore parce que vous débarquez de nulle part ? Pas du tout. On vous ignore parce que… c’est comme ça dans ce milieu. Il n’y a aucun motif rationnel à cette coutume tribale, pas même le manque de temps. Je la trouve exaspérante, odieuse, j’ai envie de hurler et de grimper aux rideaux du fait de mufleries insensées, de bêtises inexcusables.
Je ne m’y fais pas. Mais mon pragmatisme m’incite à l’intégrer comme une donnée de l’équation. Et moi, je réponds par principe à tous ceux qui me sollicitent.
Face à l’indifférence, un écrivain digne de ce nom doit réagir comme un individu résilient : en se guérissant d’un échec par une nouvelle tentative. J’aime à dire que l’obstination est un trait de caractère indispensable chez tout artiste. Le talent est beaucoup plus répandu qu’on ne croit ; l’obstination est rare, et fait toute la différence. Un écrivain doit absolument se fabriquer une carapace et repartir à l’assaut, puisque par définition, il propose quelque chose que personne ne lui a demandé.
Que symbolise l’éditeur dans ce duel ? Papa, Maman, le bon Dieu ? Un peu tout ça, mais surtout, l’instance supérieure censée légitimer notre talent et nous adouber en tant qu’écrivain. J’ai grandi dans cette conception et me suis pliée longtemps à ce système, accumulant les livres morts-nés entre deux parutions. J’ai été docile et conformiste, malgré mes échecs. Qui suis-je pour m’auto-légitimer ? me disais-je. Seule une instance supérieure est en situation de le faire.
Et c’est là qu’on rejoint la question de l’auto-édition, ce pas que je suis en train de sauter en devenant un auteur hybride (gasoil et sans plomb, numérique et papier). J’ai décidé de m’affranchir de ces limitations. Il est vrai que je n’ai plus à faire mes preuves, et que des signes de reconnaissance m’ont à peu près convaincue de ma légitimité en tant qu’auteur.
La raison de cette évolution personnelle ? L’occasion fournie par les nouvelles technologies, bien sûr. Mais aussi, la prise de conscience de mon intolérance croissante à la dépendance du désir d’autrui. Rester figée dans la position passive de la quémandeuse, dans l’espoir infantilisant d’être repérée, élue par autrui, m’est devenu insupportable. Je me suis réveillée un beau matin en me disant : c’est fini, plus jamais ça.
Rien de nouveau sous le soleil. Par exemple, Anaïs Nin a opté à un moment donné pour l’impression à domicile de ses œuvres : « À New York, les romans et les nouvelles qu’elle tente de publier sont refusés par les éditeurs. En janvier 1942, elle installe une petite presse dans un grenier et imprime elle-même ses livres. Elle n’est lue que par des cercles d’intellectuels et d’universitaires. » (Source : Alexandra Galakof, Le Buzz littéraire).
Comme elle, je suis condamnée à évoluer.
Disons que désormais, je pense que c’est la postérité qui fera le tri, plutôt que Machin. Et je m’en fiche un peu, pour tout vous dire. J’ai envie de conquérir un nouveau lectorat ici et maintenant, même clairsemé, en recourant à ces technologies numériques qui sont en train de bouleverser les habitudes, la chaîne de valeur, les hiérarchies.
Je voudrais à présent vous emmener avec moi de l’autre côté de la barrière. Oui, j’avoue : je suis un agent double, j’ai été éditrice ! (Non, pitié, pas les tomates !)
Oh, pas longtemps, pour diverses raisons dont l’une mérite d’être soulignée ici : j’avais trop d’empathie pour les auteurs dont j’étais obligée – oui, obligée – de refuser les propositions de manuscrits. Je m’identifiais à eux et ce dédoublement rendait mon activité difficile à mener sereinement. J’essayais de prendre des gants, j’argumentais longuement, je prenais garde à leur dire quelque chose de positif, de consolant, d’encourageant… Mais mon refus pouvait malgré tout susciter dépression, angoisse et dépit, je ne le savais que trop. Et cela me pesait.
La violence n’est pas toujours symbolique, elle peut devenir réelle. Certains éditeurs ne se contentent pas d’envoyer une lettre-type à la signature illisible, mais commettent un assassinat gratuit. Il peut s’agir de gens qui sont eux-mêmes auteurs… Intéressant, non ? Tuer son alter ego, son reflet, ça rassure, ça conforte dans sa position dominante.
Je me souviens d’un copain qui avait reçu une telle lettre de Yves Berger, grand manitou des éditions Grasset, qui se permettait de lui cracher dessus et de le piétiner.
Mon copain pourtant très inexpérimenté lui a répondu avec une dignité tranquille que, s’il était dans son rôle en ce qui concernait le refus d’éditer, il n’avait aucun droit de le traiter comme un paillasson.
Et devinez quoi ? Y. B. s’est excusé dans une autre lettre, précisant qu’il acceptait par avance de lire son prochain manuscrit.
Chapeau, les mecs. La classe !
Mais il faut tout de suite ajouter que la violence est symétrique : les éditeurs se font incendier par les auteurs refusés. Moi qui faisais si attention à ménager leur ego, je m’en prenais plein la gueule par retour de mail, vous n’avez pas idée…
Eh oui, tous les écrivains ne sont pas des anges ! Harcèlement, injures, dénigrement public ne les rebutent pas.
C’est dommage. Il devraient rester dignes, comme mon copain.
 M’enfin, après tout, dans la légende du métier, d’immenses auteurs un poil caractériels ont chapardé des machines à écrire dans les bureaux de leur maison d’édition sous prétexte que leurs droits n’étaient pas versés. Il y a même eu au moins un cas de suicide sous les yeux d’un éditeur récalcitrant, sans compter les chantages. Si si, c’est arrivé, croix de bois croix de fer ! Je vous recommande à ce propos le roman de Jean-Marie Laclavetine Première ligne, un polar nourri de faits réels (1999).
M’enfin, après tout, dans la légende du métier, d’immenses auteurs un poil caractériels ont chapardé des machines à écrire dans les bureaux de leur maison d’édition sous prétexte que leurs droits n’étaient pas versés. Il y a même eu au moins un cas de suicide sous les yeux d’un éditeur récalcitrant, sans compter les chantages. Si si, c’est arrivé, croix de bois croix de fer ! Je vous recommande à ce propos le roman de Jean-Marie Laclavetine Première ligne, un polar nourri de faits réels (1999).
Alors, quand les éditeurs se protègent par l’anonymat ou le silence, on peut les comprendre. Ils font un métier à risque…
Je ne peux conclure ce billet sans évoquer la plus belle lettre de refus de ma vie. Elle m’est parvenue un an après mon envoi, alors que je ne l’attendais plus. Elle était manuscrite, signée par Paul Otchakovsky-Laurens, le fondateur des éditions POL. Ce grand monsieur lit lui-même ce qui en vaut la peine, d’où le délai inhabituel (en général cela prend de 3 à 6 mois). En la parcourant, un sentiment étrange s’est emparé de moi : il a raison. Ses critiques sont justifiées. Il m’a comprise. Non, en fait il a compris mieux que moi ce que j’aurais dû faire, et il prend la peine de me l’expliquer. Finalement, c’est un soulagement que ce roman n’ait pas trouvé preneur sous sa forme actuelle. Ç’aurait été une erreur de le publier ainsi. Merci de l’avoir refusé…
Je l’aurais presque encadrée, cette lettre-là ! Mais il est vrai qu’elle est exceptionnelle.
En résumé, des deux côtés, respect et courtoisie s’imposent. Éconduire sans humilier. Exiger une réponse sans insulter. Faire des remarques constructives, comme le préconise par exemple Hannah MacDonald dans cet article. Préserver en toutes circonstances sa dignité, un bien que nul ne peut vous arracher.
Vous êtes un écrivain, que diantre ! Un descendant d’Homère, par l’escalier de service peut-être, mais vous n’êtes pas n’importe qui. Vous pratiquez l’un des arts les plus nobles, les plus anciens qui soient, un art qui s’enracine dans la nuit des temps : raconter des histoires à vos congénères, qui ne demandent que ça. Faites en sorte que cela se traduise jusque dans votre attitude.
Le plus de Bazar Kazar
Un mot encore sur la lettre de refus banalisée : elle est destinée à faire gagner du temps à Machin, pas à vous dévaloriser personnellement. Je reproduis ici la dernière que j’ai reçue :
« Madame,
Nous avons pris connaissance de votre projet d’ouvrage intitulé La Vengeance du rollmops et l’avons examiné avec intérêt.
Malheureusement, il ne correspond pas à ce que nous recherchons dans le cadre de notre ligne éditoriale et, pour cette raison, nous ne pouvons y donner suite.
Nous vous remercions toutefois de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder et vous prions de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Comité de Lecture
P.S. : Les éditions Dugenou ne sont malheureusement pas en mesure de vous remettre votre manuscrit. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. »
Je trouve cette dernière phrase très amusante…
Second plus (décidément, je vous gâte !) : ma traduction d’une lettre de refus (rejection letter) affreusement sarcastique d’un éditeur anglais à Gertrude Stein. Il y parodie le style de cet auteur avant-gardiste avec une verve irrésistible. La relire s’avère un remède radical pour soigner vos déceptions !
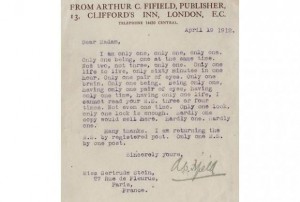 « Chère Madame,
« Chère Madame,
Je suis seulement un, un seul, un seul. Un seul être, un à la fois. Pas deux, pas trois, un seul. Une seule vie à vivre, seulement soixante minutes par heure. Une seule paire d’yeux. Un seul cerveau. Un seul être. Étant un seul, ayant une seule paire d’yeux, ayant un seul temps, ayant une seule vie, je ne peux lire votre manuscrit trois ou quatre fois. Pas même une fois. Un seul coup d’œil, un seul coup d’œil suffit. On n’en vendrait ici pas plus d’un exemplaire. À peine un. À peine un.
Merci beaucoup. Je vous retourne le manuscrit par lettre recommandée. Un seul manuscrit dans une seule lettre.
Cordialement,
Arthur C. Fifield. » (Londres, 1912)
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
L’édition à compte d’auteur
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#comptedauteur #auto-édition
Longtemps je me suis méfiée de l’édition à compte d’auteur. Et je continue.
À la différence de l’auto-édition (avec laquelle on la confond parfois), l’édition à compte d’auteur est un piège à éviter à tout prix. Je sais bien que des géants tels que Lewis Carroll et Marcel Proust ont publié à compte d’auteur… mais c’était une autre époque ! De nos jours, payer des escrocs pour être non pas « publié », contrairement à ce qu’ils vous affirment, mais juste « imprimé » : où est l’intérêt ? Avez-vous vraiment besoin d’eux pour ne pas commercialiser votre livre ?
La réponse est non, sans ambiguïté ! Pourquoi ?
En réalité, les éditeurs à compte d’auteur ne sont pas des éditeurs, ce sont des parasites qui s’enrichissent à vos dépens. Comment les repérer ? C’est très simple :
- Ils font de la publicité dans la presse, du type : « Les éditions Dugenou recherchent de nouveaux auteurs ». Les éditeurs étant inondés de manuscrits, à coup sûr ils font tout pour échapper au mien ou au vôtre ; alors, le solliciter par voie d’annonce est une démarche peu crédible, quasiment une perversion !
- Quand vous leur envoyez un manuscrit, ils vous répondent très vite, presque par retour de courrier. Normalement, ça prend des semaines, voire des mois, même s’il y a de rares exceptions.
- Ils vous chantent que vous êtes la perle rare qu’ils recherchent depuis toujours. Vos vers : « Poisseux comme barbe-à-papa / Tel est l’amour de Lolita » sont ce qu’ils ont lu de plus inspiré, de plus original depuis des lustres, et ils brûlent de vous publier.
Soyons clair : ce genre de chose n’arrive jamais avec les éditeurs dignes de ce nom. Même moi, qui ai vécu un conte de fées avec l’envoi par la poste à un unique éditeur d’un unique exemplaire de mon tout premier roman, sans aucune recommandation – même moi, on m’a fait attendre.
En plus, personne ne m’a dit que j’étais géniale (snif !). Mais au moins, personne ne m’a soutiré d’argent…
 Comment s’y prennent ces truands ? Eh bien, on peut dire qu’ils savent murmurer à l’oreille des nigauds.
Comment s’y prennent ces truands ? Eh bien, on peut dire qu’ils savent murmurer à l’oreille des nigauds.
Une fois qu’ils vous ont solidement ferré, innocent petit poisson que vous êtes, ils se mettent à geindre : « Toute l’équipe de Dugenou adore votre sublime recueil de poèmes, nous aimerions tellement le publier séance tenante, mais hélas, nous sommes trop pauvres pour assumer seuls cet investissement risqué, car votre œuvre est si exigeante qu’elle mettra du temps à s’installer, alors aidez-nous à vous rendre célèbre en finançant une toute petite partie de notre investissement… »
Et vous voilà en train de ponctionner les économies de Mémé pour régler les frais de fabrication. Ah, mais c’est pour une juste cause ! Quand on est un génie, on ne va pas mégoter, pas vrai ?
Votre livre enfin fabriqué, aucun libraire n’en verra la couleur ; le stock dormira au fond d’une cave pour l’éternité, excepté les exemplaires que vous aurez distribués vous-même à vos proches.
On se réveille sonné et sérieusement amoché d’une pareille duperie. On a honte de soi-même, alors que c’est Dugenou qui devrait avoir honte. C’est arrivé l’année dernière à l’une de mes étudiantes. Étonnée qu’elle fasse autant de fautes d’orthographe, je l’ai prise à part pour parler de ce problème. Entre autres choses, elle m’a confié sa mésaventure. Son manuscrit plein de coquilles n’avait vraisemblablement jamais été lu avant d’être fabriqué…
Pourtant, contrairement à moi, cette charmante enfant a grandi dans le monde merveilleux des nouvelles technologies. J’aurais cru que sa crédulité serait contrebalancée par les informations qu’on glâne partout sur le web. Mais elle avait tellement envie d’y croire… comme chacun d’entre nous !
Enfin, ça, c’était avant le numérique. Car un bénéfice secondaire du développement de l’auto-édition en ligne, c’est que les escrocs du type de La (défunte) Pensée universelle, ancêtre spirituel des Amalthée, Bénévent et autres truands (pour les identifier, appliquez-leur la grille en trois points décrite ci-dessus), vont crever faute de demande. Malgré leurs tentatives pour requalifier leurs pratiques peu reluisantes en « édition participative » (alors qu’il s’agit en fait de « louage d’ouvrage », voir ici), leurs jours sont comptés. Ni fleurs ni couronnes, on ne va pas pleurer.
Allez, puisque nous sommes entre nous, je vais vous raconter une anecdote authentique. Quand j’étais encore débutante, avec juste deux titres publiés, et que je galérais financièrement, j’ai passé une petite annonce dans un quotidien (papier, qu’est-ce que vous croyez ? c’était dans l’Ancien monde !) : « Jeune auteur cherche commandes d’écriture ».
Et très vite, Alain Moreau, patron de La Pensée Universelle, roi de l’arnaque du compte d’auteur, m’a appelée.
Quand je vous dis que ma vie est un conte de fées…
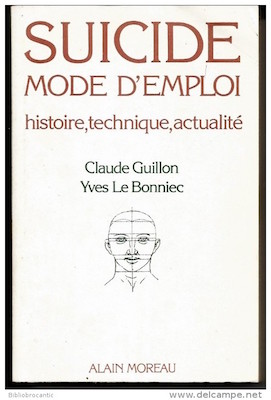 Le jour du rendez-vous, j’ai atterri dans un bel hôtel particulier du Marais. On m’a introduite dans une pièce où brûlait un feu de bois dans une cheminée d’époque. Le capo dei capi avait dû se payer ça avec son best-seller, Suicide, mode d’emploi. Et accessoirement, avec les économies de Mémé… Moi qui sortais de ma chambre de bonne de moins de 7 m2, j’hallucinais !
Le jour du rendez-vous, j’ai atterri dans un bel hôtel particulier du Marais. On m’a introduite dans une pièce où brûlait un feu de bois dans une cheminée d’époque. Le capo dei capi avait dû se payer ça avec son best-seller, Suicide, mode d’emploi. Et accessoirement, avec les économies de Mémé… Moi qui sortais de ma chambre de bonne de moins de 7 m2, j’hallucinais !
Mais ce n’était rien à côté de ce qu’il m’a proposé : « Je projette de publier un livre intitulé Conseils aux jeunes auteurs. Il faudrait que ça semble sorti de la plume d’un vieux briscard de l’édition. Vous ne le signerez pas, bien sûr. On vous inventera un pseudonyme. Et certains chapitres seront pris en charge par la maison. » J’ai supposé qu’il s’agissait de ceux concernant l’édition à compte d’auteur, qu’il pratiquait à grande échelle. Ça m’arrangeait, déjà à l’époque je ne me voyais pas en faire l’éloge…
« Alors, vous pourriez nous écrire ça ? »
Non, je ne rêvais pas : ce type était en train de demander à un auteur débutant de rédiger des conseils destinés… aux auteurs débutants !
Et vous savez quoi ? J’ai accepté. N’oubliez pas, je crevais la dalle, et j’avais 20 ans. Un âge où l’estomac a du mal à se faire une raison quand le menu quotidien se compose de betteraves rouges et de maïs en boîte (ma spécialité culinaire, j’ai un peu progressé depuis).
« Très bien, a-t-il dit en se levant pour mettre fin à l’entretien. Proposez-moi un synopsis. Je vous rappellerai quand je l’aurai lu. »
J’ai pondu un plan détaillé dans les jours qui ont suivi. Je crois que le résultat n’était pas mauvais. En fouillant dans mes archives, je retrouverais sûrement l’original… Pour être franche, le défi m’excitait, m’amusait même. Me projeter dans une autre identité, un autre âge, un autre sexe (car l’auteur était censé être masculin – forcément, quand il s’agit de se poser en référence !), c’était un peu comme créer un personnage de fiction. Et j’aimais bien le côté ironique de la situation, j’avoue.
Hélas, le boss n’a pas donné suite. Il a eu l’élégance de me téléphoner pour m’en informer (élégance peu partagée par ses confrères plus fréquentables). Comme je me sentais assez illégitime sur ce coup-là, je n’ai pas trop insisté. J’ai recommencé à manger des betteraves…
Mais le plus étonnant, c’était que lui ne me jugeait pas du tout illégitime. Il avait juste retenu un autre candidat. C’était un homme d’affaires sans états d’âme, un requin sans scrupules, oui – mais qui, au moins, ne se cachait pas de l’être. Nous avions passé deux heures ensemble à discuter et, malgré mon inexpérience flagrante en tant que nègre d’édition, il m’avait visiblement prise au sérieux.
C’était ses pigeons qu’il ne prenait pas au sérieux.
Alors, faites-le à sa place, à la place des minables qui abusent de votre vulnérabilité : prenez-vous au sérieux, votre travail le mérite… Pour vous frayer un chemin jusqu’à votre lectorat potentiel, il y a d’autres moyens que le compte d’auteur, surtout depuis que nous sommes entrés dans l’ère du numérique.
Et laissez donc ses économies à Mémé, elle pourrait en avoir besoin, la pauvre !
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Les médias traditionnels font-ils vendre des livres?
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#médias #prescripteur #recommandation #critiquelittéraire #servicedepresse #attachéedepresse
Longtemps j’ai cru qu’il existait une corrélation directe entre la couverture médiatique d’un livre et ses ventes.
Et devinez quoi ? Cette corrélation a bel et bien existé pendant des décennies. J’ai connu et profité de cet âge d’or. Mais j’en suis venue à la conclusion que c’était fini. La mutation s’est opérée en douceur, et il m’a fallu du temps pour en prendre acte. Quand les choses cessent de fonctionner comme d’habitude, on se dit qu’il s’agit d’un accident et que tout va repartir comme avant au prochain article de magazine, à la prochaine émission de radio. Eh non !
Puisque j’essaye, dans ce blog, d’expliquer en quoi « l’ancien canal est bouché », je me suis demandé pourquoi les prescripteurs qu’étaient les critiques littéraires il y a vingt ans ont perdu presque toute influence.
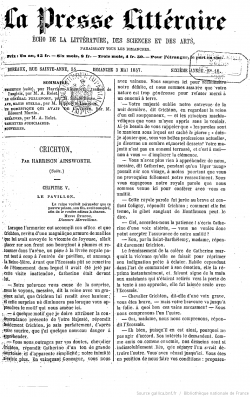 Dans l’industrie du livre, on s’accorde à penser que c’est lié aux nouvelles technologies et à l’évolution des pratiques culturelles. Le lecteur s’est détourné des suppléments littéraires papier pour effectuer ses requêtes directement sur les sites de vente en ligne ou sur les blogs spécialisés. Il se fie davantage aux commentaires et aux évaluations des autres lecteurs, ses pairs, qu’à la supposée expertise des critiques professionnels.
Dans l’industrie du livre, on s’accorde à penser que c’est lié aux nouvelles technologies et à l’évolution des pratiques culturelles. Le lecteur s’est détourné des suppléments littéraires papier pour effectuer ses requêtes directement sur les sites de vente en ligne ou sur les blogs spécialisés. Il se fie davantage aux commentaires et aux évaluations des autres lecteurs, ses pairs, qu’à la supposée expertise des critiques professionnels.
De plus, dans tous les médias l’espace dévolu aux livres se réduit, pour faire place à des formes d’expression et modes de diffusion nouveaux (les web-séries, par exemple, ou les ré-éditions en Blu-ray).
Les blogs littéraires suppléent en partie à ce manque, mais leur pouvoir de prescription n’est pas encore clairement établi – quoique, depuis quelques années, certains blogueurs reçoivent des ouvrages gratuits en service de presse, indice que leur légitimité s’accroît.
Je trouve que la radio est actuellement le meilleur média pour parler des livres avec un peu de profondeur et de finesse. Surtout sur le service public, il y a de merveilleuses émissions. Ce qui ne veut pas dire qu’elles font vendre… Avant tout, elles contribuent à développer l’aura et la réputation de l’écrivain (personal brand). Ce qui n’est pas si mal, et qui, à long terme, influera aussi sur les ventes.
Des éditeurs actifs et entreprenants essayent de remédier au problème par un travail de terrain : création de liens privilégiés avec les libraires, participation à des événements mettant en relation auteurs et lecteurs, tels que salons du livre, festivals, rencontres-débats et signatures.
Mais les auteurs ne sont pas tous invités à ces manifestations pourtant innombrables. Et on ne trouve pas toujours, dans la maison d’édition, une personne chargée des démarches nécessaires. Voyant que rien ne bougeait, il m’est arrivé une fois d’acheter des exemplaires de mon propre livre, de les poster à des responsables de festivals, de relancer… et d’être invitée. Super ! Sauf que ce n’est pas mon job, je suis juste l’auteur, moi.
Parfois il n’y a pas du tout de couverture médiatique. Et parfois, disons-le carrément, c’est la faute de l’attachée de presse (profession presque exclusivement féminine). L’AP a un pouvoir énorme sur le destin d’une nouveauté, et elle peut le saboter sans problème. (Il se peut que Machin lui ait soufflé de concentrer ses efforts sur d’autres nouveautés, mais sûrement pas de saboter celle-ci.)
Puisqu’on se dit tout, voici deux anecdotes authentiques, labellisées Anti-Pinocchio :
- Une attachée de presse m’affirme froidement, trois semaines après l’envoi du service de presse (environ 200 exemplaires) et deux semaines après la sortie d’un roman (en 2007) : « C’est mort, ça n’intéresse personne.» Quand on sait qu’il faut parfois six mois d’efforts pour décrocher un article sur un support envié… Et sortir un truc aussi brutal à l’auteur tout fragile, dépendant de sa bonne volonté, c’est, comment dire… sadique ?
- Une autre AP refuse – sans me consulter – un portrait de huit minutes en access prime time le dimanche sur TF1 (en 2013). Punaise, il y a des millions de gens devant leur poste à cette heure-là ! Quand je lui demande pourquoi, j’ai droit à ceci : « Vous allez vous faire bouffer toute crue, ces sangsues chercheront à vous faire cracher ce que vous ne voulez pas dire… » En fait, je devine chez elle une position de principe, un préjugé.
Ces deux perles illustrent bien la façon dont on vous traite quand vous n’avez pas beaucoup de poids dans la maison. Il vaut mieux être conscient de cette réalité déplaisante pour amortir les déceptions. Doit-on assumer soi-même ce que Machin s’est engagé à faire par contrat, à savoir : « s’employer à procurer à l’ouvrage, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes ses formes » ? Chacun appréciera, mais franchement, au risque de me répéter : mon boulot à moi, c’est d’écrire…
[Un ami qui a lu ce billet en avant-première a trouvé son ton trop amer. Tant pis, j’ai décidé de jouer la carte de la sincérité ! D’ailleurs, je vais en rajouter tout de suite dans l’auto-humiliation 😉 :]
Pour vous donner une idée très concrète de la dé-corrélation entre couverture médiatique et ventes, j’ai mis en regard les chiffres de vente de mon dernier bouquin – un document d’intérêt général – avec les « événements » médiatiques qui les précédaient d’une à deux semaines (chiffres tirés d’Edistat qui, je le rappelle, ne comptabilise pas les ventes en ligne et hors Hexagone) :
- Entrefilet dans L’Obs, 60 exemplaires (mais comme c’était aussi le lancement du bouquin, on ne peut pas être certain de la corrélation)
- Émission Service Public sur France Inter, 0 exemplaire
- Émission 7 Milliards de voisins sur RFI, 11 exemplaires
- Deux pages dans un magazine alsacien, 11 exemplaires
- Entrefilet dans Les Échos, 0 exemplaire
- Émission sur une radio locale, 0 exemplaire
- Émission Le Bien public sur France Culture, 6 exemplaires
- Émission TV sur Canal 31 Île-de-France, 0 exemplaire ; rediffusion de la même émission, 0 exemplaire
- Deux pages dans le magazine spécialisé Culture Droit, 0 exemplaire
- Long article sur un site web spécialisé, 11 exemplaires
Il n’y a pratiquement plus aucune corrélation ! Et cette observation est confirmée par les confrères mid-listers interrogés, y compris étrangers, et par des copains éditeurs. Les médias tradis ne font plus vendre (sauf une ou deux émissions de télé), ils améliorent seulement l’image de l’auteur. Le phénomène est général. Voilà pourquoi il est essentiel que le livre soit bien diffusé : sa visibilité sur les points de vente est sa seule chance de survie. (Je vous rassure, le livre en question s’est tout de même vendu à quelques centaines d’exemplaires.)
Pour aller plus loin sur la décadence de la critique et les pratiques émergentes en ce domaine, jetez donc un coup d’œil sur cette étude remarquable de Frédéric Martel (en fait, elle vaut la peine d’être lue intégralement). Il y dépeint l’avènement de ce qu’il nomme la smart curation, la recommandation intelligente. Le mot d’ordre en est : « The machine will be the critic. » Autrement dit, l’agrégation de contenus, les algorithmes d’indexation et leur manipulation par un référencement travaillé et l’usage calculé de mots-clés, sont en passe de se substituer aux critiques d’antan dans la prescription culturelle.
Juste un échantillon (accrochez-vous, ça vaut le coup) :
La prescription traditionnelle n’a pas disparu, mais partout, les journalistes que j’ai interrogés depuis plusieurs années dans une cinquantaine de pays reconnaissent que « quelque chose est en train de se passer ». Internet induit par nature la fin des hiérarchies, la désintermédiation, la décentralisation, la disparition des légitimités élitistes – autant d’évolutions qui affectent inévitablement la critique. On entre dans une culture qui se caractérise par des « conversations » et non plus par des arguments d’autorité, une culture où la recommandation devient centrale, mais où les prescripteurs se démultiplient aussi, et à l’infini. La légitimité sur Internet ne dépend plus seulement du statut social, des diplômes ou des connaissances acquises, comme dans l’univers du papier, mais intègre de nouveaux critères comme l’e-reputation, la popularité, la « communauté » à laquelle on appartient, ou celle que l’on a rassemblée autour de soi. Le modèle hiérarchique top-down de la critique culturelle traditionnelle s’essouffle partout. C’est la grande « disruption » des hiérarchies.
On n’est pas sortis de l’auberge numérique, à mon humble avis.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Manuscrits: l’offre et la demande
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#manuscrit #ouvragedecommande #assistantdédition #nègredédition
Longtemps j’ai cru que la totalité des livres naissait de l’imagination d’un auteur (la maman) et du désir d’un éditeur (le papa).
Ce n’est pas faux à 100%, ça l’est juste à 50%, ce qui est la part des œuvres de fiction dans l’industrie du livre : roman (français et étranger), nouvelle, BD, jeunesse – c’est là que ça se passe, que ça bouillonne, que ça déconne. C’est le secteur qui privilégie encore l’offre spontanée venue d’en bas sur la demande formatée venue d’en haut, même s’il existe de plus en plus de collections très ciblées dont les directeurs sollicitent directement les auteurs.
Presque tout le reste – scolaire, pratique, professionnel, guide de voyage, document d’actualité, essai, témoignage, histoire, sciences humaines ou sciences dures, etc. – résulte d’une commande de dir’col’. De plus, toute cette moitié et une bonne partie de l’autre est retravaillée par des assistants d’édition ou par des indépendants dans mon genre. Retravailler signifie : corriger, réécrire, restructurer, adapter, compléter, réduire, annoter, indexer… Bref, toutes les interventions concevables sur un texte.
Ainsi, quand vous entrez dans une librairie, les objets que vous découvrez ont pour la plupart été raffinés par des professionnels. Ils ne sont pas sortis du tube tels quels. Assistant d’édition est un métier magnifique qui se patine au fil de l’expérience, l’un des plus méconnus mais des plus essentiels dans notre domaine. Il implique un commerce constant avec la langue écrite, du goût, de l’intuition, de la curiosité, une vaste culture. Et la maîtrise parfaite de ses outils.
Si l’auteur est la maman et l’éditeur le papa d’un livre, on peut supposer qu’un amant (et parfois deux ou trois) agit souvent dans l’ombre de ce couple où les divorces sont légion !
À propos de retravail, si Machin (notre éditeur lambda) prend la peine de suggérer des retouches sur votre manuscrit, faites-lui bon accueil : on a toujours besoin d’un regard compétent. Montrez-vous reconnaissant du service qu’il/elle vous rend ! Machin a chaque jour de moins en moins de temps à vous accorder, c’est donc une preuve d’intérêt et de professionnalisme de sa part.
Certains débutants refusent de changer la moindre virgule et, mortifiés, se tournent illico vers la concurrence. Que dire, sinon qu’ils sont précisément ce qu’ils sont – des débutants ? Je connais des auteurs très âgés qui sollicitent toujours l’avis de leurs confrères ou de leurs éditeurs. Ce n’est pas seulement de l’humilité, c’est de la lucidité. Ils ne se conforment pas à 100% aux remarques qu’on leur fait. Mais ils y réfléchissent toujours…
N’oubliez pas qu’en cas de désaccord, c’est l’auteur qui a le dernier mot, car il détient les droits intellectuels et moraux de son œuvre. Ce qu’il cède à l’éditeur, c’est seulement le droit d’exploiter son œuvre pour une durée et sur un territoire clairement délimités par contrat (et ces droits dits patrimoniaux sont transmissibles aux héritiers pendant 70 ans après son décès). Eh oui, c’est comme ça, au pays de Beaumarchais, Balzac, Sand et Hugo !
Revenons aux ouvrages de commande. Je ne suis pas ce qu’on appelle un nègre d’édition, c’est-à-dire quelqu’un qui se substitue entièrement à celui/celle qui signera le livre. Je me borne à co- et ré-écrire les livres des autres, et dans certains cas (mais pas toujours) mon nom apparaît en petits caractères dans les premières pages, avec la mention « en collaboration avec… » J’aime bien résumer ainsi la situation : c’est « leur » histoire, mais c’est « mon » texte.
Force est de constater que je gagne mieux ma vie en améliorant les livres des autres qu’en rédigeant les miens. Ce qui, naturellement, m’incite à accepter les commandes pour pouvoir payer mes factures, au détriment de ma part créative.
 Rien de nouveau sous le soleil : le matériel l’emporte sur le spirituel. Mais vous savez quoi ? Le gars qui pond son chef d’œuvre le ventre vide en grelottant sous un pont, voilà un mythe romantique stupide, à jeter aux oubliettes.
Rien de nouveau sous le soleil : le matériel l’emporte sur le spirituel. Mais vous savez quoi ? Le gars qui pond son chef d’œuvre le ventre vide en grelottant sous un pont, voilà un mythe romantique stupide, à jeter aux oubliettes.
Bien consciente de cela, parfois je m’interroge : ce savoir-faire que les éditeurs apprécient tant quand je le mets au service des autres, est-ce qu’il m’abandonnerait quand j’écris sous mon nom ? Autrement dit, serais-je moins bon artiste qu’artisan ? Partir de zéro, c’est plus difficile… Cela pourrait expliquer mes difficultés récurrentes à publier certains de mes livres.
Allons, sèche tes larmes, fillette ! La qualité n’est pas tant en cause que la loi de l’offre et de la demande. Il faut se rappeler que la commande, par définition, correspond à ce que Machin est déjà certain de vouloir publier. Il a identifié un créneau commercial. Il a prévu un budget, un plan d’amortissement, une date de parution, un lancement. Il croit dans ce titre avant même de l’avoir entre les mains.
Ce qui n’est pas le cas du manuscrit que je lui  propose. Machin sait (ou croit savoir) ce qu’il recherche, et mon offre spontanée ne rentre pas forcément dans ses critères. Regrettable, affreusement déprimant, mais logique !
propose. Machin sait (ou croit savoir) ce qu’il recherche, et mon offre spontanée ne rentre pas forcément dans ses critères. Regrettable, affreusement déprimant, mais logique !
(Bon, accordez-moi une pause, je vais me préparer une tisane Sérénité.)
Ce n’est pas pour autant qu’il faut essayer de se conformer par avance à la demande supposée des éditeurs : très mauvais plan, laissez tomber ! On m’a souvent suggéré d’écrire ma version de tel best-seller, histoire de me faire du pognon facile, et là, une seule réponse : même si je voulais, je ne pourrais pas. Ce serait une purge sans objet. Vu l’énorme quantité de boulot, l’investissement monstrueux que représente la rédaction d’un roman de 300 pages, mieux vaut que liberté, désir et imagination soient nos seuls guides, pas vrai ?
Mon conseil : quand vous écrivez de la fiction, soyez totalement indépendant. Seuls vos propres critères doivent prévaloir, c’est le secret de tout écrivain qui se respecte. Ne prenez d’ordre de personne. Ne cherchez pas à imiter. Oubliez tout ce que vous savez du marché, du système, du lectorat, toutes ces choses dont je vous parle dans ce blog et qu’il est très important de connaître – mais seulement quand vous sortez de chez vous.
Si vous êtes un écrivain authentique, vous devez vous attendre à ce que ce soit très, très difficile tous les jours ou presque. Mais solitude, précarité, indifférence, tout cela est compensé par un trésor rarissime dans cette société, et que tous les autres vous envieront : la liberté !
(Vous en prendrez bien une tasse avec moi ?)
Revenons à nos moutons prosaïques. Je vous le disais plus haut, les éditeurs, à tort ou à raison, croient savoir ce que le public attend. De plus, comme dans les médias, ils s’imitent beaucoup les uns les autres. En littérature, le paramètre de la mode joue un grand rôle, ce qui peut parfois expliquer nos échecs.
Ainsi, il arrive à Machin de souffler à l’un de ses auteurs au nom déjà établi (exactement comme une marque) : « Dis donc, Coco/Cocotte, t’as vu le carton que X a fait avec Tempête au cœur du Rollmops ? Je suis sûr qu’avec ton talent unique et ton clavier bionique, tu pourrais faire dix fois mieux ! Qu’en penses-tu ? »
Parfois, Coco/Cocotte se laisse convaincre. Le résultat, lui, n’est pas toujours convaincant… M’enfin, chacun fait comme il sent, hein ?
Nuançons le propos : Machin peut aussi souffler à ses auteurs des idées personnelles sans chercher à reproduire de récents succès. Il est alors dans son rôle et ça n’a rien de répréhensible. Ça peut même déboucher sur un chouette prix Goncourt, comme celui de Patrick Rambaud pour La Bataille en 1997.
Deux exemples de mode en Litt’Gén’Contemp’ (vous aimez l’acronyme ?) :
> Ces temps-ci, il y a une jolie épidémie de romans-biographies (qu’on appelle aussi exofictions) : par exemple, Jean Echenoz sur Ravel, Emmanuel Carrère sur Limonov, Patrick Deville sur Yersin, entre autres excellents bouquins ;
 > Les romans écrits par des femmes sur le sexe trash, du type Baise-moi de Virginie Despentes (1993), puis sur le sexe cérébral, du type La vie sexuelle de Catherine M. de Catherine Millet (2001), ont été « toujours imités, jamais égalés », à l’instar du célèbre As du Fallafel de la rue des Rosiers.
> Les romans écrits par des femmes sur le sexe trash, du type Baise-moi de Virginie Despentes (1993), puis sur le sexe cérébral, du type La vie sexuelle de Catherine M. de Catherine Millet (2001), ont été « toujours imités, jamais égalés », à l’instar du célèbre As du Fallafel de la rue des Rosiers.
Une chose encore : certains sujets perçus comme « non féminins » sont rejetés si l’auteur est une femme. Ce n’est jamais dit comme ça, bien sûr, mais c’est une déduction empirique que j’ai faite à propos d’un roman où je parlais de la guerre. Pourquoi le milieu littéraire échapperait-il aux préjugés sexistes, présents tant chez les hommes que chez les femmes ? Échouer à publier peut aussi s’expliquer par ce facteur. L’Autrichienne Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature, a décrit dans ses interviews ce genre d’humiliation réservé aux femmes écrivains (je n’emploie pas le mot écrivaine, mais je n’ai rien contre).
Pourtant, c’est bien dans l’offre spontanée que réside le germe de l’invention, la possibilité d’un renouveau de la littérature. Et Machin en est conscient, malgré ce qu’un ami à moi appelait « les murs aveugles de Saint-Germain-des-Prés ». C’est pourquoi tous les manuscrits arrivés par la poste sont examinés, quoique brièvement et tardivement. N’oubliez pas que j’ai été repérée comme ça !
Les éditeurs se plaignent que ça leur coûte cher en personnel, mais ils savent que c’est dans ce vivier qu’il pêcheront peut-être le gros poisson qui leur permettra d’équilibrer leur bilan et de satisfaire les actionnaires des conglomérats qui les chapeautent. Ils ne peuvent pas se permettre de faire l’impasse. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne commettent pas d’erreurs, dont certaines sont célèbres – un lieu commun. Mais un livre sur 6000 est publié par ce canal, à en croire cet article.
Alors, c’est vrai, l’édition est un commerce qui s’insère dans un marché ; mais c’est aussi un métier où l’on est obligé de prendre des risques. Elle est là, la faille où vous devez vous glisser pour imposer vos livres, chers camarades-concurrents !
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Le livre numérique en France et aux USA
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#livrenumérique #ebook #Amazon #marketing
NB : Ce billet commence à dater, il se peut que les chiffres indiqués aient un peu évolué.
Longtemps j’ai négligé le marché du livre numérique. Où en est-il aujourd’hui, en France et aux États-Unis ?
Je suis plus lettres que chiffres, mais de temps en temps, il faut ingurgiter une dose de statistiques pour y voir plus clair… Courage ! Je vous ai mâché le travail en compilant les données pour vous :
D’après le Syndicat National de l’édition, le marché du numérique poursuit sa pénétration, portée par certains segments éditoriaux. En 2014, tous supports et catégories confondus, il a généré un chiffre d’affaires de 161,4 millions d’euros, en progression de 53,3%. Cela représente 6,4% du chiffre d’affaires des ventes de livres. (Bizarrement, on trouve 4,1% sur une autre page du site web du SNE censée concerner la même période…)
Cette progression a été principalement portée par le marché professionnel qui représente 64% des ventes en format numérique (contre 58% l’an dernier).
L’édition numérique grand public continue de gagner du terrain à la faveur d’une offre attractive et conséquente, d’une baisse des prix et d’un taux d’équipement en progression dans les foyers. Elle atteint désormais 2,9% des ventes de livres (contre 2,3% en 2013).
Les deux-tiers des lecteurs de livres numériques ont lu un livre imprimé il y a moins d’un mois.
Sans vouloir mettre le boxon (quoique…), je note que le bilan annuel du très sérieux cabinet GfK diffère sensiblement de celui du SNE. GfK affirme que les ventes d’ebooks en France n’ont progressé que de 45% en 2014 (en valeur, 63,8 millions d’euros). La progression en volume est de 60% et 8,3 millions de livres numériques ont été téléchargés.
Le livre numérique reste encore un segment faible : il représente 1,6% du chiffre d’affaires total du livre, et 2,4% des volumes de ventes.
Il y a environ un million d’acheteurs d’ebooks sur le territoire, et les trois-quarts d’entre eux achètent aussi des livres papier.
Pour compléter, l’étude annuelle du CREDOC nous apprend que, entre 2011 et 2015, la proportion de lecteurs de livres numériques a doublé, passant de 4 à 8%. La défiance décroît : en 2011, 80% des sondés déclaraient ne jamais vouloir lire de livres au format numérique. S’ils restent 72% à défendre cette position en 2015, l’idée de lire à l’avenir sur un support numérique a progressé : 20% des personnes interrogées l’envisagent en 2015 contre 16% en 2011. (Punaise, 72% de gens hostiles à l’ebook, encore aujourd’hui… C’est pas gagné !)
Outre-Atlantique, selon une étude de Nielsen résumée par The Bookseller (sorry, in English), les ventes d’ebooks ont décliné de 6% en 2014 par rapport à l’année précédente, alors qu’elles avaient progressé de 3,8% en 2013. Les ebooks représentent 26% des ventes de livres en 2014, contre 28% en 2013. (On trouve aussi les chiffres de 29% en 2015 contre 31% en 2014.)
Mais il se pourrait que ce déclin supposé soit en trompe-l’œil, car les enquêtes ne prennent pas en compte le marché de l’auto-édition numérique, en croissance exponentielle sur les plateformes, comme l’affirme Gareth Cuddy (« Ce que l’on ne mesure pas existe tout de même »). Le PDG de Kobo, Michael Tamblyn, se demande également si les méthodes de calcul de l’Association of American Publishers sont adaptées à l’économie numérique : « Kobo Writing Life [service d’auto-édition] représente maintenant 15% de nos ventes, soit notre troisième plus importante source de vente. » Et les chiffres de l’AAP n’incluent pas non plus les services d’abonnements, alors que plus de 12% des lecteurs de livres numériques américains sont abonnés à Kindle Unlimited.
Quoi qu’il en soit, plus de 50% des livres achetés sur Amazon US sont en format numérique.
C’est la catégorie Fiction adulte qui représente la plus grande part en format numérique, avec 51% des ventes totales. La littérature générale, le roman sentimental et/ou érotique, le suspense, le polar et la fantasy, ont tous dépassé les 50%. (Dans le Top 100 des ventes d’ebooks sur Amazon France, on trouve 96 romans. Étonnant, non ? J’aurais cru que ce serait plutôt les livres de développement personnel.)
 Les ventes d’ebooks en Littérature de jeunesse ont augmenté de 10% en 2014, mais représentent seulement 15% des ventes totales dans cette catégorie. La majorité des adolescents déclare préférer toujours les livres-papier. En 2015, chez les 15-24 ans, on compte 32% de lecteurs d’ebooks.
Les ventes d’ebooks en Littérature de jeunesse ont augmenté de 10% en 2014, mais représentent seulement 15% des ventes totales dans cette catégorie. La majorité des adolescents déclare préférer toujours les livres-papier. En 2015, chez les 15-24 ans, on compte 32% de lecteurs d’ebooks.
Parmi les acheteurs de livres dans les six derniers mois, 49% en ont acheté en format soit papier, soit numérique, et 9% uniquement en numérique.
Assez de chiffres, venons-en à la seule question intéressante : « Et moi, dans tout ça ? » 😉
Il est clair que mon projet de me faire connaître en France comme auteur pure player ne sera pas facile à réaliser ! Tentons d’analyser objectivement ma situation de départ :
Négatif :
– n’écrivant pas en anglais, mes lecteurs potentiels représentent seulement 2 à 3% du marché du livre français ;
– de plus, c’est le segment professionnel qui prédomine dans le marché du numérique, et non le segment grand public (46%) ;
Positif :
– oui, mais sur Amazon France, que j’envisage comme vecteur principal de lancement, la Fiction adulte est prédominante ;
Négatif :
– d’accord, mais sans doute pas celle que j’essaye de pratiquer, plutôt – d’après mes observations – la fiction grand public (mainstream), et la fiction dite « de genre » ou « de niche » (soutenue par des communautés de fans).
Vu l’extrême segmentation du marché, je devrais écrire des « romances exotiques pour jeunes adultes » ou des « thrillers historiques avec personnages monstrueux », au lieu de littérature générale !
Bon, vous l’avez compris : dans ce bilan provisoire, le négatif l’emporte sur le positif. Et pas sûr que les qualités époustouflantes de mes écrits parviennent à faire la différence. Si je ne bouge pas, je suis même certaine de sombrer au fin fond des classements des ventes en moins de deux semaines. Victime des algorithmes, comme tant d’autres avant moi…
Et donc, qu’est-ce qui (mis à part l’entêtement légendaire qui a fait le désespoir de ma maman) me pousse à persévérer quand même dans mon projet de recourir à l’auto-édition numérique, alors que tout m’incite à laisser tomber ?
Deux choses :
– étant un auteur confirmé, si je change de canal, c’est parce que l’ancien canal est bouché (en particulier pour le genre de la nouvelle, que je pratique de plus en plus) ;
– j’ai compris qu’un paramètre pouvait changer la donne dans l’auto-édition numérique : le marketing.
Je n’y connais rien en marketing de livres, évidemment (pas convaincue que les responsables commerciaux des éditeurs tradis en sachent beaucoup plus !). Mais je peux apprendre. Par chance, tous les outils sont disponibles sur Internet, à condition de les chercher. On peut se former tout seul, essayer un truc, se planter et recommencer. C’est une démarche empirique, exactement comme l’écriture : elle me convient, elle me ressemble, elle ne me fait pas peur, et même, elle excite ma curiosité et mon goût du risque.
Il s’agit avant tout de changer d’attitude existentielle : cesser de déléguer mes intérêts à des personnes qui s’avèrent parfois incompétentes, ou simplement indifférentes ; abandonner un modèle dépassé, remettre en cause mes habitudes et, surtout, reprendre la main sur ma carrière littéraire.
Pari assez casse-gueule, n’est-ce pas ?!
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Connaître l’environnement éditorial
 Par Nila Kazar
Par Nila Kazar
#office #édition #concentration #droitsdauteur #livrenumérique #Edistat #paupérisation #écrivains
Longtemps j’ai vécu dans ma tour d’ivoire, négligeant ce fait pourtant évident : les conditions de vie d’un écrivain sont modelées par son environnement éditorial.
Croyez-moi, il faut sortir de cette tour, regarder autour de soi et s’efforcer de devenir un professionnel informé, en plus du créateur désintéressé que vous êtes déjà. Le plus tôt sera le mieux. Mon but avec ce blog est de vous faire gagner du temps !
Commençons par quelques chiffres récents :
> En France, 30.000 personnes travaillent dans l’édition ou la librairie. Au total, en 2013 il y a 74.000 emplois dans l’industrie du livre.
> Le salaire annuel moyen d’un cadre dans l’édition est de 31.000 €.
> 3.500 auteurs sont affiliés à l’AGESSA, la sécurité sociale des auteurs ; pour cela il faut gagner au minimum 8.400 € de droits d’auteur par an. (J’y ai été affiliée pendant vingt ans, ensuite j’ai trouvé que cela tournait à l’esclavage ; sous la pression des Grands Vérificateurs, pour conserver ce statut j’étais obligée d’accumuler des « activités annexes » de plus en plus envahissantes.)
En résumé : les écrivains font vivre un petit secteur économique, mais la plupart ne vivent pas de leur plume/clavier, excepté une ou deux centaines d’entre eux, estime-t-on faute d’enquête fiable.
Même histoire aux US, où 56% des auteurs se situent en dessous du seuil de pauvreté et gagnent moins de 11.670 $ (10.312 €) par an, comme en atteste cette étude 2015 de The Authors Guild (sorry, in English).
La faute à qui ? La faute à quoi ?
Suivez mon regard : l’éditeur serait-il le prédateur naturel de l’auteur, en vivant à ses dépens dans un rapport d’exploitation typique du faible par le fort ?
Bon, il y a un peu de ça. Les rapports auteur/éditeur ont toujours été compliqués. Balzac, quand il était énervé, c’est-à-dire à peu près tout le temps, traitait Machin d’épicier. Regardez ce qu’il en disait ci-dessous, ça vaut le détour !
Mais est-ce que ça suffit à expliquer la paupérisation des écrivains ?
Pour répondre à cette question, je vais résumer quelques points déterminants. Accrochez-vous, c’est un peu technique !
- Depuis le XIXe siècle, le libraire est le banquier de l’éditeur à cause du système de l’office. C’est l’envoi automatique des nouveautés au libraire qui les paie tout de suite, mais peut retourner les invendus au bout de trois mois (taux de retour : 25%). Il avance donc de la trésorerie à l’éditeur, alors qu’il n’en a pas les moyens. Ce système est responsable de l’inflation éditoriale. L’éditeur, plutôt que de rembourser au libraire les invendus, lui expédie l’office suivant (on appelle ça « faire de la cavalerie»). Il a donc intérêt à publier beaucoup de nouveautés. Le libraire, s’estimant submergé par celles-ci au détriment du fonds, effectue les retours de plus en plus tôt (deux mois). Et ainsi de suite, en un cercle vicieux qui s’accélère.
Selon Jean-Marc Bastardy, « les grands groupes éditoriaux gagnent de l’argent non pas sur l’édition des livres à proprement parler, mais sur le flux de la commercialisation de leurs supports matériels (livres imprimés) et les services lucratifs facturés aux libraires tout au long de la chaîne logistique offerte par les filiales de diffusion-distribution appartenant à ces mêmes groupes. »
On comprend le libraire dépassé qui se dit : à quoi bon ouvrir les cartons ?
Cela signifie que votre précieux bouquin, sur lequel vous avez sué sang et eau, ne verra peut-être jamais la lumière du jour. Ou seulement quelques semaines, sur quelques points de vente, avant d’être balayé par les nouveautés du prochain office.
Il n’y a par conséquent aucune corrélation entre le temps de création et la durée de vie d’un livre. Malgré une presse favorable, si votre livre n’est pas diffusé convenablement, vous en vendrez moins que du précédent. Et les éditeurs, ayant les moyens de le savoir (grâce à Edistat, voir le point 4), auront d’autant moins envie de publier le prochain… Autre cercle vicieux.
Je vous entends d’ici : « C’est vraiment trop inzuuuste ! »
- Depuis les années 1980, un mouvement mondial de concentration dans l’édition a induit un nouvel effet pervers. Les actionnaires des grands groupes industriels qui détiennent désormais la plupart des maisons exigent 10 à 15% de rendement annuel, comme pour les autres secteurs. Or dans celui du livre, le maximum qu’on puisse espérer est de 3%, comme l’explique André Schiffrin ici et là (une lecture indispensable !).
Une façon concrète de visualiser cette concentration est de comparer d’une année à l’autre le plan des stands qu’on distribue au Salon du livre de Paris : aujourd’hui, deux ou trois énormes masses occupent le centre (les grands groupes éditoriaux), entourées d’une myriade de taches multicolores (les petits éditeurs indépendants, relégués aux marges)…
Le même Jean-Marc Bastardy, dans sa lettre ouverte à Fleur Pellerin (que j’aurai encore l’occasion de citer), poursuit : « 10 groupes intégrant tous les maillons de la chaîne du livre assurent 80% du C.A. consolidé du secteur ; parmi eux, deux seulement captent plus de la moitié des revenus. Cette situation d’oligopole, comme toute économie concentrée, est régie par la logique des flux. Flux financiers, d’abord : on ne gagne plus d’argent sur les livres eux-mêmes, mais sur l’argent des livres. La nuance est importante car elle inverse les choix stratégiques de l’entreprise. Flux éditoriaux, ensuite : cette nécessité d’optimisation de la marchandise, des stocks donc, oblige à standardiser l’offre et à best-selleriser la production. »
En conséquence, dans les maisons les comptables brident les choix des éditeurs qui, placés en liberté surveillée, se risquent de moins en moins à miser sur des livres atypiques ou des auteurs méconnus. Et c’est au premier chef la biblio-diversité qui pâtit de cette dérive.
- Depuis les années 2000, dans la logique de cette best-sellerisation, un nouveau phénomène a pris de l’ampleur : le débauchage d’auteurs-stars au tarif des transferts de footballeurs. Des exemples ? Il y en a plein dans cet article, où l’on constate que c’est souvent un investissement décevant…
Ceci explique en partie pourquoi le mid-lister se voit proposer des pourcentages et des à-valoirs de plus en plus réduits, malgré une bibliographie respectable. Pour financer le million d’euros obtenu pour Houellebecq par son agent, il faut imposer à des dizaines de mid-listers dans mon genre un pourcentage de 8%, alors qu’ils ont débuté à 10%, et un à-valoir de 1.500 €, alors qu’ils ont culminé à 5.000 € (ce qui reste dérisoire, on est d’accord). Ils deviennent l’humus sur lequel croissent la fortune et la réputation de quelques élus.
Ainsi, comme dans les autres secteurs économiques, les inégalités se creusent entre les insiders et les outsiders.
- Un dernier bouleversement est intervenu récemment : Internet et le numérique. J’ai applaudi des deux mains à cet appel d’air inespéré, d’abord parce que les librairies en ligne ont revivifié le fonds. Les ouvrages introuvables sont redevenus disponibles. Tous les bouquins de l’histoire allaient désormais rester accessibles pour l’éternité, dans un espace virtuel illimité : merveilleux pour une lectrice vorace !
Assez vite, mes premiers romans ont refait surface dans des listes de titres. Mais mon enthousiasme est un peu retombé quand je me suis aperçue que je ne gagnais pas un centime sur ces anciens livres vendus d’occasion. Eh oui, on n’est rémunéré que sur la première vente…
Ensuite, l’édition numérique a commencé à se développer. Mais les éditeurs tradis, soucieux de préserver leurs ventes en poche et d’augmenter leurs marges (55% sur l’ebook, 36% sur le papier, voir ici), ont fixé des prix trop élevés pour que l’ebook soit vraiment attractif, comme l’explique cet article. De plus, il est impossible de commander des ebooks français depuis l’étranger, à cause du géo-blocage sur Internet. Ce qui incite au piratage : je retrouve mes livres en téléchargement gratuit sur certains sites mal famés peu de temps après leur parution.
Quant aux pourcentages que je perçois sur les versions numériques de mes bouquins, ils varient de façon sidérante, s’alignant parfois sur le papier alors que le prix de revient est très inférieur… Tout cela, disons-le carrément, n’a d’autre but que de préserver les acquis d’une corporation.
Alors, prédateur naturel de l’auteur ou pas, l’éditeur ?! Balzac, reviens, ils sont devenus fous !
Enfin il faut dire un mot du serveur Edistat, qui permet de suivre la courbe des ventes d’un titre au jour le jour, avec des statistiques à la demande. Un outil génial, croyais-je… Mais il s’est avéré que la transparence n’a pas que du bon. Vos chiffres de ventes connus de tous, plus d’arrangements possibles avec la réalité quand vous approchez un nouvel éditeur ! Il va tout de suite vérifier combien vous avez vendu chez votre ex-Machin. (Un malotru l’a même fait sous mes yeux.)
Or sachez qu’Edistat ne comptabilise pas les ventes en ligne, aux bibliothèques, en Suisse et Belgique. Si bien que le relevé de ventes éditeur pour 2014 d’un de mes livres mentionne 315, et celui d’Edistat, 187 exemplaires. Un déficit de 40 % !
Qu’est-ce qu’on disait, déjà ? Ah oui : « C’est vraiment trop inzuuuste ! »
 Il y a quinze ans déjà, Donald Westlake racontait dans un polar, Le Contrat (The Hook), comment son narrateur Wayne Prentice, traqué par les statistiques de ventes de ses précédents livres, tentait de relancer sa carrière en prenant des pseudonymes pour se présenter comme un auteur débutant. Du blanchiment de marque, si l’on veut. Mais – c’est la loi du genre – il finissait par échouer dans une impasse tragique…
Il y a quinze ans déjà, Donald Westlake racontait dans un polar, Le Contrat (The Hook), comment son narrateur Wayne Prentice, traqué par les statistiques de ventes de ses précédents livres, tentait de relancer sa carrière en prenant des pseudonymes pour se présenter comme un auteur débutant. Du blanchiment de marque, si l’on veut. Mais – c’est la loi du genre – il finissait par échouer dans une impasse tragique…
Bon, d’accord, je vais tout faire pour éviter que le sang coule !
Le plus de Bazar Kazar : extrait de la Revue de Paris (Bruxelles, t. VII, juillet 1835), un article satirique sur les éditeurs, attribué à Balzac. Gaffe, il est en pétard, Honoré !
(…) Si l’éditeur était un homme d’esprit, ce serait un être prodigieux au bout de quelques années d’exercice. C’est le confesseur de tous les besoins littéraires; il sait par où sont passées les idées qui, plus tard, ont remué la société; il a vu le moment suprême où celui-ci a tourné à gauche, cet autre à droite, déterminé par la misère derrière et un billet de 500 francs devant. L’éditeur pourrait vous dire pourquoi tel homme est critique, au lieu d’être romancier; pourquoi celui-ci pair de France, au lieu d’écrivain philosophe; pourquoi cet autre commis insolent, au lieu de mercenaire à la feuille. L’éditeur fournit des discours à la chambre des pairs et des députés par commission. L’éditeur a plus d’une fois procuré à tel mandataire du peuple les applaudissements de son arrondissement, moyennant cent écus dont il donnait dix au faiseur de discours. L’éditeur, lorsqu’il publiait des livres sur l’histoire contemporaine, a vu venir chez lui les habits brodés de tous rangs, et les illustres après les plus pures réputations, priant, sollicitant, menaçant, boursillant pour qu’il supprimât une phrase ou un fait. L’éditeur connaît l’homme qui fait les mots heureux et les mots sublimes de presque toutes les gloires contemporaines; le mot de La Fayette mourant: Vous verrez la terre promise! a été fait par un carliste entre deux verres de champagne; l’éditeur a connu M. Thiers embrochant lui-même son gigot pour le faire cuire au feu de sa chambre à coucher; l’éditeur sait que le savant M… fait des fautes d’orthographe; l’éditeur sait comment on commande un livre né de l’inspiration, et qui n’est que le cri d’un cœur honnête. Que ne sait pas l’éditeur!
 Il sait comment on fait un marché avec un auteur de manière à lui acheter sa vie et la lui payer 100 francs par mois; il sait comment il a fait marché pour imprimer mille exemplaires d’un livre, comment on tire deux mille, et comment on dit n’en avoir pas vendu cinq cents; il sait encore par quels moyens on dégoûte un homme de lettres de s’occuper de ses livres, et comment on les lui achète pour dix, douze, quinze ans. Et alors il faut voir, quand le livre est sa propriété, ce que l’éditeur en fait, comment ce terrain stérile devient fécond, publié en collections, en livraisons grand et petit format, avec ou sans gravures, édition de luxe, édition populaire, édition de poche, édition compacte; son auteur, dont quelque temps auparavant il parlait du bout des lèvres, son auteur, c’est un génie, c’est le seul génie de l’époque. L’annonce, la réclame, le prospectus, volent, courent, retentissent, et l’éditeur, au bout de dix ans, rend à l’homme de lettres sa propriété usée, sucée, épuisée, puis il va s’engraisser dans une douce oisiveté, tandis que l’écrivain maigrit encore au travail.
Il sait comment on fait un marché avec un auteur de manière à lui acheter sa vie et la lui payer 100 francs par mois; il sait comment il a fait marché pour imprimer mille exemplaires d’un livre, comment on tire deux mille, et comment on dit n’en avoir pas vendu cinq cents; il sait encore par quels moyens on dégoûte un homme de lettres de s’occuper de ses livres, et comment on les lui achète pour dix, douze, quinze ans. Et alors il faut voir, quand le livre est sa propriété, ce que l’éditeur en fait, comment ce terrain stérile devient fécond, publié en collections, en livraisons grand et petit format, avec ou sans gravures, édition de luxe, édition populaire, édition de poche, édition compacte; son auteur, dont quelque temps auparavant il parlait du bout des lèvres, son auteur, c’est un génie, c’est le seul génie de l’époque. L’annonce, la réclame, le prospectus, volent, courent, retentissent, et l’éditeur, au bout de dix ans, rend à l’homme de lettres sa propriété usée, sucée, épuisée, puis il va s’engraisser dans une douce oisiveté, tandis que l’écrivain maigrit encore au travail.
Et cependant toute cette science de l’éditeur s’efface devant la science d’un seul homme, devant la science de M. Lebigre, l’éditeur des éditeurs. M. Lebigre ne connaît pas les hommes de lettres, il ne connaît que les éditeurs. Véritable Melmoth, il les attend aux fins de mois; alors il leur apparaît avec ses écus sonnants à la main; alors, pour éviter un protêt (défaut de paiement), les volumes sortent de chez l’éditeur, à 20 sous l’exemplaire in-8°, pour aller s’enfouir dans les vastes magasins de la rue de la Harpe. Que dis-je? 20 sous? 20 sous, quand l’éditeur est debout; mais quand l’éditeur chancelle, c’est 10 sous; quand il est tombé sur la place du Châtelet, 5 sous (marché d’occasion). Oui, 5 sous! Vous y avez passé tous, littérature fringante et pittoresque de l’époque, à 5 sous tant qu’on en veut, et il en reste encore. Littérature haute et forte de l’école, vous n’y êtes point passée; vos œuvres ont été mises au pilon: on ne pouvait pas même vendre le papier.
Et maintenant, pour en revenir au point de départ de ces observations, je puis dire que je comprends la préférence accordée à l’épicier sur le libraire: c’est que M. Lebigre, ce libraire des libraires, cet éditeur des éditeurs, M. Lebigre, est épicier.
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]
Un monde qu’on appelait l’édition
Par Nila Kazar
#écrivain #manuscrit #refusdéditer #industriedulivre #prixlittéraire
Longtemps j’ai évolué dans un monde qu’on appelait l’édition. C’est là que j’ai débuté très jeune, sans aucune relation, en envoyant par la poste un seul exemplaire de mon premier roman à un unique éditeur.
Un vrai conte de fées, n’est-ce pas ?
Mais c’est vraiment ce qui m’est arrivé. Dans ce blog, je joue le jeu de la sincérité totale. Lisez ceci pour savoir à quoi vous en tenir à mon sujet.
Dans cet Ancien monde éditorial, les livres étaient composés au plomb dans des caisses en bois, ce qui produisait des pages au toucher légèrement granuleux. Quand on les ouvrait pour la première fois, ils exhalaient un parfum excitant de forêt finlandaise. Mmmmh….
Pas possible, Nila Kazar est une ancêtre, alors ?
Oui et non ! Il faut préciser que j’ai fait mes débuts en tant que bébé-écrivain. C’était une mode récente à l’époque. On m’a reçue et promue comme la nouvelle Françoise Sagan du millésime.
C’est ainsi qu’a commencé un malentendu qui allait durer des années.
En effet, je supposais naïvement que mon éditeur allait me donner tout le temps de grandir, de mûrir, et m’accompagner dans ma démarche pour devenir un écrivain-tout-court et imposer mon œuvre de génie.
Et là, je me fourrais le doigt dans l’œil jusqu’au pancréas.
Car l’abominable vérité, c’est que Machin – à partir d’ici, j’appellerai « Machin » tous les éditeurs lambda qui surgiront dans ce blog, pour simplifier – avait misé sur moi juste pour voir, un peu comme à la roulette. Il testerait bientôt d’autres Françoise Sagan d’un automne.
« Chaque rentrée littéraire ressemble à l’ouverture d’un nouveau cimetière », disait Thomas Bernhard.
Le réservoir de candidats est inépuisable, puisqu’un tiers des Français envisage de publier un livre, d’après cette enquête. Nous sommes une nation d’écrivants. Publier un livre est censé nous consoler de toutes les avanies. Même nos politiciens (mis à part Nicolas Sarkozy) sont persuadés que c’est un gage de sérieux, un brevet de culture. (Ce n’est pas toujours eux qui rédigent les livres qu’ils signent, mais parfois, oui ! )
Ainsi, le bébé-écrivain n’était qu’une marque qu’on lançait, un produit parmi d’autres, qui avait intérêt à rapporter très vite.
Mais personne ne me l’a dit, bien sûr. J’aurais à le découvrir par moi-même.
Ce qui n’excluait ni l’estime, ni l’affection que Machin portait à sa nouvelle pouliche. Qui les lui rendait bien, tout heureuse d’avoir été élue et reconnue. Rien n’est tout blanc ou tout noir dans les relations humaines. J’ai aimé beaucoup de Machins merveilleux, croyez-moi…
Ce qu’il faut comprendre et graver dans sa mémoire, c’est que l’édition est un commerce qui s’insère dans un marché. On a beau le savoir en théorie, on n’en tire pas toutes les conséquences quand on est un bébé-écrivain.
Dans l’Ancien monde, Machin misait sur un débutant jusqu’à trois fois de suite avant de l’abandonner en rase campagne.
 De nos jours, Machin mise sur un plus grand nombre d’auteurs… mais une seule fois ! C’est le règne du one-shot. On passe à quelqu’un d’autre l’année suivante, et le débutant « séduit et abandonné » sombre dans la dépression.
De nos jours, Machin mise sur un plus grand nombre d’auteurs… mais une seule fois ! C’est le règne du one-shot. On passe à quelqu’un d’autre l’année suivante, et le débutant « séduit et abandonné » sombre dans la dépression.
S’il est obstiné – qualité indispensable pour un écrivain –, il va proposer son travail ailleurs. Où, après une brève idylle, il a de fortes chances de voir se reproduire le même cycle, de plus en plus rapide.
C’est l’effet lave-linge : on en sort lessivé.
Un jour, il (« il » pour « l’écrivain », mais ça englobe « elle ») n’arrive plus à placer son nouveau manuscrit. Il le laisse traîner dans un tiroir en attendant des jours meilleurs.
Parfois ces jours meilleurs arrivent. J’ai publié certains de mes livres des années après les avoir écrits.
La coïncidence d’une offre et d’une attente, la rencontre de deux individus à un instant T peuvent être décisives. Car l’édition n’est pas, ne sera jamais une science exacte. Si elle l’était, on ne publierait que des livres à succès, et c’en serait fini de la biblio-diversité.
Un exemple ? Là où les tigres sont chez eux, de Jean-Marie Blas de Roblès, est resté dix ans dans un tiroir après de multiples refus d’éditer. Ressorti de l’ombre et retravaillé, c’est devenu le prix Médicis 2008.
Mais si les jours meilleurs tant espérés n’arrivent pas, les tiroirs se remplissent de livres morts-nés, et il faut en commander de nouveaux chez *** (je cherche un sponsor en tiroirs, des suggestions ?).
À l’heure actuelle, je publie en moyenne un manuscrit sur deux. Combien de refus d’éditer suis-je censée encaisser avant de lâcher prise ? J’ai des amis qui vont jusqu’à 30. Personnellement, mon maximum est 15, mais souvent je m’arrête avant. Je suis déjà en train de travailler sur un autre livre, et le précédent s’efface peu à peu de ma conscience…
Et devinez quoi ? J’ai tort.
Difficile d’anticiper tout ça quand on est jeune. On s’imagine que sa carrière, une fois qu’on a publié son premier livre, suivra une courbe globalement ascendante. Notre place dans les Lettres est assurée, notre bibliographie va s’étoffer, notre compte en banque et le nombre de nos lecteurs également. Sauf que…
Sauf que, tandis que je me berçais d’illusions, le monde autour de moi s’est mis à changer. Eh oui, le monde change souvent comme ça, sans prévenir. Une mauvaise habitude qu’il a, le monde.
À mes débuts je vendais en moyenne de 2.000 à 3.000 exemplaires, avec un pic de 6.000. Aujourd’hui, en tant qu’auteur installé (ce qui ne veut pas dire « célèbre », mais juste mid-lister, « du milieu de la liste »), je vends de 400 à 700 exemplaires.
Que s’est-il passé ?
C’est mathématique : je dois désormais partager un lectorat qui se réduit avec davantage de concurrents :
– le nombre de lecteurs diminue sans cesse en France. Si vous en doutez, lisez ce remarquable article de Michel Abescat et Erwan Desplanques, là ;
– tandis que le nombre de titres publiés augmente : la base de données Électre en recense le double d’il y a 15 ans !
Circonstance aggravante, le succès va au succès : « Le public achète de plus en plus ce qui se vend déjà très bien, expliquait en 2014 Vincent Monade, président du Centre national du livre. Les best-sellers peuvent atteindre le million d’exemplaires. Et le milieu de la chaîne, c’est-à-dire les auteurs qui vendaient entre 3.000 et 8.000 exemplaires (= les mid-listers), a tendance à disparaître. Aujourd’hui, ces titres-là, y compris d’écrivains très importants, se vendent parfois à moins de 1.000 exemplaires. »
Enfin, vous avez peut-être remarqué que les grands prix littéraires couronnent de plus en plus souvent des best-sellers confirmés, jouant rarement leur rôle théorique de découvreurs. (Mais certains écrivains primés ont vu leurs ventes s’effondrer rapidement, et leur nom sombrer dans l’oubli… Rien n’est garanti à long terme !)
Ainsi, contrairement à mes attentes, ma carrière a adopté une courbe en cloche – un peu comme le dessin du boa constrictor qui a avalé un mouton dans Le Petit Prince.
Je dois ajouter un dernier facteur : je ne suis pas très douée pour faire carrière. Certains auteurs ont une confiance illimitée en leur talent et savent « se vendre ». Ils ont de la chance ! Je crois qu’on peut s’améliorer dans ce domaine, mais pas changer complètement sa nature. J’ai fait des progrès, mais je reste paralysée quand il faudrait rappeler Machin pour savoir s’il m’a lue.
Ce qui m’empêche de vivre correctement de mes livres, c’est donc toute l’évolution d’un milieu. L’Ancien monde où j’ai débuté a disparu. Il m’a fallu du temps pour en prendre conscience, et encore plus de temps pour en tirer les conséquences.
Aujourd’hui je dois survivre en tant que mid-lister dans un Nouveau monde que plus personne n’appelle l’édition, mais l’industrie du livre. Or dans ce Nouveau monde, un facteur de poids a fait son apparition : le numérique. La dématérialisation du livre et sa commercialisation en ligne bousculent déjà les équilibres internes du secteur, et ce n’est qu’un début.
Qu’est-ce que les auteurs peuvent attendre de cette mutation majeure ? Le meilleur moyen de répondre à la question, c’est de tester la chose en grandeur nature. Pour cela, je vais appliquer la bonne vieille méthode empirique « Try it, Fail it, Fix it » – en français : « Essaye, Échoue, Répare ». Car si l’ancien canal est bouché, n’est-il pas conseillé d’en explorer un nouveau ?
Bazar Kazar met en perspective trente ans d’évolution de l’édition et accompagne la mue numérique d’un écrivain traditionnel. Ce blog examine avec autant de sérieux que d’humour la question qui tue : « Y a-t-il une vie après l’édition ? »
Des questions, des commentaires ? Allez voir un peu plus bas ! Et si l’envie vous taraude de goûter à mes écrits, ne résistez plus : mon dernier roman, Platonik, est ici (imprimé ou numérique). Pour vous en donner le goût, vous pouvez lire cette chronique-ci, ou celle-là !
[mc4wp_form id= »244″]